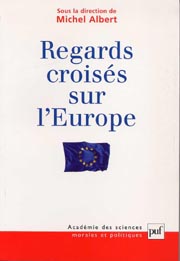Hommage de Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques
Michel Albert était un homme de fidélité. À sa famille, d’abord, et à ses amis comme le rappellera tout à l’heure Michel Camdessus. Mais aussi de fidélité à des idéaux et à des engagements qui éclairent l’ensemble de sa vie publique.
Fils d’ouvriers agricoles vendéens, installés en Charente, Michel Albert est le parfait exemple de la méritocratie républicaine qui le mena, doté d’une bourse, jusqu’à Paris où il intégra Sciences Po, avant de décrocher un doctorat de sciences économiques puis de rentrer à l’École nationale d’administration. Ainsi, commençait-il à faire fructifier les quelques talents que le Maître lui avait donnés. La parabole évangélique sied parfaitement à la personnalité de Michel Albert. Saint-Jean Chrysostome définit ainsi le talent : « tout ce par quoi chacun peut contribuer à l’avantage de son frère, soit en le soutenant de son autorité, soit en l’aidant de son argent, soit en l’assistant de ses conseils par un échange fructueux de parole, soit en lui rendant tous les autres services qu’on est capable de lui rendre, car rien n’est si agréable à Dieu que de sacrifier sa vie à l’utilité publique de tous ses frères. C’est pour cela que Dieu nous a honorés de la raison ».
L’utilité publique, voilà ce à quoi décide d’œuvrer le jeune inspecteur des finances qui, dès 1959, devient secrétaire général du Comité Rueff-Armand installé auprès du Premier ministre pour faire des propositions sur « la suppression des obstacles à l’expansion économique ». Le thème de la réforme nécessaire de la France pour une meilleure adaptation au monde moderne est une constante dans la pensée de Michel Albert. C’est ce qui le rapproche au milieu des années 1960 de Jean-Jacques Servan-Schreiber. La collaboration de l’économiste et du publiciste déboucha en 1967 sur l’incroyable succès du Défi américain. De sa participation à la rédaction de ce livre, Michel Albert aimait à dire qu’elle lui avait permis d’apprendre à écrire. Ce talent révélé, il le fit fructifier. Il publia, seul ou en collaboration, 8 ouvrages qui, pour la plupart, furent des événements et rencontrèrent un très large public. Tous sont marqués de la même exigence documentaire, servie par une écriture précise et percutante. Par ordre chronologique, il publia donc :
- Entre ciel et terre, le Manifeste du parti radical, en 1970
- Les Vaches maigres en 1975,
- Le Pari français : le nouveau plein emploi, en 1982,
- Un pari pour l’Europe, en 1983,
- Crise, Krach, Boom (avec Jean Boissonnat) en 1988,
- le classique Capitalisme contre capitalisme en 1991,
- Notre foi dans ce siècle (avec Jean Boissonnat et Michel Camdessus), en 2002
- et, enfin, Regards croisés sur l’Europe, en 2005.
Mais n’anticipons pas. En 1960, Michel Albert est nommé inspecteur général des finances du Maroc, puis directeur général adjoint de la Banque nationale pour le développement économique à Rabat, poste qu’il occupe de 1961 à 1963. Ses liens avec le royaume chérifien se sont maintenus tout au long de sa vie, puisqu’il était toujours membre du Conseil d’administration de la compagnie Wafa-assurance.
Sa carrière le mène ensuite à Bruxelles. En tant que directeur adjoint (1963-1966), puis administrateur de la Banque européenne d’investissement à Bruxelles (1966-1970), ainsi que comme directeur de la structure et du développement économique à la Commission de la Communauté économique européenne (1966-1969), il joue un rôle discret mais important dans la construction européenne. C’est là que se renforcent son idéal européen, son admiration pour Jean Monnet et son aspiration fédéraliste. C’est là aussi qu’il rencontre Raymond Barre, alors vice-président de la Commission européenne en charge des affaires économiques. Leurs chemins fut dès lors parallèles jusqu’à les mener à se retrouver tous deux membres de notre Académie. L’engagement européen de Michel Albert ne s’est jamais démenti. Il en fit même le thème de travail de notre Académie en 2004, au moment de l’élargissement aux pays d’Europe de l’Est, qu’il voyait comme une chance et, plus encore, comme un devoir envers ces pays enfin libérés du joug communiste. Car le projet européen était pour Michel Albert bien plus qu’une nécessité économique pour faire face au défi américain, il s’agissait d’un accomplissement moral. À la fin de sa carrière, Michel Albert, qui avait été nommé membre du Conseil pour la Politique Monétaire de la Banque de France, nouvellement indépendante, œuvra, avec d’autres, à rendre possible la création de l’euro.
De retour à Paris, devenu inspecteur des finances de 1ère classe en 1971, il est tour à tour directeur général de l’Union d’études et d’investissements et de l’Union de crédit pour le développement régional (Unicrédit), administrateur d’Unicrédit, président-directeur général de l’union financière de location de matériel (Unimat) et de l’Union immobilière de crédit-bail pour le commerce et l’industrie (Unicomi).
Sa riche expérience conduit ensuite Michel Albert au Plan comme commissaire adjoint en 1976, puis, à partir de 1978, comme commissaire général au Plan. La planification incitative à la française — bien éloignée des plans quinquennaux soviétiques — convient parfaitement à Michel Albert. Car, s’il était bien entendu libéral, il avait foi en l’État et en la nécessité de la régulation dont il a prouvé qu’elle n’était pas contraire aux valeurs du capitalisme, du moins dans son « modèle rhénan ». Michel Albert raconte ainsi comment il eut l’intuition qui l’amena à publier en 1991 Capitalisme contre capitalisme : « J’ai découvert le modèle rhénan », dit-il, « en 1990 le jour où les AGF ont pris 35 % de la deuxième compagnie d’assurances allemande AMB. Je garde physiquement en mémoire mon entrée dans la salle du conseil de surveillance. Il y avait une immense table rectangulaire avec vingt-quatre chaises, douze pour les représentants des actionnaires et douze pour les représentants des salariés. Parmi ces derniers, il y avait trois représentants syndicaux permanents, spécialisés dans les questions d’assurance. Ils étaient ultra-compétents. Je vous jure que pour un Français, c’était très impressionnant ». Traduit dans de nombreuses langues, Capitalisme contre capitalisme est devenu un classique de la littérature économique. La foi de Michel Albert dans « l’économie sociale de marché » était inébranlable. « Je continue à penser que le modèle rhénan est ce que l’on a fait de mieux dans l’histoire économique. L’idéal, c’est tout de même d’avoir des salariés éduqués, compétents et responsables » disait-il dix ans après la parution du livre. Et c’est l’espoir d’une moralisation de la mondialisation « amorale » héritée du XXe siècle qu’il exprimait avec Michel Camdessus et Jean Boissonnat dès l’introduction de leur ouvrage Notre foi dans ce siècle. La foi dans le progrès des sociétés humaines et l’optimisme raisonné étaient des traits fondamentaux de la personnalité de Michel Albert.
Ayant quitté le Plan en 1981, en raison de l’alternance politique, Michel Albert devint, en 1982, président des AGF. À ce poste, il engrangea de nombreux succès pour l’entreprise jusqu’en 1994, date à laquelle il en devint un très actif président d’honneur.
Il est un aspect de la vie de Michel Albert que je n’ai pas encore abordé : il fut un pédagogue. Quand on a beaucoup reçu, il convient de beaucoup donner et Michel Albert travailla inlassablement à partager le plus largement possible sa culture économique. De ce point de vue, le succès éditorial du Pari français est un bon exemple. Le livre inspira Jean-Claude Guillebaud et Pascale Breugnod pour la réalisation d’un des premiers documentaires-fictions de l’histoire de la télévision française, présenté par Yves Montand en 1984 : Vive la crise ! Michel Albert n’hésita pas une seconde à participer à cette opération. Une fois à l’Académie, il prit l’initiative d’un autre ouvrage que l’Académie publia en 2007, avec une préface de ses deux anciens Premiers ministres — Pierre Messmer et Raymond Barre — La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse. Là encore, il souhaitait alerter l’opinion sur les effets pervers des idées généreuses dont le résultat était le chômage, l’échec scolaire et la difficulté d’insertion.
Le panorama ne serait pas complet si, avant de terminer, je ne rappelais le rôle de Michel Albert à l’Académie des Sciences morales et politiques. Il y entra en 1994 au fauteuil laissé vacant par Henri Guitton. Il la présida en 2004 et fut son Secrétaire perpétuel, juste avant moi, de 2005 jusqu’au 31 décembre 2010. En effet, à l’Académie, la perpétuité est toute relative. « Je suis en CDD » disait Michel Albert avec un franc sourire. Dans le Palais de l’Institut, chacun se souvient de sa gentillesse et de sa simplicité. Par exemple, il n’hésitait jamais à aider une employée — quelle que soit sa fonction — à porter un paquet trop lourd. De nombreux échos de la peine des membres du personnel de l’Institut et des Académies à l’annonce de son décès sont remontés jusqu’à moi. Je tenais à vous en faire part.
Certains verront peut-être une contradiction entre la simplicité d’âme et les honneurs de la République. Michel Albert ne les refusait pas et, sans doute, lui faisait-il plaisir. Il portait bien l’habit d’académicien comme cette photo le montre. Il était Commandeur de la Légion d’honneur et Grand Croix du Mérite. Mais, même si les honneurs ne lui déplaisait, il n’en fut jamais le dupe. Et je l’imagine bien, maintenant, me regardant de là-haut, croisant ses bras bien haut sur sa poitrine, l’œil pétillant, me dire : « Eh bien… Le roi n’est pas mon cousin ».
L’Académie n’était pas pour Michel Albert un honneur. Elle correspondait parfaitement à ses aspirations : le travail et l’échange dans des groupes restreints où chaque individu est considéré en lui-même pour ce qu’il est. À côté de l’Académie, Michel Albert participait à de nombreux autres groupes de réflexion plus spécifiques : le groupe Milleron, l’OCHRES, les EDC, ARRI, mais aussi les « Arthurs », groupe informel d’anciens collaborateurs. J’en oublie certainement beaucoup d’autres.
Devenu Secrétaire perpétuel, Michel Albert ne rechigna jamais devant les charges administratives — parfois bien ingrates — de la fonction, ni à la participation à de nombreux conseils d’administration ou comités de gestion. Notre Compagnie a profité de son esprit méthodique et opiniâtre dans son effort constant de modernisation.
Au terme de ce bref hommage où j’ai tenté de retracer à grands traits les principaux engagements de Michel Albert en faveur d’une humanité plus fraternelle, il convient d’écouter le portrait que fera Michel Camdessus, tant il est vrai que la vie publique de Michel Albert ne prend toute sa signification et sa cohérence qu’au regard de l’homme de cœur et de l’homme de foi qu’il fut.
Et, mon cher Michel, puisque tu es maintenant retourné auprès du Créateur, je suis certain qu’il a pour toi, le serviteur le mieux doté, un minimum de 10 talents.
Entre dans la joie de ton Seigneur.
« Adieux à Michel Albert » par Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France
Ma chère Claude,
Vous ses enfants et petits-enfants, sa famille,
Et vous tous, les amis de Michel,
Vous pleurez Michel, nous sommes tous dans le chagrin et sous le choc de son départ et voilà que la prière de l’Église nous le rappelle : la vie de Michel ne lui a pas été prise ; elle est changée… Lorsque vous m’avez demandé de dire quelques mots à la fin de cette cérémonie, vous saviez qu’il me serait impossible de parler de lui comme s’il n’était plus.
Avec Brigitte et certainement beaucoup de ceux qui vous entourent, nous le croyons vivant d’une autre vie, de plénitude celle-là. Le mieux est donc que je m’adresse à lui comme dans les rares occasions qu’il m’a donné, en cinquante années d’amitié fraternelle, de dire deux ou trois choses que je sais de lui, deux ou trois choses que j’admire chez lui. Au fond, elles se résument en une seule et je dirais, Michel, que tu peux passer ton éternité à rendre grâces à Dieu pour cela. Il a fait de toi, à travers tes origines et toutes les circonstances de ta vie, un de ces êtres si rares dans nos sociétés d’opulence, un homme de cœur et, par-là, d’abord un homme attentif aux autres, discernant leurs souffrances cachées, résolu à rendre notre monde moins cruel aux pauvres, aux chômeurs, aux migrants, par toutes les initiatives de ta vie. Clairement, l’homme établi que tu es devenu est resté de leur bord. Cela probablement venait de loin. Tu l’as confessé toi-même, toi si pudique, de la manière la plus publique qui soit. Quiconque aura ouvert ton « Pari français » se souvient de ses sept premières lignes : « Je suis né en 1930. L’année de la grande crise en Europe. Quatre ans plus tard, mon père qui était ‘domestique agricole’ en Vendée a dû émigrer avec sa famille. Il n’y avait plus de quoi le faire vivre avec sa femme et ses enfants sur la ferme où mes grands-parents étaient métayers. Toute mon enfance a été hantée par cette image de la crise, du chômage ; par cette cassure terrible de l’entre-deux-guerres qui a précipité le monde dans la catastrophe ». Ces origines-là sont restées comme le ferment de ta vie. De là je crois, chez toi, la générosité de ton esprit, la vigueur et la constance de tes engagements et ce serrement au cœur que l’on discerne chez toi devant tous les blessés de la vie. Jamais chez toi, ni l’expérience de la complexité des choses, ni la misérable insuffisance des moyens disponibles pour corriger l’intolérable, ni le scepticisme, ni le cynisme de ceux qui pourraient le réduire, ne t’ont empêché de percevoir dans les tableaux de chiffres que tu analyses si bien les palpitations d’humanité, jamais ils ne t’ont conduit à la résignation ; jamais ils ne t’ont amené à baisser les bras. Je t’ai connu, jusqu’aux derniers de tes jours, à l’affût de toute initiative nouvelle à lancer ou à soutenir pour que la société soit plus juste et le monde meilleur.
Dans les sources vives de l’homme de cœur que tu es, il y a évidemment aussi ta Foi. Tu n’en fais pas mystère, non plus.
Je me souviens de la gravité avec laquelle tu avais révisé le chapitre dans lequel nous essayions de confesser notre Foi commune dans un livre Notre Foi dans ce Siècle que nous avions décidé d’écrire avec Jean Boissonnat après trente années d’amitié sur des itinéraires si divers.
Cette Foi qui vous a habités, toi et Claude, aux jours de joie comme aux jours de peine, tu l’as toujours voulu plus réfléchie, éclairée par les expériences de tes divers engagements et plus éclairante pour ceux-ci. Je suis témoin, pour avoir eu la chance de t’y accompagner parfois, de ton travail auprès de divers groupements de chefs d’entreprises français et internationaux pour partager avec eux ce que tu avais si vite compris de la responsabilité du chrétien dans l’entreprise, de la dimension humaine de la corporate gouvernance, etc. Comment ne pas mentionner aussi toutes tes interventions dans le sillage des Semaines Sociales de France et la trace, dans tant d’écrits et tes innombrables conférences, des principes majeurs de la pensée sociale chrétienne. Primauté du bien commun, solidarité, subsidiarité, primat absolu de la dignité de la personne humaine – bref, chacun les connaît ici – y compris l’économie et la finance comme servantes de la société et non l’inverse. Ces principes ont fécondé ta pensée et tes analyses de l’économie moderne ; on les retrouve dans le diagnostic si lucide que tu portes sur elle, dans ta recherche constante de « sorties par le haut » et dans tous tes plaidoyers pour une économie sociale de marché, pour la réforme dans notre pays, si réticent au changement, et pour l’Europe, notre commun destin.
La réforme : elle est au cœur de tous tes engagements ; dès la première minute de ta vie de haut fonctionnaire, elle te mobilise et c’est le rapport Rueff-Armand que tu as écrit pour une bonne part. Puis ton aventure du Défi Américain et du Défi Français et de tant d’autres de tes écrits. Je ne veux m’arrêter qu’à l’un des tout derniers car j’ai perçu la force de conviction et l’ardeur qui t’amenaient à lancer cette bouteille à la mer. C’est l’ouvrage collectif que tu as porté sur les fonts baptismaux avec Marcel Boiteux et Gabriel de Broglie. Son titre, à lui tout seul, porte un diagnostic sans appel : « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse ». On croit t’y retrouver à chaque page et dans ces mots : « Ce traitement réservé à notre jeunesse est le véritable symbole – le pire, en fait, ajouterais-je – de nos dysfonctionnements ». En dépit de cela, aucun défaitisme chez toi ; les yeux fixés, en bon économiste, sur le moyen et le long terme, tu cherches, trouves et nous révèles, sous le désenchantement du quotidien, les pépites de l’Espérance.
Avec la réforme en France, l’Europe a été au centre de ta vie, de ta conviction, de ta constante militance. Je n’en dirai pas plus ; il y aurait, il y aura un jour un livre à écrire sur « ton » Europe. Je t’entends encore répéter cette conviction que l’œuvre européenne des Monnet, Schuman, Adenauer, de Gasperi « aura marqué le passage de la préhistoire à l’histoire humanisée des relations internationales ». Et, t’écoutant, je me disais que toi, tu en demeurais un inspirateur et un ouvrier.
Mais Michel, tu étais, pour nous tous, beaucoup plus qu’un homme engagé sur tant de chantiers pour tant de causes de l’homme ; tu étais fondamentalement et tout simplement un homme qui aimait les autres. Il ne me revient pas de dire l’époux et le père de famille que tu as été. Nous avons, pourtant, été tous éclairés par le rayonnement, l’ouverture et si souvent la gaieté de votre famille. Au-delà de ce cercle qui est celui de l’amour, tu rayonnes d’amitié. Tu es un ami incomparablement fraternel. Cette amitié est offerte et chacun peut s’y réconforter, s’y instruire, s’y édifier, sans limite aucune. Tu es à la disposition de chacun. Bertrand Badré me racontait hier matin que, il y a quelque vingt ans, au tout début de sa vie professionnelle, fasciné par ta culture et la richesse de ton expérience, chaque fois qu’il revenait à Paris, alors qu’il travaillait à Londres, il venait te voir à ton bureau, au Conseil de Politique Monétaire de la Banque de France. Rituellement alors, vous entrepreniez de faire – pendant parfois des heures – le tour du jardin du Palais-Royal et, insatiable, il t’interrogeait sur mille sujets. Bertrand occupe aujourd’hui un des plus hauts postes de la finance mondiale et il me dit que ces échanges ont été tout simplement décisifs pour lui à ces premières heures de sa vie professionnelle. Combien de jeunes gens s’engageant dans le service public ou dans le monde souvent impitoyable de la finance sont venus chercher conseil auprès de toi sur la manière de vivre ces métiers et d’y servir le bien commun, à la lumière de leur Foi ?
Ils sont devenus tes amis. Que tu es doué pour l’amitié, Michel ! Et comme tu sais partager ce bonheur-là ! Nous l’avons nous aussi partagé, savouré. Je ne connais pas beaucoup de moments de gaieté, d’abandon, de joie de l’esprit comparables à un repas avec Claude, toi et tel ou tel de vos innombrables amis.
Ce n’est pas par hasard qu’entreprenant d’écrire ensemble avec Jean Boissonnat et Jean-Claude Guillebaud, pour la circonstance notre éditeur, le livre dont je viens de parler, Notre Foi dans ce Siècle, nous avons décidé de le construire et d’en mettre au point le contenu – y compris vingt « utopies à réalisation vérifiable » – en quelques repas, les uns chez les autres…
C’était de la joie pure… tant de fois renouvelée. C’est ainsi que nous avons mieux discerné comment, dans l’amitié, ta qualité de cœur porte à l’incandescence l’accueil et le sens de l’admiration.
Sens de l’accueil ! Ton accueil aussi Claude. Je suis sûr que chacun de nous ici, ce soir, venu un jour sonner à ta porte, rue de Varenne, a fait la même rare expérience. Tu ouvres toi-même la porte et bras ouverts, les yeux pétillant de joie, un large sourire aux lèvres, tu nous accueilles. Je ne connais pas d’accueil comme le tien. Tu nous reçois comme si nous étions nous-mêmes un don merveilleux de nouveauté et de promesses pour toi, alors que c’est toi qui es là, donné sans réserves. Non pas don et contre-don comme diraient peut-être les anthropologues, mais merveilles de l’ouverture du cœur. Tu es tout entier dans ce simple geste, avec ta chaleur, ton indulgence, ton attente de l’autre… Évidemment, cet instant rare se prolonge tout au long de la rencontre et chaque fois, on ne rêve que de la poursuivre. Alors, je ne puis m’empêcher de te le dire, pendant tous ces jours de deuil, chaque fois qu’un mouvement de tristesse m’a étreint à la pensée de ton départ, j’ai pensé aux vers de Charles Péguy commentant les cinq premiers mots sublimes de la parabole de Luc : « Un Père avait deux fils… ». Je me suis remémoré cet extraordinaire tableau de Rembrandt, le « Retour de l’enfant prodigue » en haut du grand escalier de l’Hermitage, et je pensais à cette sorte d’étreinte par laquelle le Père t’aura accueilli, lui qui n’est qu’accueil, toi, l’accueil en personne…
À côté du don de l’accueil, Michel, il y a chez toi, par ailleurs si lucide, une capacité d’admiration qui colore entièrement ta rencontre de l’autre. Elle est un autre de ces dons que tu as reçus. Il y a chez toi, oui, une capacité d’admiration, d’enthousiasme devant ce que tu perçois – même simplement à l’état de promesse – de constructif, de beau, de bon, de bien chez les autres, qui est unique.
Ton admiration devant tout ce qui est beau n’est pas celle de l’esthète qui, très légitimement se délecte de ce qu’il sait voir ; elle est celle de l’homme pour qui admirer est une joie qui va souvent jusqu’à l’émerveillement et qui, dite comme tu sais le faire, avec les mots du cœur, aide à grandir. Se sentir ainsi reconnu par toi est comme un élan reçu. Combien de jeunes – et de moins jeunes – se sont senti ainsi amenés à se dépasser, puisque c’est comme cela – plus grands qu’eux-mêmes – que tu les voyais. Comment n’insisterai-je pas là-dessus ! Nous avons six enfants ; cinq sont des artistes ou de quelque manière des créateurs ; ils ont tous reçu cet encouragement de ton admiration. L’un d’entre eux, Thibaut, nous écrivant pour nous dire qu’il partageait notre peine à la suite de ta mort, concluait son email ainsi : « L’élégante bienveillance de Michel, sa curiosité intellectuelle faisaient de lui un miroir toujours embellissant pour les projets qu’il nous demandait de lui présenter. Face à l’inconnu de sa mort, son souvenir nous inspire un sourire confiant. Ceci est déjà une très belle preuve de son éternité ».
J’ai été très touché par ce rapprochement entre émerveillement et éternité. Il m’a amené à me dire que cette capacité d’émerveillement était probablement la pointe la plus haute de ce qui fait l’homme, cette pointe où l’Amour et l’humilité, l’oubli total de soi se rencontrent dans l’admiration et l’action de grâces. Heureux es-tu Michel, qu’elle t’ait été donnée ; heureux es-tu de l’avoir cultivée ; heureux es-tu qu’elle ait fait de toi l’époux, le père, le grand-père, l’ami que tu as été ; heureux es-tu qu’elle ait nourri ton espérance dans un monde meilleur et ton ardeur à le transformer. Oui, heureux es-tu, toi qui t’es laissé si souvent émerveiller et qui, aujourd’hui, est passé dans la Lumière de Dieu, lumière dont la bible nous dit que Dieu prend bien garde d’éviter qu’elle ne soit éblouissante et qui n’est qu’émerveillement pour toujours. Alors, s’il te plaît, répands ces qualités de cœur et ce don de l’émerveillement un peu plus parmi nous, dans ce monde dont toutes les forces du mal s’acharnent à nous cacher les merveilles ; obtiens-les pour tes frères chrétiens qui ont du mal à croire qu’ils seront un jour, comme toi, empoignés par Jésus-Christ, leur Sauveur, et emportés par Lui pour l’éternité dans cette Lumière. Donne-leur l’espérance vive de cet émerveillement et à tes amis qui, pour l’au-delà de leur vie, n’imaginent que vide, néant, sommeil peut-être, suggère-leur d’envisager au moins l’hypothèse de cet émerveillement. Comme toute ta vie, cette hypothèse leur fera du bien. Pour toi, c’est ça le Salut.
Salut, Michel.