Mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier 2006
L’événement climatique est d’une part vécu (il doit être enduré et traversé), d’autre part il suscite des interrogations. Aux siècles du classicisme et des Lumières on réfléchit à la théorie des climats, on s’intéresse à l’histoire des cataclysmes ayant bouleversé la planète dans un passé lointain. Des hypothèses nouvelles sont proposées au sujet du rapport entre l’homme, la nature et, éventuellement, le surnaturel.
Les mêmes événements donnent lieu à des représentations en littérature et dans les arts qui portent, à leur façon, témoignage des interrogations et des inquiétudes contemporaines. La tempête et l’orage sont des objets de description dramatique ou pittoresque particulièrement en faveur, propres à nourrir de façon privilégiée la réflexion sur l’expression des passions. Dans les représentations offertes par les artistes, les deux plans psychologique et cosmique semblent se répondre : le désordre exceptionnel du monde (cataclysme météorologique) offrirait le reflet extériorisé des désordres passionnels des acteurs humains. Souvent la tempête est à l’image des tumultes du cœur et, parce qu’elle revêt des caractères désordonnés excessifs et paroxysmiques, suscite des questions essentielles : Que va-t-il succéder à ce désordre ? Assistera-t-on immanquablement à la fin du chaos et au retour au calme rassurant, image d’une raison finalement triomphante ? En outre, il serait bon de traiter quelque peu du problème des fluctuations climatiques et météorologiques, sur le mode factuel, à l’époque envisagée.
De grands problèmes techniques ne cessent d’être examinés : comment la musique, qui est harmonie, peut-elle manifester le bruit discordant ? Comment la peinture, qui joue de la lumière et des couleurs, exprime-t-elle l’angoisse de l’assombrissement ? De quels tours rhétoriques le poète désireux d’imiter son objet chaotique, débordant de toute proportion décente, se servira-t-il ? Les différentes réponses proposées reflètent la palette diversifiée des conceptions esthétiques concurrentes. Le XVIIe siècle hérite d’une acceptation ancienne du sublime. Mais le XVIIIe siècle accueille des innovations venues d’Angleterre : à la faveur d’une sensibilité nouvelle et d’émotions requalifiées (le « beau terrifiant », l’« horrible exquis ») s’expriment de nouvelles aspirations (mais aussi des inquiétudes : il se prépare sur le plan politique un « cataclysme » sans précédent, la Révolution, aussitôt « pensée » à l’aide de la métaphore de la tempête). Mais si ces représentations littéraires, musicales et picturales connaissent une telle faveur, c’est aussi parce qu’elles sont associées à d’autres interrogations sollicitées par des expériences bien réelles. Avant de faire l’objet d’une symbolisation, l’événement naturel violent survient dans l’histoire moderne, contemporain d’une réflexion philosophique particulièrement vive sur le Déluge biblique, les déluges hypothétiques de l’Histoire et la théorie des climats.
Le grand colloque international de Paris qui réunit une quarantaine d’historiens du climat et d’autres spécialistes européens des sciences humaines (français, italiens et suisses) étudiera la succession d’approches et de définitions de l’« événement climatique » du XVIIe au XIXe siècle, d’une part, et les résonances problématiques de celles-ci dans les lettres, la musique et la peinture, où les formes canoniques et les genres constitués connaissent de grands bouleversements.
Mercredi 18 janvier 2006
Paris III – Sorbonne nouvelle,17 rue de la Sorbonne, Paris Ve,
Salle Bourjac, galerie Rollin …
Après-midi sous la présidence de Pierre Hartmann,
(Université de Strasbourg)
Dans la peinture
- Propos de bienvenue par Gilles Declercq, vice-président de l’Université, président du Conseil scientifique de Paris III.
Jacques Berchtold, Jean-Paul Sermain et Emmanuel Le Roy Ladurie - René Démoris (Paris III-Sorbonne nouvelle),
Les tempêtes de Poussin - Elisabeth Lavezzi (Paris III-Sorbonne nouvelle),
Les carnets de Léonard de Vinci - Madeleine Pinault-Sorensen (Musée du Louvre),
Œuvres et écrits d’artistes sur les tempêtes et les orages, XVIIe-XVIIIe siècles - Michel Delon (Paris IV-Sorbonne),
Tempêtes peintes, de l’ex-voto à Géricault - Maria-Susana Seguin (Université de Montpellier),
Passions humaines, passion divine : le déluge universel dans l’art au XVIIIe siècle - Pierre Frantz (Paris IV-Sorbonne),
Diderot, Dorval, tempêtes et passions. La représentation de la création
Jeudi 19 janvier 2006
Fondation Singer-Polignac – 43, avenue Georges-Mandel – Paris XVIe
Tél. : 01 47 27 38 66 – Fax : 01 53 70 99 60
Dans la limite des places disponibles
Climatologie et Histoire
Matinée sous la présidence de Daniel Roche
- Emmanuel Le Roy Ladurie (membre de l’Institut),
La Révolution française et le climat (1787-1795) - Andrée Corvol (CNRS, Institut d’Histoire moderne et contemporaine), Tempêtes sur la forêt française (XVIIe-XIXesiècles)
- Valérie Daux (Paris VI),
Dates des vendanges et climat dans la France du Nord (XIVe-XIXe siècles) - Jean-Pierre Legrand (Institut National des Sciences de l’Univers),
Vendanges, anciens instruments et reconstitution du climat - Anouchka Vasak-Chauvet (Université de Poitiers),
L’orage du 13 juillet 1788, la tempête du 18 Brumaire an IX : l’inscription du politique dans le météorologique
Après-midi sous la présidence d’Emmanuel Le Roy Ladurie
- Luca Bonardi (Université de Milan),
Gelées, verglas et sécheresses d’Ancien Régime. Climat et économie en Italie du Nord (1730-1789) - Frank Lestringant (Paris IV-Sorbonne),
Tempêtes avec spectateur, motif évangélique et humaniste - Jean-Paul Schneider (Université de Strasbourg),
De l’orage châtiment au chaos maîtrisé - Claude Reichler (Université de Lausanne),
L’air et les météores au tournant du siècle. Une fascination multiple (sciences, voyages, peinture, littérature) - Jean-Patrice Courtois (Paris VII-Denis Diderot),
Le climat des philosophes de Montesquieu à Rousseau
Discussion générale et conclusions.
Vendredi 20 janvier 2006
Centre Censier de Paris 3– Sorbonne nouvelle, 13 rue Santeuil, Paris Ve,
salle Las Vergnas.
Climats, orages, tempêtes dans la lyrique et la musique
Matinée sous la présidence de Philippe Hamon
- Bernard Francou (laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (Grenoble)
Le recul des glaciers au niveau mondial depuis le Petit Âge Glaciaire : contexte climatique planétaire et régional. - Jean-Louis Haquette (Université de Reims)
Du pittoresque au méta-physique: l’orage et la tempête dans la poésie descriptive du XVIIIe siècle (I) - Jean-Noël Pascal (Universié de Toulouse),
Du pittoresque au métaphysique: l’orage et la tempête dans la poésie descriptive du XVIIIe siècle (II) - Bernard Böschenstein (Université de Genève),
Quatre sommets de la poésie et poétique allemandes des orages : Klopstock, «Die Frühlingsfeier» ; Goethe, «Wandrers Sturmlied» ; Hölderlin, «Wie wenne am Feiertage…» ; Kleist, «Penthesilea»
- Pierre Hartmann (Université de Strasbourg),
Du « Sturm und Drang » au classicisme: orages et tempêtes dans l’œuvre de Joseph Haydn
Après-midi sous la présidence d’Alain Corbin (Paris I)
- Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse),
De l’art tragique d’évoquer les tempêtes : Idoménée, de Campra à Mozart - Arto Clerc (Université de Genève),
Tempêtes libertines et naufrages spirituels dans les romans du XVIIe siècle
Récits
- Nathalie Vuillemin (Université de Neuchâtel),
Quelques aspects d’un «instrument dramatique» : orages et tempêtes en haute montagne chez les premiers voyageurs du Mont-Blanc - Christophe Martin (Université de Rouen),
Femmes, orages, tempêtes dans quelques romans français du XVIIIe siècle
Samedi 21 janvier 2006
Paris III – Sorbonne nouvelle,17 rue de la Sorbonne, Paris Ve,
Salle Bourjac, galerie Rollin …
Matinée sous la présidence de René Démoris
Représentations littéraires – Roman et récit
- Henri Lafon (Paris III-Sorbonne nouvelle),
La bienfaisance par gros temps. À propos de quelques sauvetages romanesques - Jean-François Perrin (Université de Grenoble),
Tempête parodique et passion contrariée dans un conte d’Antoine Hamilton - Marc Labussière (Paris III-Sorbonne nouvelle),
Les tempêtes dans les romans de l’abbé Prévost: une réflexion sur les conditions de l’émotion esthétique - Geneviève Goubier-Robert (Université d’Aix-en-Provence),
Le tempétueux et l’intempestif chez D.A.F. de Sade
Après-midi sous la présidence de Claude Reichler
- Françoise Gevrey (Université de Reims),
Deux amis dans les tempêtes: de Saint-Lambert à Diderot - Florence Magnot-Ogilvy (Université de Montpellier),
Dire ou ne pas dire la tempête : le topos et sa critique dans les romans du XVIIIe siècle - Aurelio Principato (Université de Milan),
Tourmente ou déluge : métaphores révolutionnaires chez Chateaubriand - Béatrice Didier (École normale supérieure, rue d’Ulm),
Descriptions de tempêtes dans l’œuvre de Chateaubriand
Pour conclure :
- Philippe Hamon (Paris III-Sorbonne nouvelle),
Baromètres, caoutchoucs, parapluies et macintosh: la prosaïsation de la tempête au XIXe siècle






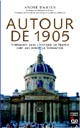

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.