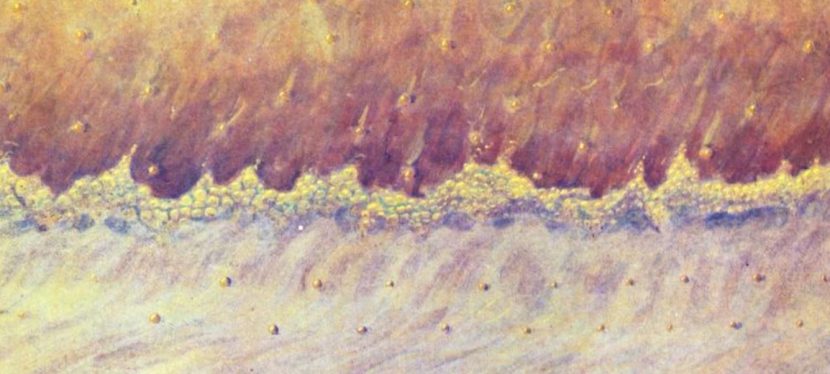Séance ordinaire du lundi 11 avril « Sauver ? », sous la présidence de Rémi Brague Président de l’Académie des sciences morales et politiques
Se sauver du salut pour une sotériologie philosophique
Paul Colrat docteur ès lettres, professeur agrégé de philosophie dans un lycée français à Beyrouth
Télécharger le texte de la communication
« Quatre synonymes au moins, à ne considérer que les mots disparus, expriment le fait de sauver ou d’être sauvé : sauvation, sauvement, saufeté et salvation. Tous étaient fort anciens, de beaucoup antérieurs au XVIe siècle »[2].Huguet précise qu’il existe même deux mots « salvation » en français : « Mais le mot salvation que nous rencontrons au XVIe siècle n’est pas celui de l’ancien français. Son emploi n’est dû qu’à l’influence latine ». On peut interpréter cette remarque en disant qu’il y aurait non pas un mais deux mots « salvation » en français, l’un savant s’appuyant sur le latin religieux salvation et un autre usage non religieux, que l’on trouve d’ailleurs dans la première occurrence disponible datant de 1350 dans la chanson de geste Beaudoin de Sebourg[3]. La langue ici est un symptôme, d’abord de la dualité de sens, religieux et immanent, de la salvation. Ensuite la langue est un symptôme de la réduction du champ possible de la sotériologie, qui s’est comme contracté sur le salut[4] alors qu’il y avait au moins trois autres mots pour dire le phénomène de ce qui sauve : sauvation, sauvement et salvation, et un mot pour dire le lieu du phénomène en question, la sauveté. Ces trois mots de sauvation, sauvement et salvation ouvrent la sotériologie à un champ plus large que la seule survie après la mort. Quoique « sauvement » mériterait qu’on s’y attache, tant sa nature adverbiale permet bien de penser que ce qui sauve n’est pas un objet ni un sujet[5], je retiens seulement le mot de salvation, qui nous est le plus naturel, précisément parce qu’il est encore présent en anglais. La sotériologie philosophique ne se limite pas à l’analyse du salut, elle est la théorie de la salvation.
1- Dignité philosophique de la sotériologie
Si l’on admet que la salvation n’est pas nécessairement la survie de l’âme après la mort mais l’écart avec la destruction, alors la sotériologie peut être constituée comme discipline philosophique, distincte de ce que la théologie appelle « sotériologie ». Il faut donc commencer par établir que la salvation est une question irréductiblement philosophique.Arguments pour l’irréductibilité de la question de la salvation
Le premier argument pour défendre l’idée que la salvation a une dignité philosophique est semblable à l’argument classique contre le relativisme : qui veut dire que la vérité n’existe pas présuppose qu’il dit une vérité, de même, qui veut se sauver du salut confirme que se sauver est l’objet d’une recherche irréductible. Ainsi celui qui dirait qu’il faut « se sauver de nos sauveurs » afin de lutter contre les figures pastorales du pouvoir ne dirait pas qu’il faut abandonner la recherche de salvation, mais qu’il faut la libérer des figures pastorales afin de penser une salvation populaire autonome, une révolution sans chef révolutionnaire. On peut voir un témoignage de cette irréductibilité de la question de la salvation dans l’œuvre d’un important philosophe contemporain, Tristan Garcia, qui précise dans son grand ouvrage, Forme et objet qu’il veut échapper à la question du salut[6], puis dans un récent livre d’entretien, L’architecture du possible, que « la pensée sauve » et que « l’idée de salut » est « l’horizon de la pensée » (p. 166) [7]. Au-delà de la simple contradiction formelle, on pourrait voir là la recherche d’un autre salut, ce que j’appelle la salvation, contre l’idée que le salut serait l’éternelle conservation à l’identique d’un même état. La salvation serait alors non pas ce qui produit une conservation mais au contraire ce qui laisse être les choses. De manière générale il me semble frappant que l’histoire de la philosophie depuis Nietzsche, disons depuis le début de la fin de la métaphysique, est marquée par la recherche d’une autre manière de définir la salvation, précisément contre la figure métaphysique du salut comme éternité. Ainsi Nietzsche critique l’éternité métaphysique comme forme de mort, car elle est un état perpétuellement identique à soi-même alors que la vie est au contraire une création permanente, mais il recherche précisément un éternel retour ; Heidegger critique lui aussi l’éternité et définit le Dasein par l’être-vers-la-mort, mais en même temps cherche un abri face à la dévastation technique ; Derrida décrit les ambivalences du pharmakon, et finit son œuvre par une recherche intense d’une messianicité sans messianisme. Le deuxième argument en faveur de l’irréductibilité de la question sotériologique en philosophie est qu’elle est elle-même est une recherche de salvation, car elle commence non par un naïf désir de connaître, mais par l’épreuve d’un mal. Ce mal peut être simplement l’épreuve d’une aporie, c’est-à-dire de ce qui empêche d’avancer. Elle n’est pas une gratuite jouissance de concepts mais un geste de se sortir d’une mauvaise passe, d’une route sur laquelle un obstacle empêche de passer. La philosophie commence certes par un désir et une amitié, mais celles-ci s’éprouvent dans un mal commun. Outre l’enchaînement des prisonniers de la caverne, ce mal peut être celui de la « torpeur », imposée par les questions de Socrate comparée à une torpille marine[8]. Aristote dans la Métaphysique dit que l’on ne trouve la science que si d’abord on en passe par le lien, le nœud, le δεσμός, de l’aporie, ce qui signifie que la découverte de la vérité est en même temps une déliaison ou une délivrance, λύσις[9]. Al Ghazali présente l’origine de ses recherches dans La délivrance de l’errance comme un certain « mal – داء », précisément une « errance – ضَلَال » et la recherche d’un « remède – علاج », qui correspond à une « sécurité – أمن », ce qui est atteint une fois que Dieu a guérit (شفي) celui qui était atteint de cette maladie qui n’est pas seulement l’erreur mais l’errance, définie comme l’incapacité de savoir si la raison peut dire la vérité[10]. Ce mal initial peut être l’objet d’une décision, être un mal que l’on décide de s’infliger, comme Descartes qui pour « établir quelque chose de ferme et de constant[11] dans les sciences – aliquando firmum & mansurum cupiam in scientiis stabilire » affronte un certain « péril », celui de « détruire généralement [ses] anciennes opinions – generali huic mearum opinionum eversioni » toutes ses anciennes opinions, ce qui implique la « ruine des fondements – suffossis fundamentis »[12], la suffossis n’étant pas n’importe quelle ruine, mais une ruine intérieure, désignant l’action de creuser par en-dessous ; cette ruine initiale peut être créée par l’imagination, ainsi Descartes, pour commencer à philosopher crée une figure maléfique, « un certain mauvais génie – genium aliquem malignum », faisant de l’absence de certitude un équivalent du mensonge, et faisant des « ténèbres » le point de départ de la recherche. Le mal initial peut être une dispersion, comme chez Hegel qui voit la naissance de la philosophie dans le « besoin » d’une certaine « victoire », définie pour la pensée comme « la résolution de ses propres contradictions »[13]. Et le mal initial peut être au contraire l’identité, Nietzsche présente Zarathoustra comme celui qui lutte contre une maladie qui est précisément la recherche de l’éternité, c’est-à-dire de l’identité à soi, d’où l’éloge du danger, donc de ce qui altère, qui donne une certaine salvation[14] et qui fait d’une blessure le point de départ de l’écriture : « De tout ce qui est écrit, je n’aime que ce qu’on écrit avec son sang »[15]. Nous verrons plus loin que la question de la salvation est une voie de réinterprétation de l’être et de la pensée. Dire qu’une chose est c’est déjà dire qu’elle s’est échappée du néant, donc en un sens qu’elle est sauvée, avant même d’être. Dire qu’une pensée parvient à une vérité c’est dire qu’elle s’est libérée de l’erreur première qui l’enserrait. Si l’on admet que l’erreur est première sur la vérité et que le néant précède l’être, alors la vérité et l’être sont à partir de la salvation. La salvation désigne ce point de transmutation impossible du néant à l’être et de l’erreur à la vérité.Formes de salvation
Si l’on admet l’irréductibilité de la question de la salvation, il faut en plus reconnaître des formes de la salvation si l’on veut que la sotériologie soit ancrée dans la tradition philosophique. On peut décrire a priori trois grands phénomènes de salvation : la protection, la guérison et la fuite. Je dis à la fois a priori et « phénomène », ce qui peut paraître contradictoire, car on est habitué depuis Kant à distinguer le phénomène de l’a priori à partir duquel on en fait l’expérience. Pourtant Platon proposait d’étudier ce qu’il appelait des « paradigmes » qui sont précisément des phénomènes a priori, c’est-à-dire des phénomènes qui permettent de comprendre d’autres phénomènes, non pas des formes pures sans aucun contenu comme la forme du temps et de l’espace ou comme la pure quantité, mais des phénomènes simples qui permettent de comprendre des phénomènes plus complexes, comme l’apprentissage de la lecture part de l’apprentissage d’une syllabe[16]. Les phénomènes de salvation deviennent des paradigmes, on parlera ainsi de protection dans d’autre contexte que le militaire, par exemple de la protection des données ou de la civilisation, mais on voit que le contexte militaire laisse une trace. De même on parlera de guérison même lorsqu’il n’est pas question de santé au sens littéral, bien sûr de guérison de l’âme lorsqu’elle cherche son salut mais aussi lorsqu’un pouvoir représente une menace comme une « infection », pour indiquer qu’il ne s’agit pas seulement de la repousser mais de l’éliminer. Ainsi, par exemple, Bachar El Assad qui le 20 juin 2011, qualifiait une partie de ses opposants de « virus qui infectent le corps syrien »[17] précisément pour indiquer son projet d’extermination. De même le paradigme de la fuite sert à qualifier aussi bien des attitudes de retrait spatial que psychologique quand il qualifie le déni. La protection consiste à maintenir le mal en dehors de soi, par exemple politiquement lorsque l’ennemi attaque la cité, à le maintenir en dehors, par des remparts, ou à le repousser par des armes. J’ai proposé dans mon travail de thèse de lire sotériologiquement l’Illiade comme le récit de l’échec de la protection, les remparts finissant toujours par céder, les armes ne suffisant pas à sauver. « J’ai alors, moi, pour les Troyens, bâti autour de leur cité une large et superbe muraille, qui rend leur ville inexpugnable », dit Poséidon au chant XXI de l’Iliade ; mais le rempart n’est pas « inexpugnable – ἄρρηκτος » et Homère fait de la chute du rempart un thème poétique, comme en témoignent les expressions récurrentes telles que « franchir – ὑπερθρῴσκω » le mur, « sauter le mur – τεῖχος ὑπερβαίνειν », « passer le mur – δύοντο δὲ τεῖχος », « enlever le rempart – τεῖχος ἐξαλαπάζω », ou encore « le mur achéen a croulé – ἐρέριπτο δὲ τεῖχος Ἀχαιῶν »[18], et cela devient l’occasion d’une magnifique description au chant XII, chant que Platon appelait « le combat des murs »[19], la description de la chute du teichos des Achéens :« Il fait de la sorte sauter les pivots et, tandis que la pierre, de tout son poids, retombe à l’intérieur, la porte terriblement mugit, les barres cèdent, les vantaux éclatent en tous sens sous l’élan de la pierre ; et l’illustre Hector s’élance à travers. Son aspect est celui de la nuit rapide. Il luit de l’éclat terrible du bronze qui vêt son corps et il tient deux lances au poing. Nul, sauf un dieu, n’oserait l’affronter, pour chercher à l’écart des nefs, au moment qu’il franchit la porte. Le feu flambe dans ses yeux. Lors, se tournant vers la foule, il crie aux Troyens l’ordre de sauter le mur. Ils obéissent à l’appel »[20].La guérison consiste à faire sortir le mal de soi. La maladie n’est plus l’idée d’une menace mais d’une détérioration en cours, du moins d’une altération du corps. La définition spontanée de la santé serait de revenir à un état non-altéré du corps, par une simple expulsion du mal, une purge. Notons que déjà la notion de purge consiste à se sauver du mal par un autre mal, la drogue ingurgitée causant elle aussi un trouble dans le corps. On voit bien cet usage du mal pour guérir dans la notion du catharsis chez Aristote dans la Poétique : c’est en faisant usage de l’image du mal que l’on peut purifier la cité de ses passions mauvaises, en particulier la terreur et la pitié. Bien sûr, un tel retour du corps à un état non altéré est impossible, d’abord parce que le corps a toujours déjà été altéré, par exemple par les bactéries qui permettent son bon fonctionnement digestif, et ensuite parce qu’il est, du fait de son existence temporelle, en état d’altération continue jusqu’à la mort, enfin parce que la maladie laisse des traces, comme le rappelle la notion récente de « Covid long ». La fuite consiste à changer d’espace lorsque le mal arrive. La fuite est un paradigme double dans la mesure où il désigne à la fois l’acte même de fuir, par exemple je pars de cette salle en courant, et le fait de fuir, par exemple dire que le lavabo fuit, ce qui ne veut pas dire qu’il part de la maison mais qu’il laisse passer de l’eau. La fuite est ainsi l’écart que l’on prend avec quelque chose, l’acte de mettre une distance entre soi et un mal, et le fait de laisser passer ce qui devrait être contenu. La fuite est le paradigme sotériologique opposé à celui de la protection, car celle-ci repose sur le maintien en l’état d’une situation, alors que la fuite consiste en un écart. La libération peut être conçue comme une espèce comprise dans le paradigme de la fuite car elle est une manière de s’écarter d’un mal. Je disais plus haut que la salvation n’est pas un objet parmi d’autres de la philosophie, car elle se pense elle-même comme salvation. Le paradigme le plus connu est celui de la libération des chaînes, la pensée étant une forme de déliaison : ce que l’on voit dans le mythe de la caverne et dans la fuite vers l’Un chez Plotin jusqu’à la « ligne de fuite » chez Deleuze. Chacune de ces trois formes de salvation implique une limite, suivre l’une de ces trois voies de salvation conduit à partir d’un certain seuil à une aporie par laquelle la salvation se transforme en destruction. L’aporie de la protection c’est qu’elle conduit à l’isolement ; l’aporie de la guérison c’est qu’elle combat une altération par une altération ; l’aporie de la fuite c’est que s’échappant de la vie et de l’être elle soit une autre forme de mort. La salvation n’est ainsi pas réductible à l’une de ces formes, elle joue en elles jusqu’à un certain seuil, mais si ce seuil est dépassé elle se retourne en son contraire, en destruction. On pourrait dès lors réfléchir au paradigme sotériologique qu’une philosophie se choisit pour se penser elle-même et le sens que cela implique. Il n’est ainsi pas la même chose qu’une pensée se représente comme ayant pour but une protection, une guérison ou une fuite.
Paradoxes de salvation
J’appelle paradoxe de salvation la manière dont la salvation ne se donne pas simplement mais par son contraire. La salvation n’est ainsi pas une simple conservation à l’identique d’une chose qui n’aurait qu’à persévérer dans son être, par soi. La salvation se donne dans l’élément de son contraire, ce qui peut se formuler par trois propositions sotériologiques : 1 / La corruption sauve, le salut corrompt (paradoxe selon la cause). L’idée qu’il faut une certaine destruction pour se sauver se trouve dans la notion de sacrifice, qui est certes une notion religieuse mais qui a des usages philosophiques, par exemple rapproché de la notion de dépense chez Georges Bataille ou de bouc émissaire chez René Girard, et bien sûr avant eux chez Hegel. On trouve même ce paradoxe en économie avec la notion de destruction créatrice en économie pour définir le capitalisme chez Joseph Schumpeter. Enfin on trouve paradoxe sotériologique dans le symbole de la Croix, cette mort qui annonce la résurrection. Il s’agit d’un paradoxe dangereux dans la mesure où il peut conduire à des manières de justifier le mal. Cela se montre par sa proximité formelle du avec le néo-darwinisme nazi : dans les deux cas il s’agit d’un mal pour un bien, d’une mort pour une vie, de la mort du faible pour une nouvelle vie. Ce paradoxe sotériologie a un symétrique, l’idée que le salut corrompt, que l’on trouve dans le jugement éthique sur des manières indignes de survivre au détriment des autres, ou dans la critique écologique des moyens par lesquels la civilisation capitaliste a assuré sa subsistance. 2 / L’événement fait subsister, la subsistance annihile (paradoxe selon la modalité). On trouve l’idée que l’événement fait subsister dans le domaine théologique à travers le concept de création continue. Chez le pseudo-Denys l’Aréopagite, c’est une création qui fait subsister le monde, la subsistance des choses leur est donnée par ce qui est hyperousia, au-delà de la substance. Ainsi la puissance suressentielle « conserve (diasôzein) les rangs (taxeis) de l’univers et leur droite aspiration à leur bien propre ; elle maintient indemnes (diaphulattei) les vies immortelles des hénades angéliques ainsi que les essences des cieux, des luminaires et des astres et leurs ordres immuables ; elle donne aussi à la durée de pouvoir être »[21]. La subsistance est donnée par ce qui est au-delà de la subsistance. Descartes rapproche encore plus clairement les concepts de création et de conservation dans la troisième des Méditations métaphysiques :« En effet, c’est une chose bien claire et bien évidente (à tous ceux qui considéreront avec attention la nature du temps), qu’une substance, pour être conservée dans tous les moments qu’elle dure, a besoin du même pouvoir et de la même action, qui serait nécessaire pour la produire et la créer tout de nouveau, si elle n’était point encore. En sorte que la lumière naturelle nous fait voir clairement, que la conservation et la création ne diffèrent qu’au regard de notre façon de penser et non point en effet »[22].Les choses doivent leur subsistance à une création continue. Le paradoxe est à son comble dans le domaine politique à travers l’idée de révolution, qui est l’événement qui établit la justice, donc l’ordre véritable. A l’inverse la recherche de subsistance, au sens d’identité d’un même état est définie comme corruption par Nietzsche car l’identité à soi est en fait la mort ; or l’éternité est une forme d’identité à soi ; donc la recherche de l’identité qui anime la « métaphysique » est en fait une maladie, car elle est une recherche de sa propre mort – de sa mort par le propre. 3 / Le désœuvrement œuvre au salut, l’œuvre détruit (paradoxe selon la volonté). L’idée que l’œuvre détruit est claire dans la critique de la technique comme arraisonnement du monde, c’est-à-dire comme réduction de ce qui se donne dans la nature à des paramètres et des modèles. En ce sens le monde que l’homme se fabrique détruit ses propres conditions d’existence, plus il perfectionne son œuvre dans le monde, plus il se détruit potentiellement (catastrophe climatique, représenté par de nombreux films comme Don’t look up) et même tendanciellement donc déjà effectivement (destruction de la biodiversité). La racine de ce schéma se trouve peut-être dans la critique de l’affairement (polupragmosyné), dont on trouve certes un relatif éloge dans le discours de Périclès restitué par Thucydide[23], mais que l’on trouve critiqué chez Platon à travers la vie que se choisit Ulysse à la fin de la République, la vie de l’ ἀπράγμονος, le désœuvré ; on en trouve une forme dans le prologue de Gargantua, qui définit Socrate par le « déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent ». A l’inverse de l’affairement, on trouve le paradoxe symétrique dans la proposition selon laquelle le désœuvrement œuvre au salut. Chez Aristote c’est dans le loisir de la contemplation que l’on peut devenir éternel, athanatizein[24]. Chez Blanchot le désœuvrement est élevé au statut non plus de but réservé à l’élite citoyenne mais au statut de fait, il a eu lieu à travers ce qu’il appelle le « désastre »[25]. Désœuvrement, déprisement et désastre, tracent les contours d’une salvation qui ne passe pas par la fabrication, la maîtrise et la recherche d’un but transcendant.
2. Une première thèse : immanence de la salvation
La distinction entre la salvation et le salut n’est pas seulement une mesure de protection contre l’accusation d’introduire la théologie dans la philosophie, elle provient de la dimension immanente et première de la salvation, alors que ce que l’on entend par le salut est transcendant et final. Les paradigmes du salut sont des phénomènes immanents, ce n’est pas d’abord dans l’au-delà qu’ont lieu des protections, des guérisons ou des fuites.a. Le répit
L’immanence de la salvation s’approche d’abord par notre état de non-mort. Nous sommes non-mort et non seulement vivants car la mort, comme la montré Heidegger dans Etre et temps n’est pas l’après de la vie mais elle détermine déjà la vie, car elle ce qui détermine son ouverture à l’impossible, donc à l’événement. Autrement dit, et cela contre Heidegger, vivre c’est être-en-répit, l’imminence de la mort implique l’immanence d’une salvation. Que nous soyons des êtres-vers-la-mort implique déjà que nous ne soyons pas encore mort ; cette vie qui nous reste est un écart avec la mort donc en ce sens une salvation. La salvation est un reste, l’être-vers-la-mort est un être-en-reste, il ne subsiste pas identique à soi mais dans le lambeau de vie qu’il arrache à chaque instant à la mort qui guette, à l’égard de laquelle il a un certain « devoir » du fait de son caractère inéluctable. Cette existence en répit se donne à sentir par le soulagement que nous ressentons quand d’autres sont frappés par la catastrophe ; certes nous ressentons l’angoisse que cette mort nous arrive aussi et pourquoi pas la compassion à l’égard des autres victimes, mais nous ressentons aussi notre privilège d’être encore en vie. Lucrèce écrit ainsi : « Il est doux, quand sur la grande mer les vents soulèvent les flots, d’assister de la terre aux rudes épreuves d’autrui : non que la souffrance de personne nous soit un plaisir si grand ; mais voir à quels maux on échappe soi-même est chose douce ». Le soulagement est un sentiment sotériologique, dans la mesure où il marque un contact avec ce qu’il y a de sauf en nous. Or le soulagement peut être défini comme le sentiment immanent à notre mortalité, que nous soyons mortels signifie en même temps que nous sommes soulagés de ne pas être morts ; en même temps que l’angoisse nous révèle que la mort vient comme l’impossibilité de toutes nos possibilités, le soulagement nous révèle que notre existence est en répit, qu’elle est sauve de cette mort qui vient. Ce n’est pas une pure positivité, ce n’est pas juste que nous sommes en vie, c’est que nous sommes non-morts ; le sauf est cette double négation qui ne coïncide pas purement avec une affirmation. Cette double négation n’est pas une « relève » car la mort reste l’horizon, rien n’est dépassé, elle est la logique du reste. Notre existence est en reste de la mort qui déjà fait son œuvre par l’angoisse qu’elle nous impose. La sotériologie est l’analyse du reste, ou mieux, de la résistance du reste. Le reste se distingue de l’être des métaphysiciens car il ne subsiste pas par lui mais par la négation de ce qui a manqué de le détruire, de la menace qui le guette, de la destruction qui vient toujours à la fin. Le reste est la négation du mal. Définir les choses comme des restes c’est faire de cette double négation la racine de toutes choses.b. La respiration
Dans l’immanence, la salvation se donne de manière continue, ou plutôt rythmée, par le phénomène de la respiration. La salvation qui se donne à travers la respiration est une pulsation de relève et non une relève finale qui accomplirait notre être. Notre corps se relève en permanence et en même temps de manière discontinue, inspiration/expiration, de la torpeur de la mort qui nous achèverait en quelques instant sans ce rythme salutaire. Lorsque nos poumons font rentrer l’air dans notre corps il n’y a pas seulement un déplacement de gaz, les particules d’oxygène viennent empêcher que notre cerveau s’éteigne. Cela signifie que notre corps n’est pas un isolat, il tire sa subsistance du dehors, non pas momentanément lorsque nous mangeons (la nutrition peut aussi être analysée comme salvation), mais constamment, à chaque inspiration. Notre corps n’est pas un point dans l’espace mais une portion de l’espace, qui se sauve précisément de son ouverture à son espace environnant. Ainsi dire que l’atmosphère devient irrespirable, au sens propre ou au sens figuré, c’est dire qu’il n’est plus apte à nous donne cette salvation permanente que nous tirons de lui.c. La souffrance
Nous avons dit plus haut que la philosophie naissait à partir de l’épreuve d’un certain mal, comme négation d’un mal initial, ce qui est une manière de dire que la souffrance qu’elle implique, indépendamment de la joie qui s’y lie, donne quelque chose. La souffrance est irréductiblement un phénomène négatif, le philosophe aurait beau jeu de chercher à la dépasser par le concept, mais elle est une sorte de nœud, entre deux fils contradictoires, celui de la blessure qui est amenuisement et celui de la sensation qui manifeste le maintien d’une vie. C’est dans doute ce deuxième fil qui fait dire à Emmanuel Levinas que « la souffrance est l’impossibilité du néant »[26]. Lorsque je marche pieds nus sur une punaise, la douleur que le métal qui pénètre ma chair m’inflige, est à la fois l’indication objective qu’en cette petite partie mon corps est endommagé, et en même temps l’épreuve aigüe de sa vitalité, qui résiste à la blessure.3. Une deuxième thèse : antériorité de la salvation
Trois phénomènes marquent l’antériorité de la salvation sur l’être, trois phénomènes qui se disent par trois verbes qui désignent trois gestes constituant toute vie.a. Naître
Claude Vigée rapporte cette parole de Saint John Perse :« Le feu divin m’apparaissait déjà dans l’immédiat du monde. Je n’avais besoin d’aucun intercesseur, sinon de ceux-là même dont notre univers se constitue ici-bas. C’est pourquoi je n’ai jamais pu me sentir tout à fait chrétien : comme les vrais enfants des îles, je suis sauvé de naissance »[27].Notons d’abord que la thèse de la préséance de la salvation sur l’être n’est pas par soi chrétienne, qu’elle peut être utilisée contre le christianisme. « Je suis sauvé de naissance » n’est pas une phrase de nature religieuse mais phénoménologique ; il ne s’agit pas de dire que le poète a eu une sorte de grâce élective qui l’aurait distingué des autres, mais que la naissance elle-même est une salvation. Toute naissance est une salvation, car elle consiste à s’arracher à la matrice de tout mal, le néant. Cela est valable pour la naissance au sens figuré, par exemple dire qu’après une longue période de dépression untel a connu une « nouvelle naissance », c’est dire qu’il s’est sauvé de ce mal qui le rongeait. Mais cela est valable d’abord si l’on tente une description de la naissance au sens littéral. Notre naissance n’est pas seulement un passage d’un intérieur caché à un extérieur manifeste ; notre naissance n’est pas seulement une manifestation – et la manifestation n’est pas seulement une naissance, comme nous le verrons plus loin. Notre naissance est aussi et plus profondément une salvation, car elle est le passage risqué d’un milieu autrefois hospitalier mais devenant potentiellement dangereux à un espace qui donne à chaque chose sa place. Elle est le passage d’une matrice à l’espace, du lieu enveloppé et fermé de l’utérus nourricier à l’ambiance du monde, sans frontière absolument indépassable.
b. S’éveiller
Nous avons montré le caractère permanent de la salvation en analysant la respiration, si on analyse ce que signifie s’éveiller on peut à la fois confirmer le caractère quotidien de la salvation et en plus montrer que la salvation connaît des degrés. S’éveiller est pour la conscience se tirer du néant, ce qui signifie que la conscience a pour racine une salvation. Nietzsche dans le Gai savoir dit que la conscience est« la conséquence d’une terrible nécessité qui a longtemps dominé l’homme : étant l’animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d’aide et de protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible – et pour cela il lui fallait d’abord la “conscience”, il lui fallait “savoir ” lui-même ce qui lui manque, “ savoir ” quelle est sa disposition d’esprit, “savoir ” ce qu’il pense »[28].Or l’éveil est plus ou moins « grand », c’est-à-dire occupe une plus ou moins grande portion de l’espace. L’éveil suppose une « prise » de conscience, ce qui est à entendre comme dans le domaine militaro-juridique on parle d’une « prise de terre » qui précède toujours déjà le droit[29], c’est-à-dire comme d’une appropriation d’un espace. Pour avoir conscience de vous qui êtes ici devant moi aujourd’hui, il a d’abord fallu non seulement que je m’éveille de ma nuit mais que j’occupe physiquement cet espace. A la racine de la conscience il y a donc l’appropriation d’un espace, avant même que l’on y réfléchisse pour que les idées que l’on s’en fait soient claires et distinctes. Or cette taille de l’espace approprié à la racine de la conscience est ce qui mesure le degré de la salvation qui a déjà eu lieu.