Catégorie : Publications de l’Académie
La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse

Avant-propos de Raymond Barre et Pierre Messmer
Paris, 2007, Éditions du Seuil
Publié avec le soutien
de la Fondation Cino et Simone del Duca
de l’Institut de France
A la veille d’échéances cruciales pour la France, des voix s’élèvent en provenance de l’Académie des sciences morales et politiques pour saisir l’opinion publique d’un problème majeur et mal connu : La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse.
Autant que celle de ses gouvernants successifs, c’est la responsabilité de la collectivité nationale qui est engagée.
Qu’il s’agisse de l’emploi, de la formation, de la solidarité entre les générations, de la dette publique, les politiques nationales, malgré les bonnes intentions, se sont révélées peu efficaces et’ injustes envers tout ou partie de la jeunesse.
Les cosignataires de cet appel à la lucidité et au civisme sont deux anciens Premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer; trois autres membres de l’Académie des sciences morales et politiques, Michel Albert, Marcel Boiteux et Gabriel de Broglie ; et trois éminents experts, Christian de Boissieu, Jean-Michel Charpin et Jean-Philippe Cotis.
Présentation du rapport par Marcel Boiteux
La situation économique de la France n’est pas bonne, son équilibre social est menacé, les décisions courageuses et le remboursement de la dette publique sont remis à plus tard – et ce sont les jeunes qui vont en souffrir de plus en plus.
Dire cela il y a un an n’était pas tellement original. Le dire aujourd’hui l’est encore moins si l’on en reste aux déclarations et approximations dont la presse nous abreuve.
Mais, à l’instigation de notre secrétaire perpétuel et avec l’appui financier de la fondation del Duca, le parti fut pris dès l’origine de nos travaux d’étayer nos propos sur des analyses scientifiques. Nous avons fait appel pour cela au CEPREMAP (centre pour la recherche économique et ses applications) – dont le directeur est Daniel Cohen. Après examen, il a été décidé que nous appuyerions nos réflexions sur des équipes ad hoc de chercheurs du CEPREMAP axées respectivement sur le marché du travail, le système éducatif, divers aspects de la vie des jeunes, les menaces économiques et financières qui pèsent sur eux.
***
J’en viens maintenant à notre rapport lui-même, dont le CEPREMAP a également fourni les rapporteurs.
A la base un constat : la société française est inquiète et désenchantée. Elle pense très généralement que les jeunes générations auront moins de chance que celles qui les ont précédées. D’où d’ores et déjà le désarroi, l’inquiétude de nombreux jeunes et, trop souvent, leurs réactions de violence.
L’analyse se présente en trois chapitres concernant respectivement le marché du travail, le système éducatif, le déséquilibre des rapports entre les générations. Dans le bref délai qui m’est imparti, je ne pourrai donner de ces chapitres qu’une idée rapide et sans nuance.
Premier point, le fait est que les conditions d’insertion des jeunes sur le marché du travail se sont considérablement détériorées depuis vingt ans. Dans un contexte de chômage accru, les jeunes – dont la formation est restée trop longtemps coupée du monde du travail – souffrent beaucoup plus qu’autrefois de leur état de débutant. C’est sur eux que pèsent les exigences croissantes de flexibilité du marché, dès lors que les travailleurs en place voient leurs emplois très fortement protégés. Plus forte s’avère cette protection des emplois – et non des travailleurs – plus forte est l’instabilité pesant sur les jeunes qui n’ont pas encore accédé aux emplois protégés. D’où une dualité pernicieuse entre les « inclus » et les « exclus ».
Ce dualisme du marché du travail coexiste avec un dualisme tout aussi pernicieux du système éducatif, entre les sélectionnés et les laissés pour compte.
Après la seconde guerre mondiale, l’école, puis l’université se sont ouvertes à une partie de plus en plus large de la population. Le nombre des bacheliers – ou tout au moins des lauréats – a doublé au cours des vingt dernières années, celui des étudiants s’est accru de 60 %. Mais cette ouverture a engendré autant de désillusions qu’elle avait suscité d’espoir. De réformes avortées en réformes échouées, notre système éducatif peine durablement à s’adapter à un enseignement de masse. L’égalité des chances n’a pas progressé ; elle a même régressé pour les « Très Grandes Ecoles ». Hors les grandes Ecoles, seules les filières professionnelles font l’objet d’une certaine sélection, de sorte que ce sont les refusés de ces filières qui viennent en masse rejoindre les vraies vocations dans les formations générales. Et là, ces laissés pour compte n’ont aucun avenir après qu’avoir perdu leur temps, ils subiront quand-même une sélection, celle de l’échec. Ainsi se heurte-t-on aux tabous de la gratuité, du refus de la sélection, du manque d’autonomie des universités qui les paralyse face aux réformes indispensables.
Mais les choses, heureusement, évoluent par la bande. C’est ainsi que l’Université créé des écoles en son sein qui, pas à pas, discrètement, contournent les tabous.
Enfin, troisième chapitre, un déséquilibre croissant s’établit entre les générations.
Avec l’allongement des études et les difficultés d’insertion sur le marché du travail, les jeunes restent dépendants de leur famille beaucoup plus longtemps qu’autrefois et le déroulement du schéma traditionnel « formation-emploi-foyer » est complètement perturbé. Le système des aides aux études, qui repose principalement en France sur des allègements fiscaux pour les parents, contribue à freiner l’émancipation des jeunes.
Or c’est sur les épaules de cette jeunesse mal émancipée que va porter bientôt le poids des retraites généreuses de leurs aînés, et le service d’une dette publique explosive. Si encore cette dette servait à préparer l’avenir, peut-être serait-elle moins menaçante. Mais les budgets de recherche sont insuffisants et nos cerveaux les plus brillants sont recrutés de plus en plus par les universités et les firmes étrangères.
***
J’ajouterai deux remarques essentielles à ce trop bref résumé.
La première c’est que, comme dans tout travail sérieux, nos assertions font l’objet systématique de références à des ouvrages ou articles de chercheurs, qui établissent leur portée scientifique.
La deuxième c’est que nous nous sommes interdits, après le diagnostic, de proposer des médications qui auraient donné à notre rapport l’allure d’un programme de gouvernement. Ce n’eût pas été convenable. Mais chaque chapitre est systématiquement étayé de comparaisons avec l’étranger, lesquelles suffisent à suggérer que nos problèmes ont trouvé ailleurs des solutions.
Reste à espérer, pour terminer, que notre pays, lui aussi, saura enfin retrouver le chemin des vraies réformes pour se mettre en état de s’adapter toujours plus vite à un monde toujours changeant.
Voir sa fiche de lecture
Notes documentaires N°254 / janvier 2007
NOTES DOCUMENTAIRES est un produt du département Ressources d’informations du Service d’information du Gouvernement. Il présente, chaque mois, un certain nombre de fiches de lecture sur des ouvrages à caractère politique, socio-économique et culturel apportant un éclairage sur les mouvements d’idées en ce début de XXIe siècle.
Quelques échos
- Barre et Messmer à la rescousse,
Patrick Bonazza, © Le Point 11/01/07 – N°1791 – Page 72 –
« Ce qui maintient notre jeunesse entre deux mondes, c’est surtout notre insuffisante culture de la réforme. » « C’est la France qui est elle-même en cause, plutôt que tel ou tel gouvernement, telle ou telle majorité qu’il serait vain d’accuser unilatéralement. » Le jugement que portent Raymond Barre et Pierre Messmer, qui ont animé un petit groupe de travail de l’Académie des sciences morales et politiques, est effarant. Puisque la France est en cause, comment en effet peut-on porter remède au mal qui ronge sa jeunesse, à moins de quitter le pays ?
Bien sûr, l’étude, intitulée « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse », publiée au Seuil, ne sombre pas dans l’antipatriotisme. Mais l’on voit bien où les auteurs veulent en venir. Héritiers proches ou lointains du gaullisme, ils ne se reconnaissent ni dans le gouvernement Jospin ni dans l’actuel. On reconnaît bien là l’esprit d’indépendance du professeur Barre.
Pour le reste, l’étude est un diagnostic circonstancié des maux dont souffre la jeunesse. Tout y passe. Le chômage et la précarité, qui affectent les moins de 25 ans en priorité. L’éducation, qui condamne davantage aujourd’hui qu’hier les jeunes issus des milieux populaires. Le prix des logements qui les contraint à vivre chez leurs parents.
Bref, cette étude est un roman noir. Qui n’a qu’un seul but : exhorter le pays à modifier radicalement ses comportements, quel que soit le vainqueur de la prochaine présidentielle. Un acte de foi, en somme.
- Les jeunes victimes du modèle français,
par Eric Le Boucher, LE MONDE, article paru dans l’édition du 14.01.07
C’est un événement : l’Académie des sciences morales et politiques croit nécessaire de publier un livre cri d’alarme : La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse (éditions du Seuil). Il n’y a que très peu de précédents dans l’histoire de France d’une telle mobilisation des cinquante habits verts, éminences nationales de la philosophie, du droit, de l’économie, de l’histoire. Le document est solennel, avec une préface signée par deux anciens premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer. Le travail a été coordonné par le chancelier Gabriel de Broglie, le secrétaire perpétuel Michel Albert, et présidé par Marcel Boiteux. Le livre accusateur a été fait à partir de contributions nombreuses, demandées aux meilleurs spécialistes, qui sont publiées parallèlement par le Cepremap (éditions de l’Ecole normale supérieure).
Si la France est inquiète, pessimiste, désemparée, en révolte, c’est parce qu’elle traite mal ses enfants, expliquent les nobles vieillards. Défaillance éducative, chômage massif, précarité et dette pénalisent la jeunesse et, comme « l’angoisse des parents grandit avec le désarroi des enfants », la France connaît « une singulière inaptitude à se projeter positivement dans l’avenir« .
Le livre a un autre intérêt que d’être un violent coup de sabre donné aux gouvernements actuel et passés depuis vingt ans. Synthétisant les études récentes sur les défauts du modèle français, il parvient à étayer une conclusion simple d’une portée générale : la France fait mal à force de vouloir bien faire. L’échec est celui de la politique des bons sentiments. Les effets pervers des politiques sociales ou éducatives, conduites pourtant avec la meilleure volonté, submergent leurs effets positifs.
Le mécanisme est schématiquement celui-ci : en protégeant telle catégorie, le système expose les autres. Puis en protégeant alors telle autre, il expose encore plus fortement celles laissées en dehors, et ainsi de suite, jusqu’à un réduit de laissés-pour-compte qui sont exclus de tout. La France sociale qui se veut égalitaire est devenue ainsi une machine à exclusion. Voilà pourquoi les jeunes sont mal traités, plus particulièrement les jeunes sans qualification et plus encore ceux des banlieues. Prenons deux exemples pour le comprendre.
Le marché du travail. Les faits sont apparus en pleine lumière avec la crise du contrat première embauche (CPE) au printemps 2006 : le chômage des jeunes en France est parmi les plus élevés des pays de l’OCDE et, lorsqu’ils parviennent enfin à décrocher un job, il s’agit à 87 % d’un contrat temporaire (40 % au Danemark). On peut émettre une explication : la flexibilité nécessaire dans le capitalisme actuel passe par les jeunes, mais ceux-ci, ayant passé 30 ans et ayant trouvé un contrat à durée indéterminée (CDI), bénéficient à leur tour de garanties fortes. Plutôt que de précariser tous les salariés, la France a fait le choix de conserver ces garanties fortes intactes, mais il faut remonter une longue « file d’attente » au départ de la vie. Cette politique est pénible certes, mais elle permet au total de contenir le mal. C’est le choix français délibéré d’un marché de l’emploi dual : très dur au départ, doux ensuite.
Passons sur le côté égoïste d’un tel choix qui demande aux jeunes d’absorber seuls le choc de la précarité. Passons aussi sur le creusement des niveaux de vie entre générations qu’il provoque. Constatons que, la mondialisation s’imposant, l’accès à l’emploi en CDI devient de plus en plus tardif et difficile, et qu’entre-temps la dualité « accroît la dispersion des destins selon l’origine scolaire » : les moins qualifiés sont les plus pénalisés, au point que certains n’accèdent jamais au CDI rêvé. Voilà comment la France, à vouloir « protéger » les emplois existants, creuse les inégalités et crée des exclus à vie. Les académiciens soulignent qu’il existe d’autres choix possibles, comme en Allemagne ou en Europe du Nord.
Deuxième exemple : l’éducation, où l’on retrouve un autre dualisme. Comme les autres pays, la France a fortement accru l’accès à l’enseignement supérieur tout en voulant protéger sa spécificité : la sélection. Ainsi allait-on donner à tous les fils d’ouvriers les diplômes qui étaient réservés aux fils de bourgeois, l’élitisme républicain allait assurer l’égalité de chances. Mais, d’une part, cette sélection jette dehors 150 000 jeunes par an, que l’école abandonne sans aucune formation, d’autre part, le nombre d’élèves des grandes écoles n’a guère été augmenté et c’est l’université qui a dû, seule, sans moyens, absorber le choc du nombre. Elle n’a pas pu et pas su. Dès lors, comme parallèlement, les entreprises sont devenues plus sélectives, le diplôme ne garantit plus l’obtention d’un poste de cadre, et beaucoup de bacheliers doivent accepter des emplois non qualifiés. D’où un sentiment terrible de déclassement.
N’y échappent que les enfants accompagnés culturellement et financièrement par leur famille. Et voilà, à l’inverse de la volonté de départ, comment les jeunes ont perdu de l’autonomie par rapport à leurs parents et comment l’enseignement est devenu une machine à reproduire les inégalités.
Ces deux échecs français ne condamnent ni la possibilité d’une protection sociale des salariés ni la nécessité de généraliser l’accès à l’enseignement supérieur, concluent les académiciens. Ils soulignent combien les bons sentiments font de mauvaises politiques s’ils ne sont pas armés de profondes réformes d’adaptation menées jusqu’au bout.
- La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse,
par Raymond Barre et Pierre Messmer
Le Figaro | Débats & Opinions, publié le 18 janvier 2007
Raymond Barre et Pierre Messmer sont anciens premiers ministres. Le groupe de travail, placé sous la présidence de Marcel Boiteux, réunissait, outre les deux auteurs, Michel Albert, Gabriel de Broglie, membres de l’Académie, Christian de Boissieu, Jean-Michel Charpin et Jean-Philippe Cotis.
La société française est inquiète. Inquiète pour ses enfants, inquiète pour son avenir. Le malaise des jeunes est devenu un thème courant. Depuis un an, l’Académie des sciences morales et politiques a entrepris un travail de fond sur cette question dont elle publie aujourd’hui les conclusions dans un essai au titre sans appel : La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse (Éditions du Seuil). Ce livre est le fruit de réflexions fondées sur les travaux scientifiques de chercheurs de la Rue d’Ulm, rassemblés autour du professeur Daniel Cohen. Ce n’est pas l’esprit partisan qui nous conduit aujourd’hui à prendre la plume ensemble pour la première fois. C’est la gravité de faits irréfutables que nous avons constatés. Optimistes et déclinistes pourront bien s’affronter pour savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide ; le fait est qu’il se vide. La France n’est sans doute pas encore au bord du gouffre, mais il est plus que jamais urgent de prendre conscience des erreurs qui l’y mènent.
Pour protéger les emplois, les Français ont accepté d’en exclure de nombreux jeunes. Aujourd’hui, 1 sur 4 n’a pas décroché d’emploi stable trois ans après la fin de sa formation ; on en comptait 1 sur 10 en 1982. Les politiques suivies – rigidification du droit du travail et « partage de l’emploi » – ont eu pour effet de créer des barrières presque infranchissables entre les titulaires des emplois protégés – privés aussi bien que publics – et ceux qui en sont exclus : les 20-30 ans, mais aussi les 50-65 ans.
Car l’emploi, contrairement au pain, ne se partage pas ; il se multiplie par le travail. L’accès à l’emploi se fait dorénavant sur le mode de la « file d’attente », comme dans tout système de pénurie organisée. La France consacre pourtant plus de dépenses que ses voisins aux dispositifs d’aides à l’emploi des jeunes. Mais ces mesures ne seront jamais que des palliatifs si le droit du travail n’est pas réformé. Les pays scandinaves, en favorisant une protection des personnes et non des emplois, ont prouvé qu’il était possible de modifier de manière efficace les institutions du marché du travail sans renoncer pour autant à la garantie de sécurité à laquelle aspirent les salariés.
Le dualisme du marché du travail se double de celui, tout aussi pernicieux, du système éducatif. L’école et l’université se sont ouvertes massivement. Mais cette ouverture a engendré autant de désillusions qu’elle avait suscité d’espoirs. D’élitiste qu’elle était et d’égalitaire qu’elle devait devenir, notre école est devenue plus injuste. L’égalité des chances n’a pas progressé. Elle a même régressé pour les plus grandes écoles. Les fils d’ouvriers et d’employés représentaient 25 % des admis à Polytechnique il y a 50 ans ; ils sont 1 % aujourd’hui. En dehors des cursus d’excellence, seules les filières professionnelles font l’objet d’une certaine sélection et d’une certaine réussite. Ceux qui ne peuvent y entrer viennent s’échouer en masse dans les formations générales des universités. Et là, après avoir perdu leur temps, ils subissent quand même une sélection : celle de l’échec. Les tabous de la gratuité, du refus de la sélection et le manque d’autonomie des universités rendent l’enseignement supérieur difficilement réformable, sauf par contournement ou à la marge grâce à la création de filières spécialisées, due aux initiatives heureuses de certaines équipes pédagogiques.
Les jeunes restent beaucoup plus longtemps dépendants de leur famille du fait de l’allongement des études et des difficultés d’insertion. Et c’est sur eux que pèsera bientôt le poids croissant des retraites de leurs aînés, et le service d’une dette publique exponentielle. Si encore cette dette servait à préparer l’avenir !
Mais les financements publics de la recherche — qui représentent la moitié de son budget — ont fortement régressé. Dans un monde mû par le progrès rapide des technologies, ce relatif désinvestissement est désastreux.
Les exemples étrangers montrent qu’il n’y a pas de fatalité à une telle situation. Ce n’est pas la mondialisation qui aggrave à ce point les dualismes de notre société ; ce sont nos propres idées reçues. Alors, tant pis pour les jeunes ? Sans nul doute, si nos concitoyens et ceux qui aspirent à les gouverner décident, dans les mois qui viennent, de continuer à privilégier les positions acquises et à repousser les indispensables adaptations aux défis internationaux que nous devons relever.
- France, prends garde de perdre ta jeunesse
par Jean Boissonnat
Ouest France, Editorial, 18-01-2007
En cette année électorale, les discours sur la jeunesse vont fleurir sur tous les horizons politiques. En général, ils combinent la démagogie avec l’hypocrisie. Démagogiques, les refrains sur les vertus universelles du jeune âge. Hypocrites, les pleurnicheries sur les handicaps propres aux jeunes générations. La jeunesse française, en ce début de siècle, mérite plus de lucidité et de franchise.
Il faut louer, ici, l’ouvrage que publie l’Académie des sciences morales et politiques sous le titre La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse(éditions du Seuil). Le collège des auteurs est prestigieux autour de Raymond Barre et Pierre Messmer avec, notamment, Gabriel de Broglie, Michel Albert et Marcel Boiteux. Ces personnalités reconnues auraient pu nous servir un document conventionnel. Ce n’est pas le cas. S’appuyant sur des études récentes et rigoureuses, elles démontrent clairement que la jeunesse française n’est pas victime de « l’air du temps », mais de l’inconscience et de l’égoïsme des générations qui l’ont précédée, c’est-à-dire de nous-mêmes.
Les auteurs fondent leur démonstration en analysant les structures du marché du travail, celles de notre système éducatif et le mode de redistribution de la richesse nationale.
Pour faire bref, tout se passe, dans notre pays, comme si l’on avait préservé une relative (très relative) stabilité et sécurité de l’emploi pour les personnes d’âge adulte, en sacrifiant les conditions d’entrée des jeunes sur le marché du travail. Chez nous, le taux de chômage des jeunes est deux fois plus élevé que celui des adultes ; il est le double de ce qu’il est en moyenne dans l’ensemble des pays développés de l’OCDE. En France, 87 % des contrats de travail des jeunes sont des contrats précaires, deux fois plus que dans un pays comme le Danemark. Et ce n’est pas du tout en jetant, en dehors du marché du travail, les personnes de plus de 55 ans (la France détient le record en ce domaine) que l’on améliore l’accès des jeunes à la vie professionnelle.
L’école en procès
Le mauvais fonctionnement de notre système éducatif est, naturellement, l’une des principales causes de ces débuts désolants des jeunes sur le marché de l’emploi. Et cela, malgré l’ampleur des ressources financières consacrées à l’éducation. On a confondu, chez nous, démocratisation de l’enseignement et éducation de masse. La proportion des élèves, atteignant la classe terminale, a doublé en dix ans (36 % en 1984, 70 % en 1994) sans que cela améliore leur entrée sur le marché du travail. Nos grandes écoles forment, certes, des élites de qualité, mais dans des proportions de plus en plus faibles. Quand les universités américaines les plus prestigieuses quadruplaient leurs effectifs, les grandes écoles françaises ne les augmentaient que de 15 %. Pendant ce temps, on enfournait la masse des étudiants dans des universités sans système de sélection autre que par l’échec dont une grande partie des élèves sortaient sans diplôme. Parmi ceux qui finissaient par en obtenir un, beaucoup se résignaient à occuper des emplois sans qualification. Manque d’autonomie des établissements, mauvaise articulation avec la vie des entreprises, excès de corporatisme apparaissent comme autant de vices du système français.
La redistribution des richesses nationales par l’État et par les organismes sociaux n’arrange rien. Compte tenu de l’ampleur des déficits publics (qui sont passés, en un quart de siècle, du quart de la production nationale aux deux tiers de celle-ci), cette redistribution s’analyse d’abord comme un transfert des adultes vers les jeunes qui devront payer les intérêts et rembourser les dettes. Une seule réforme, encore insuffisante, mais significative, a été engagée, celle des retraites, avec l’allongement de la durée des cotisations.
Aucun de tous ces problèmes n’est insoluble, comme le prouvent de nombreux exemples à l’étranger. Si la France ne veut pas perdre sa jeunesse, elle doit cesser de la flatter ; il lui faut se réformer elle-même pour que cette jeunesse ne la quitte pas.
- Messmer et Barre au chevet des jeunes,
M.B., Le Républicain Lorrain | Culture, 20 01 2007.
La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse (Seuil) souligne les dysfonctionnements de notre société incapable d’ouvrir des horizons à une jeunesse « passée de l’espoir à l’inquiétude, voire à l’anxiété devant l’avenir ». Deux anciens Premiers ministres de la Ve République qui prennent la plume pour cosigner un « appel à la lucidité et au civisme », voilà qui n’est pas si fréquent. Mais parce que la mission de l’Académie des sciences morales et politiques consiste à « éclairer l’opinion et les pouvoirs publics sur les grandes questions de société », Pierre Messmer et Raymond Barre n’ont guère hésité à se jeter à l’eau pour « attirer l’attention sur un problème fondamental » : « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse », témoignent en chœur les deux ex-locataires de Matignon dans l’ouvrage éponyme, édité au Seuil. Pour avoir participé aux travaux préparatoires à ce rapport, ils adoptent ce cri d’alarme qui met en relief « le désarroi, l’anxiété, la colère de nombreux jeunes face à leur avenir ». Les origines sociales ont beau tempérer ce noir tableau, « un fossé de plus en plus profond se creuse entre les conditions d’existence des générations précédentes et celles des jeunes d’aujourd’hui ». La faute à « une société de plus en plus duale, segmentée, dans laquelle, pour ne pas remettre en cause la situation des uns, on néglige le sort des autres ». La difficile insertion professionnelle des jeunes constitue une des principales raisons du « grand désenchantement ». Les dispositifs favorisant l’emploi précaire n’y changent rien, ni les politiques de cessation anticipée d’activité. Des comparaisons avec d’autres pays font apparaître que « partout où l’activité des seniors est forte, celle des jeunes l’est aussi ». Pour les auteurs du rapport, les « très coûteuses » politiques d’accompagnement sont de « simples palliatifs » aux « performances mitigées ». Et elles ratent leur cible quand il conviendrait de « protéger les individus, pas les emplois ». Notre système d’éducation est également pointé du doigt. « Sa démocratisation a abouti à un renforcement sans précédent des tensions aux deux bouts de la hiérarchie scolaire » et « ses filières universitaires sont trop peu sélectives, trop peu différenciées et professionnelles ». Il ne peut « résorber une fraction devenue irréductible d’échec scolaire », alors que « le marché du travail est dur pour les non-qualifiés ». Et c’est pourtant sur les épaules des jeunes que reposeront dans un proche avenir « le coût de l’inactivité des seniors, la dette publique et le laxisme budgétaire » choisis par nos gouvernants. A méditer à l’approche des présidentielles.
- Un rapport alarmant sur la jeunesse,
Mathilde DAMGÉ,
La Croix du 24 01 2007
L’Académie des sciences morales et politiques prend l’opinion publique à témoin des difficultés des jeunes face à l’avenir.
En pleine campagne électorale, l’Académie des sciences morales et politiques élève la voix dans un rapport sur l’avenir de la jeunesse. Le ton est alarmant : « La France prépare mal l’avenir de la jeunesse », préviennent les Sages. Constituée de 50 personnalités intellectuelles et publiques, l’Académie aime à soulever des thèmes nouveaux ou qu’elle juge peu abordés par le grand public. Le rapport qu’elle présentait hier est signé de deux anciens premiers ministres, Raymond Barre et Pierre Messmer, ainsi que d’autres noms prestigieux : Christian de Boissieu, président délégué du Conseil d’analyse économique, Jean-Michel Charpin, ancien commissaire au plan ou Jean-Philippe Cotis, chef économiste de l’OCDE.
Il s’appuie sur les travaux du Cepremap, le Centre pour la recherche économique et ses applications, dirigé par Daniel Cohen, par ailleurs directeur du département d’économie de l’École normale supérieure :
« Violence des casseurs, montée du suicide, retrait de la vie politique et associative, consommation de psychotropes... », le constat n’encourage pas à l’optimisme. On observe, insistent les auteurs, « une vague de pessimisme sans précédent depuis les années 1960 ». La faute au chômage d’abord, qui ne s’est jamais situé en dessous de 18 % depuis vingt-cinq ans pour la tranche d’âge 18-25 ans.
La faute aussi, et l’argument est plus original, à certains effets pervers de l’évolution du système scolaire. Le rejet des métiers dits manuels, le renforcement de la ségrégation entre bacheliers et non-bacheliers, entre bons et moins bons lycéens, ou encore entre élèves des grandes écoles et étudiants des facultés sont autant de facteurs qui contribuent à scinder la population entre « ceux qui sont adaptés au monde moderne », une minorité, et les autres.
Autre difficulté à laquelle les jeunes sont confrontés : alors que d’autres pays favorisent l’indépendance financière de ceux-ci grâce à des systèmes de bourses ou de prêts, la France s’appuie sur la solidarité familiale, solidarité aussi inégale que le niveau des familles en question. Ainsi se dessine une ultime injustice : la fracture entre ceux que les chercheurs appellent les « héritiers », et les « non-héritiers ». Les premiers, qui représenteraient 30 à 40 % de chaque classe d’âge, « bénéficient d’un soutien familial tant socio-culturel que financier ». Les autres « ne reçoivent que des montants limités ». Ainsi, les riches restent riches, et les pauvres s’appauvrissent.
- De l’espoir à l’anxiété
par Jean-Pierre Rioux
Sud Ouest | Débats, paru le 5 février 2007.
« La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse » : le titre est sage mais le texte décoiffe. Ses préfaciers, Raymond Barre et Pierre Messmer, ne passent pas pour des excités pas plus que les experts et les chercheurs qui l’ont nourri, venus de l’Académie des sciences morales et politiques, de la Sorbonne et de l’École normale. Il s’agit pourtant bien d’un procès, d’un cri d’alarme. La conclusion fait mal, très mal : « C’est la France elle-même qui est en cause », dit-elle, plutôt que telle ou telle majorité, si sa jeunesse est passée depuis les années 1980 de l’espoir à l’inquiétude et même à l’anxiété ; si celle-ci est la première victime de nos dysfonctionnements politiques, économiques et sociaux, de nos impuissances publiques, de nos corporatismes, de notre « intouchable protection de tant de droits acquis aux aînés et inaccessibles aux autres ». Si elle est hypothéquée et sacrifiée. Ce cri en rejoint d’autres de même force : « Les parents dépensent, les enfants trinqueront » (Claude Imbert), « Les jeunes Victimes du modèle français » (Eric Le Boucher ), « Les jeunes ne paieront pas » (Bernard Spitz) ou « France, prends garde de perdre ta jeunesse » (Jean Boissonnat). Rude conjonction de pessimismes, quelques mois après les émeutes de banlieues et la crise du CPE.
L’acte d’accusation a trois chapitres, brefs, implacables. Un : nos jeunes sont les premières victimes de l’état si segmenté de notre marché du travail, où ils se faufilent de façon chaotique. Ils sont plus chômeurs que les autres parce que débutants. Deux : ils pâtissent de plus en plus du dualisme du système d’éducation, où l’égalité des chances n’a pas progressé, où l’exclusion prolifère, où le savoir, la formation et l’emploi se contredisent trop souvent.
Trois : ils vont être contraints de financer toute leur vie un déséquilibre entre les générations qui ne peut que s’aggraver. Un, donc : nos jeunes, mal formés, souvent indécis, désorientés, peu soucieux aussi de formation continuée, « trinquent » parce qu’ils sont à l’avant-garde de la « flexibilité » à la française, celle où « la mobilité est concentrée quasi exclusivement dans la phase d’insertion, la stabilité et la protection primant ensuite ». Ils sont longtemps cantonnés sur un marché spécifique, celui des stages, de l’emploi précaire ou de l’attente de la première embauche : en 2001 déjà, 70 % d’entre eux n’atteignaient le havre du CDI que trois ans après leur obtention d’un diplôme et 40 % des non-diplômés restaient chômeurs. On dira, et Jacques Marseille le fait sans d’ailleurs apaiser tout à fait nos craintes, qu’après tout, deux tiers d’entre eux arriveront un jour à une vie active moins précarisée. Mais d’ici là, qu’auront-ils goûté et acquis de la vie, quelle famille, quel toit, quelle émancipation, quels projets ? De plus, la France reste la championne du contrat précaire, du transfert mal distribué, de l’aide sociale qui avantage les parents installés plutôt que les jeunes désemparés, des bourses faibles et des prêts à forts intérêts, des indemnisations du chômage qui aident l’individu mais ne protègent pas l’emploi. Elle paye de plus en plus cher l’idée fausse, de gauche comme de droite, selon laquelle la cessation d’activité des seniors donnerait de l’emploi aux juniors.
Deuxième point de friction, bien connu mais relaté ici très crûment : la démocratisation de l’enseignement secondaire et supérieur n’a pas offert des chances de réussite égales pour tous et elle a aggravé les tensions aux deux bouts de la chaîne éducative : à l’amont, des illettrés et des sans-diplôme handicapés à vie ; à l’aval, une élite des grandes écoles toujours aussi compétente mais socialement toujours plus squelettique (les fils d’employés et d’ouvriers représentaient 25 % des admis à Polytechnique il y a cinquante ans ; ils sont 1 % aujourd’hui), les premiers cycles-parkings à l’université, la fixité du zonage ZEP-ZUP, la rigidité de la carte scolaire, la sélection par l’échec, le déni de l’entreprise, le refus du travail manuel, les apprentissages en capilotade, l’incapacité à multiplier les filières différenciées et sélectives qui seules conduisent à l’emploi, la menace sur la recherche-développement qui, à terme, va disqualifier le pays et tarir un peu plus l’emploi. Enfin, hardiment, le livre fait comprendre pourquoi les jeunes ne s’affranchissent plus, ou si mal, d’une dépendance qui les enchaîne aux aînés et leur fera bientôt traîner seuls le boulet de la dette publique.
La fin est terrible. Pourquoi nous refusons-nous à user des remèdes éprouvés dans d’autres pays ? Avons-nous si peu la culture de la réforme, de l’expérimentation, de l’évaluation, de la négociation collective que nous ne puissions pas espérer sortir nos enfants du gué où nous les avons embourbés ? À tout le moins, « un immense effort de pédagogie civique et d’intelligence du monde nouveau où nous entrons s’impose d’urgence » Certes.
Regardons-nous donc bien dans la glace. Et vous, mesdames et messieurs les Candidats, qu’en dites-vous ?
- Pensez aux jeunes !
La Tribune, paru le 16 février 2007
Quel pays laissera-t-on à nos enfants ? Cette question doit bien sûr occuper l’esprit de nos décideurs, politiques ou économiques. Or, à ce jour, le constat n’est guère positif. « La difficulté d’emploi des jeunes et les échecs de la démocratisation scolaire sont indissociables. C’est de ce terreau que se nourrit le malaise de la jeunesse », constatent dans leur avant-propos Pierre Messmer et Raymond Barre. « Victimes de l’état du marché du travail », les jeunes paient le prix d’un système éducatif dual où est à l’œuvre un « puissant phénomène de séparartion sociale ». Bref, l’égalité des chances n’est plus qu’un vœu pieu dans notre pays. La jeunesse est l’avenir d’une nation, et on se félicite à juste titre de voir la natalité française battre aujord’hui des records. Encore faut-il se donner les moyens de préparer un avenir digne de ce nom à cette jeunesse.
Peut-on faire confiance aux historiens ?
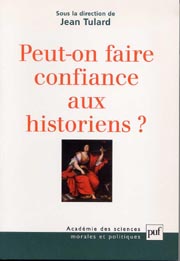
sous la direction de
Jean Tulard
Peut-on avoir confiance dans les historiens ? La question est aujourd’hui brûlante. L’Histoire s’écrira-t-elle au Parlement ou dans les prétoires plutôt que dans les bibliothèques et les dépôts d’archives ?
Personnalités politiques, médecins, sociologues et historiens débattent de ce problème devant l’Académie des Sciences morales et politiques.
Sommaire
Introduction — Jean TULARD
Première partie — Grandes figures
Qu’est-ce qu’un historien ? De Guizot à de Gaulle, la diversité est grande. Sacha Guitry lui-même n’affirmait-il pas faire œuvre d’historien au début de son film Si Paris nous était conté ?
Gabriel DE BROGLIE — Guizot
Xavier DARCOS — Mérimée et l’histoire
Jean PIAT — Sacha Guitry
Bernard VALADE — Du bon usage de l’histoire selon Pareto
Alain LARCAN — De Gaulle historien
Deuxième partie — Modes d’approche
Où commence l’histoire ? Dans les dépôts d’archives ou dans la presse, dans les documentaires cinématographiques ou dans le roman ?
Martine DE BOISDEFFRE — Les Archives nationales
Denis MARAVAL — Le choix de l’éditeur
Henri PIGEAT — Le journaliste et l’historien
Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER — L’histoire au péril des médias
Jean A. CHÉRASSE — Le film documentaire historique vérités et mensonges
Françoise CHANDERNAGOR — Peut-on écrire des romans historiques ?
Robert KOPP — Le roman, une histoire du présent ?
Troisième partie — Avancées et reculs
L’Histoire s’est élargie à des domaines qu’avaient négligés Thucydide ou encore Lavisse. Mais, en s’interrogeant sur le réchauffement de la planète ou sur l’évolution des saveurs en cuisine, ne condamne-t-elle pas les vieux livres d’histoire à l’obsolescence ?
Jean BAECHLER — Peut-on écrire une histoire universelle ?
Emmanuel LE ROY LADURIE — Peut-on écrire l’histoire du climat ?
Jean-François LEMAIRE — Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?
Jean VITAUX — Peut-on écrire l’histoire de la gastronomie ?
François MONNIER — L’obsolescence des œuvres historiques
Quatrième partie — Légendes et falsifications
Déjà Tacite et Suétone étaient soupçonnés de dénigrement systématique envers la dynastie julio-claudienne. Que dire des falsifications et des déformations de l’histoire contemporaine ou des révisions du passé ? L’historien se voit dépossédé de son pouvoir de dire la vérité au profit du juge. Thémis supplante Clio.
Jacques DUPÂQUIER — L’Ancien Régime vu par les manuels d’histoire de la IIIe République (1871- 1914)
Jean-Paul CLÉMENT — Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon
Jean DES CARS — Les historiens et la légende noire du Second Empire
Alain BESANÇON — Fluctuations de l’historiographie de la Russie
Bernard BOURGEOIS — La fin de l’histoire
Conclusion — Jean TULARD
Introduction
Jean Tulard
A Sainte-Hélène, Napoléon découvre la sagesse. S’interrogeant sur l’image que les historiens donneront de lui, il confie à Las Cases : « II faut en convenir, les véritables vérités sont bien difficiles à obtenir pour l’historien. Heureusement que la plupart du temps, elles sont bien plutôt un objet de curiosité que de réelle importance. »
C’est dire le peu d’intérêt attaché par Napoléon à l’Histoire. Du moins en apparence.
Pour lui la vérité historique n’existe pas. Elle n’est le plus souvent, dit-il, qu’un mot. « Elle est impossible au moment même des événements, dans la chaleur des passions et si, plus tard, on trouve un accord, c’est que les intéressés et les contradicteurs ne sont plus. Qu’est alors la vérité historique ? Une fable convenue. »
Et Napoléon de souligner l’absurdité de toute biographie. « J’ai donné un ordre, mais qui a pu lire le fond de ma pensée, ma véritable intention ? Et pourtant chacun va se saisir de cet ordre, le mesurer à son échelle, le plier à son plan, à son système individuel. »
Non, il est impossible de pénétrer dans l’âme humaine. Orson Welles le rappellera dans son film Citizen Kane. L’enquêteur ne saura jamais ce que signifiait le dernier mot prononcé par le magnat de la presse, « Rosebud », et la grille de Xanadu se refermera, comme elle s’était ouverte, sur l’écriteau « No trespassing », « défense d’entrer ». Défense d’entrer dans la vie d’un homme.
Napoléon s’indigne : « 0n me supposera des projets que je n’eus jamais ; on se demandera si je visais à la monarchie universelle ou non. On raisonnera longuement pour savoir si mon autorité absolue et mes actes arbitraires dérivaient de mon caractère ou de mes calculs, si mes guerres constantes vinrent de mon goût ou si je n’y fus conduit qu’à mon corps défendant. »
« Il en sortira, conclut l’Empereur, la fable convenue qu’on appellera mon histoire. »
L’Histoire une fable convenue ? La question peut se poser en un temps où le juge tend à se substituer à l’historien, Celui-ci est-il impartial et Tacite n’a-t-il pas volontairement noirci Néron ? L’historien dispose-t-il de toutes les sources au moment où les modes modernes de transmission sont en train de les raréfier ? Et l’obsolescence des livres d’histoire ne connaît-elle pas, avec l’inflation des ouvrages, une brusque accélération ? Bref, faut-il faire confiance aux historiens ?
Tel est le débat qui a animé l’Académie des Sciences morales et politiques au cours de l’année 2005. On trouvera dans ce volume les communications qui ont été présentées sur ce sujet.
Conclusion
Jean Tulard
Fin de l’Histoire Déjà Volney, l’un des premiers membres de l’Institut, dans ses leçons sur l’Histoire prononcées à l’éphémère Ecole normale de l’an III, condamnait cette prétendue science et écrivait : « Plus j’ai analysé l’influence journalière qu’exerce l’Histoire sur les actions et les opinions des hommes, plus je me suis convaincu qu’elle était l’une des sources les plus fécondes de leurs préjugés et de leurs erreurs. »
Faut-il rêver d’un monde sans Histoire ? Un monde où se substituerait au devoir de mémoire l’obligation d’oubli ? Les Parisiens passeraient devant la colonne Vendôme sans savoir ce qu’elle représente. Les noms des rues et des places (Général Leclerc, Jean Jaurès, Wagram) ne diraient plus rien. Les livres d’histoire seraient proscrits des librairies.
Utopie ? Mais pensons aux fellahs égyptiens en 1797 qui vivaient à l’ombre de monuments en ruines dont la signification leur échappait puisqu’ils ne pouvaient en déchiffrer les inscriptions. Le passé était abolit ils ignoraient Ramsès et Aménophis. Paisiblement ils se contentaient d’attendre les crues du Nil.
Paisiblement car l’absence de passé signifie l’absence de mauvaise conscience, l’absence de polémiques, l’absence d’esprit de revanche. C’est l’Histoire qui crée les guerres. Tous les dictateurs, tous les conquérants y font référence. L’Histoire justifie tout : massacres, viols et pillages. Excité par le souvenir du passé, on rend à l’ennemi la monnaie de sa pièce. Tel fut le terrible engrenage des conflits franco-allemands.
Supprimer l’Histoire pour établir la paix ? Même Volney n’y a pas songé sérieusement. Au demeurant l’Histoire débarqua rapidement à Alexandrie sous la forme de Bonaparte, de ses soldats et de ses savants. Ramsès et Aménophis ressuscitèrent.
On n’échappe pas à Clio, muse menteuse et volage, mais finalement si charmante. Qu’elle soit un art ou une science, qu’on la déclare quantitative ou narrative, qu’on la veuille philosophique ou érudite, qu’importe : l’Histoire est la meilleure source de l’émotion et du plaisir. Continuons de faire semblant de faire confiance aux historiens.
Regards croisés sur l’Europe
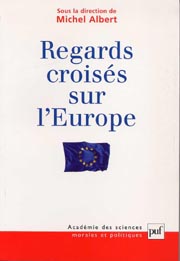
sous la direction de
Michel Albert
Depuis 2004 l’Europe est devenue plus que jamais un sujet de débats et de suspens.
En 2004 l’Europe a radicalement changé de taille, passant de 15 à 25 membres.
En 2004 l’Europe s’est dotée, pour la première fois, d’un projet de constitution dont le sort est loin d’être tranché !
En 2004 l’Europe a tout à coup découvert qu’il lui fallait répondre à l’appel de la Turquie.
Pour y voir clair dans les troubles qui résultent de toutes ces transformations, l’Académie des Sciences morales et politiques a organisé, au cours de l’année de présidence de Michel Albert en 2004, trente-deux conférences qui forment autant de regards croisés et contrastés sur l’Europe.
Ces regards sont ceux de personnalités aussi éminentes que diverses : historiens, économistes, femmes et hommes politiques, français et étrangers.
Dans tout cela, aucune orthodoxie fermée, aucun message normatif, mais le souci de clarifier, de comparer et de confronter en toute liberté.
Sommaire
Introduction – Michel ALBERT
Première partie — Aperçus sur l’héritage
Jean BAECHLER — L’Europe n’a jamais été un empire
Jean FAVIER — L’Europe médiévale
Marc FUMAROLI — L’Europe, république des lettres et des arts
Michelle PERROT — L’Europe et les femmes
Jean TULARD — Napoléon et l’Europe
Daniel COHN-BENDIT — Relations franco-allemandes et construction européenne
Robert TOULEMON — De la construction européenne à la réforme des Nations Unies
Deuxième partie — La construction européenne et les limites de l’Union
Raymond BARRE — De Gaulle, l’Europe et l’adaptation de la France
Jacques DELORS — La construction européenne, hier, aujourd’hui et demain
Pascal LAMY — Les politiques communes et l’Europe dans la mondialisation
Jean-Dominique GIULIANI — Le grand élargissement
Sandra KALNIETE — Les pays baltes et l’Europe
Bronislaw GEREMEK — La vision européenne des pays de l’Europe centrale
Thierry de MONTBRIAL — La question turque
Alain BESANÇON — Les frontières de l’Europe d’un point de vue historique
Jean-Claude CASANOVA — Les limites de l’Europe
Antoine SFEIR — L’Europe vue du monde arabo-musulman
Jean-Claude CHESNAIS — L’Europe ou l’illusion de la grandeur : dépression démographique et dépendance migratoire
Theodor BERCHEM — L’Europe des universités et de la recherche
Yu-Chiou TCHEN — L’Europe vue dExtrême-Orient
Jacques de LAROSIÈRE — Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ?
Troisième partie — Les enjeux du traité constitutionnel
Romano PRODI — Les nouvelles priorités de l’Union européenne élargie
Félix ROHATYN — Les États-Unis et la construction européenne
Lord SIMON — Point de vue britannique sur la construction européenne
Jean-Claude TRICHET — L’euro
Nicole NOTAT — Quel avenir pour le modèle social européen ?
Philippe de WOOT — L’entreprise européenne responsable face à la globalisation
Philippe de VILLIERS — L’Europe des souverainistes
Virgilio DASTOLI — L’Europe des fédéralistes
Jean BOISSONNAT — L’Europe et Dieu
Alain LAMASSOURE — L’Union européenne, des traités à la Constitution
Pierre MESSMER — La nouvelle problématique de la construction européenne
Introduction
En 2004, l’Académie a consacré la totalité de ses trente-deux séances de travail hebdomadaire, et un séminaire sur Robert Marjolin, à examiner différents points de vue sur l’Europe. Cette année 2004 est en effet d’une exceptionnelle importance pour la construction européenne. Peut-être même peut-elle se comparer, sous cet angle, aux deux grandes dates fondatrices : 1950, année de la Déclaration Schuman et 1957, celle de la signature du premier Traité de Rome, celui qui a créé la Communauté économique européenne.
L’année 2004 restera d’abord, à l’échelle de l’Histoire, comme celle du grand élargissement. De 1957 à 2004, sur près d’un demi-siècle, le nombre des membres de l’Union européenne avait augmenté de neuf, passant six à quinze. Au 1er mai 2004, ce même nombre s’est accru d’un seul coup de dix, l’Union passant de quinze à vingt-cinq pays, ce qui modifie considérablement ses équilibres économiques, géographiques et politiques.
Le deuxième événement majeur de l’année 2004 pour l’Europe porte une autre date mémorable. C’est en effet le 18 juin, que le Conseil européen des Chefs d’Etat et de gouvernement a adopté, à l’unanimité des vingt-cinq pays-membres, le premier projet de Traité constitutionnel issu, pour l’essentiel, des travaux de la Convention, présidée en 2002 et 2003 par Valéry Giscard d’Estaing. En attendant d’être ratifié, soit par des référendums populaires, soit par les parlements nationaux, ce Traité vient d’être signé le 29 octobre à Rome. C’est, en quelque sorte, le second « Traité de Rome ».
Loin de clarifier les perspectives d’avenir, ces événements placent l’Europe à une sorte de croisée confuse de chemins incertains où s’affrontent différents pays ou courants d’opinion, tant à l’égard de l’intervention américaine en Irak qu’au sujet de l’adhésion de la Turquie. Irak, Turquie, ces deux exemples suffisent à montrer qu’on ne peut pas comprendre les problèmes actuels de la construction européenne, sans se référer d’abord à l’héritage historique et géographique dont elle est issue. Ce sera mon premier point. J’envisagerai ensuite les deux grands sujets d’une actualité de plus en plus brûlante, que sont d’une part, la question des limites de l’Union dans ses nouvelles perspectives d’élargissement et, d’autre part, le problème de la nature du projet européen comme enjeu du Traité constitutionnel.
L’objectif ainsi visé n’est pas de prendre parti. Il ne s’agit pas de présenter un projet, encore moins un programme, mais de réunir un ensemble de points de vue éclairants, soit par leurs divergences, soit par leurs convergences.
I – APERÇUS SUR L’HERITAGE
L’héritage dont la construction européenne est issue se caractérise par deux grandes spécificités historiques : d’une part, « L’Europe n’a jamais été un empire ». D’autre part, en introduisant pour la première fois dans l’histoire des relations internationales ce que Hannah Harendt a appelé « le pardon et la promesse », elle a fondé la nouvelle Communauté européenne sur une véritable révolution dont le Traité constitutionnel est la plus récente expression. Il convient de préciser quelque peu ces deux points.
En premier lieu, il y a une loi quasi-universelle de l’évolution historique, qui fait que les populations ont été, sur les différents continents, progressivement regroupés sous l’autorité d’empires. Or Jean Baechler a établi que la seule exception notable à cette loi, c’est l’Europe. Il en résulte que l’Europe n’a jamais constitué une entité politique. Cette donnée historique mérite d’être soulignée au moment où le Traité constitutionnel remet à l’ordre du jour, dans une certaine mesure, la question de l’unité politique de l’Europe. Dans le passé, en l’absence d’une telle unité, l’Europe s’est tissée d’une manière floue, à travers des éléments culturels, religieux et artistiques, sous la forme de divers réseaux se diffusant en dépit de la fragmentation des pouvoirs politiques. Mieux, ces structures en réseaux ont favorisé l’effervescence de toutes sortes d’initiatives et, notamment, l’invention de la science.
Ne retombons pas dans le vieux romantisme de l’empire de Charlemagne. Jean Favier souligne que pour cet empereur, l’empire ne constituait guère qu’une sorte de décoration personnelle. Au plan institutionnel, il a fait place, on le sait, dès le Traité de Verdun en 843, à la séparation de trois entités qui sont à l’origine des trois principales nations d’Europe continentale : la France, la Germanie et l’Italie. Le Saint Empire n’a jamais exercé aucune souveraineté européenne et les juristes du Roi de France ont, dès le XIIIème siècle, légitimé celui-ci comme « Empereur en son royaume ». Même après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453 et leur arrivée sur le Danube, la tentative visionnaire du roi de Bohème Georges Podiébrad, de réunir tous les Etats chrétiens pour résister à la pression ottomane, a échoué complètement à cause de l’hostilité de la France et … du Pape !
Ultérieurement, comme l’a montré Marc Fumaroli, l’Europe du XVIème au XVIIIème s’est progressivement constituée en une véritable union intellectuelle, qui s’est appelée « République des lettres » au sens romain du mot. Parie de l’Italie, particulièrement vivante aux Pays-Bas, cette République des Arts et des Lettres s’est progressivement étendue à la France, à l’Angleterre, à l’Espagne, au Saint-Empire germanique, à la Scandinavie, à la Bohème, à la Hongrie, à la Pologne, en un mot à toute l’aire géographique de l’Union européenne à vingt-cinq. Cette communauté des meilleurs esprits a alors transcendé la fragmentation politique, puis les cassures religieuses de l’Europe. Pendant ces trois siècles, qu’ils soient de nationalité française, allemande ou autre, tous les penseurs, artistes et savants ont conscience d’être européens. Pour Jean-Jacques Rousseau, « il n’y a que des Européens, ils ont tous le même goût, les mêmes passions, le même mode de vie ». Et pour Voltaire, l’Europe « était une espèce de grande république partagée en plusieurs Etats, les uns monarchiques, les autres mixtes ; ceux-ci aristocratiques, ceux-là populaires, mais tous correspondant les uns avec les autres ; tous ayant un même fond de religion, quoique divisés en plusieurs sectes ; tous ayant les mêmes principes de droit public et de politique inconnus dans les autres parties du monde ».
C’est aussi l’Europe qui, pendant cette période des XVIème – XVIIIème siècles, a tout simplement, comme le constate Madame Michelle Perrot, inventé la femme moderne et progressivement fait naître, pour la première fois dans l’Histoire, l’idée d’égalité des sexes, les droits civils précédant les droits politiques.
On en était là lorsque, rappelle Jean Tulard, au début de 1812, un millénaire après Charlemagne, Napoléon parvenait à faire de l’Europe son empire sous domination française. Mais celui-ci ne dura qu’un an. Il s’est effondré en 1813, avec la retraite de Russie. Non seulement cette Europe de Napoléon, qui reposait sur la force, n’a pas survécu à l’échec militaire, mais elle a préparé une montée des nationalismes, qui a finalement revêtu des formes explosives. C’est en effet cette Europe là qui a déclenché et conduit les deux seules guerres mondiales de l’histoire universelle, lesquelles, par comparaison avec le million de morts des guerres napoléoniennes, en ont fait huit millions pour la première guerre mondiale et pas moins de cinquante millions pour la deuxième. Il convient de s’en souvenir pour comprendre la miraculeuse conversion qui a suivi cette double tragédie.
C’est en effet par réaction aux horreurs de la seconde guerre mondiale que la deuxième spécificité de l’histoire européenne s’est fait jour, en 1950, lorsque Robert Schuman, au lieu de chercher à accabler les Allemands d’un nouveau « Vae victis », leur a tendu la main dans un geste de réconciliation et pour une coopération qui est le fondement de la construction européenne. Ainsi Schuman déclarait-il : « Il faut en finir avec la notion d’ennemi héréditaire et proposer à nos peuples de former une communauté qui sera le fondement, un jour, d’une patrie européenne ». Ce qui, selon René Rémond « est une initiative d’une audace inouïe, à laquelle je ne connais pas de précédent (…) ».
Parmi bien des regards croisés, cette vision historique a été particulièrement attestée par un Daniel Cohn-Bendit, à propos du rôle de l’amitié franco-allemande dans la construction européenne.
Et pour en terminer avec Schuman, on retiendra que, voici plus de quarante ans, il préparait déjà le grand élargissement que nous célébrons cette année : « Nous allons faire l’Europe », disait-il, « non seulement dans l’intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples de l’Est qui, délivrés des sujétions qu’ils ont connues jusqu’à présent, nous demanderaient leur adhésion ».
Avant d’en venir à l’examen de cet événement majeur, il convient d’évoquer un dernier aspect de l’expérience acquise, depuis un demi-siècle, dans le cadre de la construction européenne. Il s’agit d’un sujet beaucoup moins connu, mais d’une grande portée virtuelle, que Robert Toulemon a traité sous le titre « De la construction européenne à la réforme des Nations-Unies ». Il résume lui-même sa réflexion comme suit :
« Qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive, deux menaces qui pourraient un jour n’en faire qu’une, de la prévention des génocides, de la sauvegarde des climats et de la diversité biologique, enfin de la satisfaction des besoins humains fondamentaux, l’Organisation des Nations Unies dans ses structures héritées du deuxième conflit mondial n’est manifestement pas en mesure de définir et moins encore d’imposer un ordre mondial moins anarchique, une politique de survie à l’échelle universelle. Pour y parvenir, l’Organisation devra surmonter le blocage résultant de souverainetés étatiques, pour la plupart impuissantes mais paralysantes. Elle devra expérimenter l’exercice en commun de la souveraineté, sans que cela apparaisse comme le déguisement d’une ou plusieurs hégémonies. Or il existe un continent qui, pour avoir subi les conséquences d’un nationalisme paroxystique et y avoir perdu son ancienne suprématie, a poussé plus loin que cela n’avait jamais été fait ni même imaginé, l’exercice en commun de la souveraineté. Cette expérience, l’expérience communautaire européenne, présente un intérêt qui dépasse les frontières du continent. Considérée dans le reste du monde avec parfois plus d’attention que dans ses propres frontières, cette expérience pourrait très utilement inspirer la profonde réforme des Nations Unies qui s’imposera tôt ou tard ».
II – LE GRAND ELARGISSEMENT ET LA QUESTION DES LIMITES DE L’UNION
Ce grand élargissement porte sur dix économies présentant de tels retards par rapport à la moyenne des quinze que leur intégration aurait été pour le moins insolite si les nouveaux pays membres n’avaient pas été issus de la même culture européenne. En effet, les soixante-dix millions d’habitants des dix représentent 25 % de la population des quinze, mais seulement 10 % de leur richesse. Cela explique la montée d’inquiétudes croisées : d’un côté, les nouveaux membres craignent qu’un manque de compétitivité ne les affaiblisse encore ; de l’autre, certains membres anciens sont hantés par la crainte des délocalisations. Selon un sondage récent , 88 % des Français estiment que les délocalisations constituent un phénomène grave.
Dans ces conditions, il est particulièrement important de prendre en compte l’impressionnante série de témoignages suggérant combien l’appartenance à l’Union a permis d’accélérer le renforcement structurel de nombreux pays membres. C’est d’abord celui de Raymond Barre, montrant comment l’Europe a contribué efficacement à l’adaptation de la France et au rattrapage de ses retards ; celui de Jacques Delors, soulignant que le jeu combiné de la concurrence et de la solidarité a permis à la Communauté de susciter un essor incomparable de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce ; enfin, le témoignage de Pascal Lamy sur l’efficacité des politiques communes au profit des mêmes économies moins développées converge avec les études de Jean-Dominique Giuliani, montrant à quel point, sous l’angle économique, le grand élargissement est globalement conforme à l’intérêt commun des nouveaux et des anciens pays membres.
D’autre part, si, dépassant les considérations économiques, on aborde les aspects culturels et sociétaux, on constate qu’il ne s’agit nullement d’un élargissement artificiel mais, tout au contraire, d’une réunification cautérisant les blessures de l’histoire. D’ailleurs, les pays d’Europe Centrale sont ceux dont la conscience historique est, de loin, le facteur le plus déterminant de la pensée et de l’action politiques.
Cette conscience historique a été particulièrement soulignée par Madame Sandra Kalniete, ancienne ministre des Affaires étrangères de Lettonie, née dans un goulag ! : pour elle, c’est seulement le jour de la réunification de l’Europe, le 1er mai 2004, que « la page de la seconde guerre mondiale a pu être, enfin, définitivement tournée sur la carte géopolitique européenne ». Et cette Europe dont les Pays Baltes, notamment, sont désormais membres à part entière, est loin d’avoir pour unique vocation la prospérité économique : « il ne faut jamais oublier que la vocation de l’Europe n’est pas seulement d’être une source de bien-être ou un marché commun. L’Europe est d’abord un espace culturel où sont nées les valeurs fondamentales de la civilisation moderne ».
Dans l’ensemble des nouveaux pays membres, on est frappé de voir les progrès rapides de la démocratisation, l’apaisement des vieilles querelles ethniques, le meilleur traitement des minorités. Tous ces premiers succès sont, dans une large mesure, la conséquence de ce que, depuis dix siècles, ces pays ont appartenu à la seule Europe unie qui fut, celle – on l’a dit – de la spiritualité, des mœurs et de la culture. C’est ainsi que les nouveaux membres enrichissent l’Union européenne de quatorze Prix Nobel. Un autre exemple emblématique est donné par Bronislaw Geremek, ancien ministre des Affaires étrangères de Pologne. Il insiste, notamment, sur la réconciliation polono-allemande, qui paraissait quasi-impossible et qui s’est, dit-il, « opérée avec une stupéfiante rapidité ». La confiance que Geremek fait à la vertu pacificatrice de l’Union européenne est telle que le meilleur moyen, selon lui, de contribuer à la perspective d’un apaisement entre Israël et la Palestine serait de faire espérer à ces deux pays leur entrée possible dans l’Union européenne…
Cette audacieuse remarque a été présentée à l’Académie en mai dernier. A l’époque, nul n’imaginait le puissant mouvement populaire qui allait établir, fin 2004, la démocratie en Ukraine et attirer ce pays vers l’Union européenne. Qui plus est, seuls quelques observateurs particulièrement avertis, tel Thierry de Montbrial, plaçaient « la question turque » au premier rang de leurs préoccupations pour l’Europe, anticipant ce qui est devenu éclatant depuis lors. A la suite de la recommandation d’ouverture des négociations d’adhésion présentée par la Commission européenne le 6 octobre et son approbation par le Conseil européen du 17 décembre, il est clair, désormais, que cette question turque – extraordinaire ferment de discorde, non seulement entre les différents peuples, mais, en France, au sein des principales formations politiques – ne saurait manquer de prendre une large place auprès des deux événements historiques de 2004.
En effet, par delà les argumentaires croisés qui, chaque jour, défraient désormais la chronique, la question des limites de l’Union européenne met en cause à la fois les fondements culturels de l’Europe et son projet d’avenir, sans parler de son modèle social et familial.
Sur le premier point, Alain Besançon note que les frontières historiques de l’Europe correspondent partout à un même marqueur culturel, celui de l’art gothique – c’est-à-dire de la chrétienté d’Occident –, lesquelles coïncident avec celles de l’Europe des vingt-cinq. Quant à son projet d’avenir, la question, selon Jean-Claude Casanova, est de savoir si nous concevons l’Europe comme une identité politique enracinée ou comme un marché unique universel. Et qu’on ne vienne pas dire que, si la Turquie n’en était qu’un partenaire privilégié et non pas un membre de plein droit, cela renforcerait le fondamentalisme islamique ! Cet argument, ajoute-t-il, est un chantage qui revient à demander à l’Europe de régler le problème de l’évolution historique des musulmans par l’élargissement indéfini de l’Union européenne…
Les musulmans n’en ont d’ailleurs nullement envie. Considérant l’Europe vue du monde musulman, Antoine Sfeir note que la Turquie tient une place à part aux yeux de la communauté musulmane, laquelle, par ailleurs, comprend mal l’Union européenne étant donné que c’est l’Europe elle-même qui a, pour la première fois, institué des frontières d’Etat au sein de cette communauté musulmane, la Oumma. Enfin, l’Europe étant devenue areligieuse, elle ne paraît plus guère respectable. Moins respectable même, sous cet angle, que les Etats-Unis eux-mêmes…
Alors que les gouvernements se déclarent tous favorables à l’adhésion conditionnelle de la Turquie, une large part des populations y est opposée. En France, cette opposition est si vive que la première raison invoquée par bon nombre d’adversaires du projet de Constitution est précisément leur refus de la Turquie comme membre à part entière de l’Union. La question turque se révèle donc être une source d’interférences entre les problèmes de l’élargissement et ceux de la Constitution. Le résultat du référendum constitutionnel annoncé en France pour 2005 risque fort d’en être affecté. Jadis, on désignait l’Empire Ottoman comme « l’homme malade de l’Europe ». Certains se demandent si l’on ne pourrait pas craindre, désormais, que l’Europe ne risque de devenir « l’homme malade de la Turquie » ?
Mais, si importants que soient ces problèmes liés à l’élargissement et aux limites d’une Union européenne, qui comptera bientôt trente membres, voire plus, ils ne doivent pas nous faire oublier le défi majeur pour l’Europe que trois de nos communicants ont souligné : le premier, Jean-Claude Chesnais, est démographe ; le deuxième, Theodor Berchem, est président de l’université de Würzburg et professeur au Collège de France ; le troisième est une femme, une femme asiatique, Madame Tchen Yu-Chiou, alors ministre de la culture de Taïwan. Leurs regards croisés tirent l’alarme sur les dramatiques retards des pays d’Europe en matière de recherche et de développement. Il en ressort que la priorité des priorités pour l’Union consiste à se doter, enfin, de politiques volontaristes dans ce domaine. Et, n’eût été la gravité du sujet, ils auraient pu ajouter : en cessant de s’enivrer de grands mots creux, comme ceux du Conseil européen de Lisbonne qui, en mars 2000, osa donner pour objectif à l’Union de devenir, à l’horizon 2010, « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Moyennant quoi, à peu près rien n’a été fait depuis lors, contrairement à ce qui se passait pendant les « trente glorieuses », lorsque l’Europe rattrapait son retard en matière nucléaire, aéronautique et spatiale.
A l’époque où l’hyperpuissance américaine et l’immense surgissement des nouvelles puissances asiatiques viennent mettre au défi, comme jamais, les économies et les sociétés de la vieille Europe, la priorité des priorités, pour elle, est de reconstruire l’équivalent contemporain de la « République des lettres », c’est-à-dire un réseau d’excellence au niveau mondial en matière universitaire et de recherche scientifique. A cet égard, les propositions présentées par le Professeur Theodor Berchem sont particulièrement fortes : mobiliser « toutes les forces dans un effort européen commun » par ce que c’est le seul moyen de relever le nouveau défi américain. Tel est aussi le message final qui ressort de la réponse donnée par Jacques de Larosière à la question d’ensemble : « Comment l’Europe peut-elle rattraper l’économie américaine ? » La principale faiblesse de l’économie européenne est aujourd’hui liée, d’abord, au fait que, par rapport aux Etats-Unis, les pays européens consacrent en moyenne à l’enseignement supérieur moitié moins de ressources en pourcentage du PIB , en suite au manque d’ouverture des universités européennes sur le monde économique. C’est ainsi qu’il vient appuyer fortement la conclusion des trois précédents communicants en soulignant la priorité qu’il y a « à promouvoir, entre universités, centres de recherches, pouvoirs publics et entreprises, de véritables réseaux interactifs ».
III – LES ENJEUX DU TRAITE CONSTITUTIONNEL
Soit directement par référendum, soit indirectement par la voie parlementaire, la population sera appelée à se prononcer prochainement sur le Traité constitutionnel, mais pas toujours sur la question turque. Et cela, alors même que cette question turque, qui réveille tout un travail de mémoire historique et de sensibilité géographique, est évidemment plus concrète et plus passionnante que le texte constitutionnel, si remarquablement rédigé soit-il.
Dans ces conditions, il sera difficile, semble-t-il d’éviter que bon nombre d’adversaires de la candidature turque ne viennent se joindre aux adversaires du Traité. Autrement dit, parmi les différents regards qui se croisent sur ce sujet complexe, certains ne sont pas dépourvus de strabisme.
Or, ce qui est en cause avec le Traité constitutionnel, c’est une étape absolument décisive de la construction européenne, et cela pour trois raisons essentielles.
La première est tout simplement qu’en application du Traité, l’Union européenne ne serait plus seulement un espace économique doté d’instruments juridiques et politiques spécialisés, mais une véritable union politique fondée, comme on le voit dès aujourd’hui à travers les vicissitudes de la Commission Barroso, sur un renforcement des pouvoirs du Parlement.
La deuxième raison est que ce saut qualitatif se résume par l’emploi même du mot « constitution » qui était, hier encore, interdit, car politiquement incorrect…
La troisième raison est que, rassemblant désormais non plus seulement des Etats mais aussi les citoyens de ces Etats, l’Europe serait, notamment, dotée d’un président permanent du Conseil européen élu pour deux ans et demi renouvelables, président qui donnerait enfin un visage à l’Union.
Autrement dit, la ratification du Traité constitutionnel serait virtuellement porteuse, au plan politique, d’une mutation analogue à la création de l’euro en matière monétaire.
A l’instar de la Communauté européenne elle-même, la création de l’euro, monnaie entièrement nouvelle, issus de onze, puis de douze monnaies, est une innovation absolument unique, sans aucun précédent dans toute l’histoire monétaire. Comme nous l’a dit Jean-Claude Trichet, « L’euro est non seulement un symbole d’unité, mais aussi un emblème de la possible future souveraineté politique européenne, celle qui s’épanouirait dans une véritable fédération politique achevée, si telle était la volonté des peuples européens ».
Il est particulièrement intéressant de noter, sur ce point, l’opinion de Félix Rohatyn, ancien ambassadeur des Etats-Unis en France : « L’introduction de l’euro fut couronnée de succès. Accomplissement remarquable (…), l’introduction d’une monnaie unique avec sa propre banque centrale par douze démocraties modernes avancées était symbolique d’une nouvelle Europe (…) malgré un certain scepticisme en Amérique quant à la nouvelle devise, les débuts de l’euro ont justifié les attentes ». Cette opinion est fortement corroborée par Lord Simon of Highbury, qui a démissionné du gouvernement britannique lorsque celui-ci a refusé d’entrer dans la zone euro.
Sur un plan plus général, dès la première page du texte, le Traité définit les principes d’un véritable modèle européen : « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe, fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi, au progrès social et à un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement (…). Elle promeut la justice et la protection sociales ».
Certains ont reproché au Traité d’être trop timide en ce qui concerne les politiques sociales. C’est un point qui a été relevé, notamment, par Romano Prodi, alors Président de la Commission européenne. De même, Madame Nicole Notat a souligné que « le modèle social est au cœur de l’identité européenne », et l’économiste belge Philippe de Woot a dégagé les traits essentiels de l’entreprise européenne socialement responsable.
Mais rien de cela n’accrédite pour autant, au plan européen, l’opinion de ceux qui, en France, accusent le Traité constitutionnel d’être un sous-produit de « l’ultra-libéralisme » américain. Le Traité constitue au contraire, selon le britannique John Monks, Secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats (CES), « une réponse à la mondialisation américaine ». Ce type d’opinion est soutenu non seulement par les syndicats européens, mais par la quasi-totalité des partis sociaux-démocrates. Ainsi, Jorge Sampaio, Président de la République du Portugal et socialiste, déclare : « On y reconnaît le principe de cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union. On y réitère la volonté d’approfondir les politiques communes pour garantir un avenir de prospérité, de sécurité et de justice ».
Il n’empêche qu’en France, depuis la fin de l’été 2004, certains dirigeants politiques de l’opposition préconisent un vote négatif au référendum prévu pour 2005, au nom de leur attachement au « modèle social français ». Ils pourront peut-être en influencer, voire en modifier le résultat, au point d’aboutir à un veto de la France. Cela créerait une inconnue majeure pour l’avenir de l’Europe. Mais, sur le fond des choses, ce veto serait vain. En effet, il n’aurait aucune chance de susciter, dans l’opinion des pays partenaires, un soutien à ce « modèle social français », dont le rapport Camdessus Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France vient de dénoncer l’échec indiscutable, tant en ce qui concerne ses ruineuses conséquences sur les finances publiques que ses responsabilités concernant les désastreux taux de chômage qu’il entretient.
A peine l’encre du deuxième Traité de Rome est-elle sèche que les gouvernements se préparent à décider d’ouvrir des négociations normalement destinées à déboucher sur l’adhésion de la Turquie. Ces deux décisions peuvent apparaître comme des avancées complémentaires à court terme : elles devraient bénéficier d’un double « oui », notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. Mais toute autre est la situation, en Grande-Bretagne d’abord, où le référendum annoncé par le gouvernement Blair risque fort d’aboutir à un « non ».
Quant à l’opinion française, qui ne perd jamais une occasion de se séparer sur les grandes questions de principes, elle est profondément divisée, tant sur le Traité que sur la question turque. En ce qui concerne le Traité constitutionnel, une large partie de la gauche vient renforcer les souverainistes dont les thèses ont été exposées par Philippe de Villiers et conduisent à un double « non ». Selon Virgilio Dastoli, les nouvelles orientations du fédéralisme s’accommodent du Traité, notamment au regard du principe de subsidiarité et de la doctrine sociale de l’Eglise. Concernant d’autre part la question turque, on ne trouve guère, en France, de trace de l’idéologie du « club chrétien ». C’est ainsi que, traitant de « L’Europe et Dieu », le catholique Jean Boissonnat a précisé qu’il ne regrette pas l’absence, dans le préambule du Traité, de toute référence à l’héritage chrétien. Il se satisfait de celle qui porte sur les « héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe ». Pour le reste, ayant montré comment Dieu a fait l’Europe et l’Europe a défait Dieu, il est, selon lui, « dans la vocation du christianisme, de se déseuropéaniser s’il veut offrir un visage accueillant aux masses asiatiques qui ne le connaissent pas : si l’Europe n’est plus institutionnellement chrétienne, elle peut l’être davantage spirituellement ».
Autant la question du Traité déchire la gauche, autant la question de la Turquie divise la droite. Les adversaires de l’adhésion y puisent souvent leurs convictions sur ce que Jean-Claude Casanova appelle « l’heure de vérité pour l’Europe » : « deux visions de l’Europe s’affrontent : l’une est politique et historique (…), il s’agit de construire une patrie européenne avec des frontières claires issues d’une histoire commune. Pour l’autre vision, il s’agit d’étendre la démocratie et le marché, sans se préoccuper de l’histoire ou des frontières. Ces deux visions sont irréductibles l’une à l’autre ».
Par ailleurs, les adversaires de l’adhésion sont largement soutenus par des courants d’opinion spontanés, peu organisés, mais particulièrement vifs parmi les catégories défavorisées de la population, qui comptent, semble-t-il, de nombreux électeurs prêts à voter « non » au référendum constitutionnel pour exprimer leur rejet de la candidature turque.
Dès lors, on ne peut échapper à la question : que se passerait-il si le « non » l’emportait en France au référendum de 2005 ? Une réponse plausible, me semble-t-il, est celle d’un homme politique particulièrement respecté : Jean-Claude Juncker, Premier Ministre du Luxembourg, nommé Président de l’Eurogroupe. Voici cette réponse : « Un « non » de la France conduirait l’Europe dans une crise absolue où il n’y aurait plus aucun idéal européen à poursuivre. Ce serait l’immobilisme absolu ». A l’inverse, l’ambition affichée dès le préambule du Traité est de faire de l’Europe « un espace privilégié de l’espérance humaine ».
Mais quelle est la portée concrète de ce grand projet ? Deux regards croisés ont, pour terminer la série des séances de l’Académie sur l’Europe, proposé des réponses contrastées à cette question. Ils émanent respectivement d’Alain Lamassoure et du Chancelier Pierre Messmer.
Pour le parlementaire européen qui a joué un rôle particulièrement actif au sein de la Convention présidée par Valéry Giscard d’Estaing, le projet de Constitution qui en est issu présente un caractère littéralement révolutionnaire : il confère à l’Union une véritable puissance législatrice ; il la dote de dirigeants propres « clairement identifiés et, pour les plus importants, élus par les citoyens ». En effet, la nouvelle révolution européenne, si elle est ratifiée à l’unanimité comme elle l’a été adoptée, sera une révolution démocratique sans aucun précédent et caractérisée par une véritable irruption juridique des citoyens, une « déferlante démocratique ».
Traitant de « La nouvelle problématique de la construction européenne », le Chancelier Pierre Messmer est moins enthousiaste. Il estime, en premier lieu, que, si la ratification à l’unanimité du Traité devait échouer, ce ne serait pas « une catastrophe, l’Union ayant été créée et s’étant développée sans Constitution depuis sa naissance ». En revanche, l’adhésion éventuelle de la Turquie poserait, notamment, deux redoutables problèmes de frontières : elle donnerait pour voisins à l’Union européenne des pays « turbulents » tels que la Syrie, l’Irak et l’Iran ; d’autre part, elle favoriserait des candidatures telles que celles de la Géorgie, de l’Arménie … En matière de politique étrangère et de défense, M. Messmer ne pense pas que de nouvelles institutions européennes soient une condition nécessaire du rapprochement des positions et du renforcement des moyens d’action, mais qu’il faut au contraire compter sur les initiatives solidaires de certains grands pays.
Cela dit, il est d’autant plus important que, de toute son autorité en la matière, le Chancelier de l’Institut mette l’accent sur les grands projets qui devraient être ceux de l’Europe en matière de recherche scientifique et technique.
Personnages et caractères XVe-XXe siècles
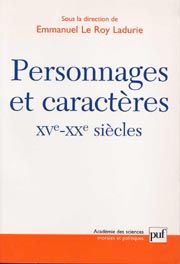
sous la direction de
Emmanuel Le Roy Ladurie
Avant-propos
Le livre ci-après regroupe les communications qui furent données et prononcées en 2003 dans le cadre de l’Académie des sciences morales et politiques (A.S.M.P.). Elles s’adressaient, avec l’aide des meilleurs spécialistes, aux thèmes de la biographie et plus généralement de la personnalité, envisagée sous l’angle d’une réflexion, et non pas simplement d’un récit qui serait relatif au déroulement événementiel de telle ou telle existence particulière. En tant que président de cette compagnie pour l’année mise en cause, j’ai d’autre part organisé dans le même esprit un colloque (au mois d’octobre 2003), lequel concernait des sujets proches du thème académique précédemment indiqué (soit : Le meilleur et le pire, personnages et caractères, titre de notre entreprise collective “ ASMP ”). Ce colloque donnait de surcroît à l’ensemble de nos débats, et au livre qui en résulte ici, un élément d’unité terminale, en bref une perspective d’ensemble en forme de ligne de fuite ou d’experimentum crucis, ou tout simplement de point focal ; il s’agissait pour le coup de développements, et de communications relatives à l’ouverture, concernant un certain nombre de personnalités elles aussi du monde moderne et contemporain (XVIe-XXe siècle), monde politique, religieux, culturel… Ce problème, devenu classique en notre temps, de l’ouverture se référait, s’agissant de son point de départ, au livre bien connu de Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis. Le susdit colloque qui sera édité séparément s’avérera, somme toute, complémentaire de la publication du présent ouvrage.
Il m’est agréable, en ce contexte, de remercier du fond du cœur M. Edouard Bonnefous, chancelier honoraire de l’Institut de France et M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, sans lesquels une telle entreprise “ duelle ”, au titre de l’Institut de France, en sa ramification morale et politique, n’aurait pu voir le jour.
Emmanuel Le Roy Ladurie
Sommaire
Introduction — Emmanuel LE ROY LADURIE
Chapitre Premier — La Scienza nuova, fragments d’une grande bibliothèque
Alain PONS — Vico
François STASSE — Vieille Dame, grande Dame : la BNF
Olivier TODD — Malraux, épidémiologie d’une légende
Alain BESANÇON. — Dostoïevski
Marc FUMAROLI — Continuité et changement du caractère français dans les Mémoires d’outre-tombe
Chapitre II — Dieu et Son homme
Régis DEBRAY — Dieu
André DAMIEN — Jean-Paul II
Chapitre III — Héros et fondateurs
Pierre MESSMER — De Gaulle en direct
Jean-Paul BLED — Bismarck
Wladimir BERELOWITCH — Pierre le Grand
Chapitre IV — De quelques rois Bourbons
Jean-Christian PETITFILS — Louis XIV
André ZYSBERG — Les Bourbons à bon port
Guy CHAUSSINAND-NOGARET — Louis XVI
Chapitre V — Le peuple
Henri AMOUROUX — Le peuple français comme acteur de l’Histoire (1940-1944)
Chapitre VI — Démocrates et Républicains
Michel ALBERT — Robert Schuman
Anthony ROWLEY — Churchill
Georges-Henri SOUTOU — Gorbatchev
Chapitre VII — Autoritaires et Totalitaires
Pierre MILZA — Mussolini
Bartholomé BENNASSAR — Franco
Nicolas WERTH — Lénine
Stéphane COURTOIS — Staline
Marianne BASTID-BRUGUIÈRE — Mao Zedong
Claude DULONG-SAINTENY — Hô Chi Minh
Marc FERRO — Goebbels et Staline face à Roosevelt. Conceptions diverses de la propagande
Philippe BURRIN — Hitler
Marc LAZAR — Trotski, les trotskistes et la France
Chapitre VIII — Femmes : mystique et politique
Fanny COSANDEY — La reine de France à l’époque moderne
Philippe CONTAMINE — Jeanne d’Arc
Philippe CHASSAIGNE — Thatcher
Conclusions
Emmanuel LE Roy LADURIE — Monstres honnis, monstres sacrés
Jean-Pierre BARDET — Les sources autobiographiques
Denis MARAVAL — Au regard d’un éditeur, la Biographie
Introduction
Emmanuel Le Roy Ladurie
Le pire… Le meilleur… Notre année académique a oscillé entre ces deux pôles, au gré des communications qui composèrent le programme annuel mis en cause et dont je tenterai de faire une synthèse initiale dans le texte ci-après.
On me permettra d’abord de placer cette introduction(1) sous le signe de Gianbattista Vico, brillamment explicité, ici même, face aux Académiciens des sciences morales, par M. Alain Pons, spécialiste de la pensée de ce grand auteur italien. Vico a proposé une série de classifications à sept termes, plus riche, somme toute, que le vieux système trifonctionnel à trois fonctions cher à Dumézil. D’icelui le thème est connu : la fonction cléricale, première fonction dumézilienne ; les nobles et/ou militaires, éventuellement héroïques, deuxième fonction ; enfin, en tierce position, les paysans, ou tout simplement le peuple, voire le tiers état, y compris la bourgeoisie ; disons au total oratores, bellatores, laboratores : ceux qui prient, ceux qui font la guerre, ceux qui labourent la terre. Braudel me disait un jour, avec beaucoup d’admiration de sa part : Dumézil a eu trois très grandes idées dans sa vie, la première fonction, la deuxième fonction, la troisième fonction – celles-là même que je viens d’énumérer. A vrai dire qui d’entre nous ne serait pas ravi d’avoir eu au moins trois idées importantes dans son existence… C’est le plus bel hommage qu’on puisse rendre à cet immense savant qu’était Dumézil. Néanmoins Braudel et Dumézil, ce sont là jeux de princes qui passent très au-dessus de la tête des modestes mortels, sinon immortels que nous sommes. Venons-en par conséquent, à Vico. Sa série se décline comme suit, sur le mode approximatif, dans la Scienza nuova : 1) les Géants ou les Monstres ; 2) les dieux ; 3) les héros ; 4) le peuple et sa culture – incidemment les dieux, les héros, le peuple, ce sont les trois fonctions duméziliennes dont je parlais tout à l’heure ; 5) les Républicains ; 6) la Monarchie, éventuellement impériale ; 7) les femmes dont l’action selon Vico, reproductive, conjugale et familiale traverse, inévitablement les six catégories précédentes, ce qui après tout, est tout à l’honneur de l’élément féminin en question. Même si le féminisme actuel, non sans raisons voit les choses tout autrement et d’une façon infiniment plus ouverte. Au surplus aurai-je l’occasion, en fin de parcours, de politiser ou même de “ mysticiser ” les femmes évoquées de la sorte.
Dans la liste des personnages, personnalités, caractères, qui ont illustré, sur le mode partiellement biographique, notre année d’académie, la place des Géants, ou plutôt en ce qui concerne nos travaux d’un an, celle des Monstres, serait à chercher – c’est le numéro Un de Vico, voyez supra – du côté de personnages plutôt sinistres, les fameux “ monstres ” en question, même si ces hommes ne sont évidemment pas monstrueux à 100 % (au minimum, à 99,99 %), dès lors qu’il s’agit “ d’abominables bonhommes ”, en effet, comme Hitler ou Staline. Mais point ne serait convenable d’inaugurer le présent rapport par les noms tout à fait révoltants du chef national-socialiste, ou du dictateur de l’URSS. C’est pourquoi je débuterai mon exposé par les hommes de Dieu – André Damien nous a superbement parlé de Jean-Paul II – et peut-être rappellerai-je simplement ici deux épisodes de la vie ou de l’action de cet homme, Wojtyla, à la fois homme de paix, tombeur aussi d’un certain soviétisme. Et d’abord, ce Pape a refusé une condamnation ex-cathedra de l’athéisme communiste, parce que, lui, Jean-Paul II, souhaitait que tout vienne, que tout procède, en cette affaire, d’une pure, simple, et intime conviction intérieure, sans diktat extérieur. Il a conservé aussi au concept certes égalitaire à son gré de peuple chrétien ou de peuple de Dieu cependant que la vieille notion de hiérarchie ecclésiastique (et autre, voyez Louis Dumont) restait pour lui essentielle ou plus fondamentale. Faudrait-il dire de la part de Jean-Paul II : un coup à droite, préservation de la hiérarchie ; un coup à gauche, point trop de condamnations simplistes d’un athéisme communiste ?…
Je m’aperçois que j’ai évoqué le Jean-Paul II de notre confrère Damien avant de mentionner et plus que mentionner l’excellent Dieu de M. Régis Debray. Je ne puis que citer sa conclusion, la conclusion de Debray, toujours précise et pleine d’humour, comme si souvent dans la prose que je me permettrai d’appeler “ régissienne ”. Régis Debray – c’est lui qui parle – déclare en évoquant l’un de nos grands déistes anticléricaux : “ Dieu, écrit Voltaire, a fait l’homme à son image, et l’homme le lui a bien rendu. Un humaniste respectueux des divins mystères – Debray en personne sans doute – serait plutôt tenté de renverser la vapeur. L’homme a fait Dieu à son image ; or le Dieu de Moïse et de Josué, de saint Vincent de Paul et de la Saint-Barthélemy, de Ib’n Arabi et de Bin Laden le lui a bien rendu. Parfois même au centuple. ” Comme quoi les diverses facettes du problème divin, le meilleur et le pire sont abordées avec impartialité, générosité aussi par M. Régis Debray.
Des hommes de Dieu, passons aux héros. De Gaulle s’offre à nous, tout naturellement, grâce au chancelier Messmer qui nous mit en scène, en fonction de son expérience courageuse et personnelle, un admirable “ De Gaulle en direct ”. Le cursus biographique de M. Messmer fut assez héroïque, lui aussi, à divers moments fondamentaux. Il reste que l’un des plus grands mérites de De Gaulle, vers la dernière partie de sa vie, c’est d’avoir donné à la République une colonne vertébrale quelque peu monarchienne ou monarchisante en l’occurrence, basée sur l’Institution d’une certaine Présidence républicaine, style Cinquième République en effet. Ainsi aurons-nous eu dans toute notre histoire cinq dynasties, cinq “ races ”, comme on disait autrefois, d’un mot aujourd’hui banni, cinq lignages successifs à la tête du pays : les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Napoléonides… et les Républicains, en la personne, tout dernièrement, des quatre chefs d’État qui succédèrent ou succèdent à De Gaulle. Leurs noms sont sur toutes les lèvres : Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac.
Le peuple et sa culture, troisième catégorie de Vico. Henri Amouroux a évoqué pour nous le peuple français, spectateur et acteur de l’histoire entre 1940 et 1944 ou 1945. Et peut-être à mon gré la date la plus essentielle, au cours d’un tel quinquennat très approximatif, est-elle novembre 1942, première quinzaine de ce mois, quand Stalingrad est encerclé, quand les Américains débarquent en Afrique du Nord, quand Rommel doit plus ou moins se retirer de toute une partie de la Libye, quand le sort de la Seconde Guerre mondiale, pivote en somme comme un décor ou une scène de théâtre, mais ce n’est pas du Feydeau, plutôt du Shakespeare. Dans son Journal intime, à la date même de cette “ quinzaine ”, et dès ce moment, avec lucidité, Drieu la Rochelle annonce qu’il va se suicider ; il a tenu parole. Quant à Josée Laval, comtesse de Chambrun, désespérée, elle croit revivre, mais dans le vice versa, les heures tragiques de mai-juin 1940.
Le peuple et sa culture… Ici prend place l’excellent exposé de M. Stasse sur la Bibliothèque nationale de France, en tant que celle-ci est personnage ou personnalité collective, de nos jours émanée du peuple français constituant lui-même la base de nos institutions en effet nationales. Cette Bibliothèque a ses zones d’ombres – l’absurde architecture de l’établissement de Tolbiac n’est pas fonctionnelle, même si à l’usage elle acquiert une sorte de dimension gaullienne ; mais l’informatisation des catalogues, le confort intérieur, la richesse livresque immense de la maison, en font à bien des égards une vraie réussite, appréciée notamment par beaucoup d’étudiants venus des USA, y compris ceux d’une grande Université américaine : elle vient d’acquérir un ensemble immobilier important, paraît-il, à proximité du site Tolbiac.
Le peuple et sa culture, dans l’esprit de Vico, encore lui : on peut se reporter à ce sujet au grand exposé de M. Fumaroli sur l’avant et l’après-Révolution française, au gré de Chateaubriand. Je laisserai ci-après la parole à cet éminent historien de la littérature qu’est Marc Fumaroli, je dirai simplement ici ce qui est je crois le sentiment de beaucoup de membres de l’Académie des sciences morales : la Révolution française est incontournable, comme transition de l’Ancien Régime à une démocratie encore lointaine ; celle-ci, selon Furet, ne devant connaître tout à fait son avènement qu’à partir de 1880 ; mais c’est une Révolution par ailleurs, quelquefois déraisonnable, dérapée, selon le mot de Denis Richet, lors des années sanglantes du robespierrisme. Elle incarne ainsi au plus séduisant ou au plus déplorable sens de ce couple de mots, le meilleur et le pire, ne disons pas l’enfer et le paradis, puisque aussi bien le second à la différence du premier ne fait pas nécessairement partie de notre univers concret, quotidien, planétaire.
Le peuple et sa culture à la Vico, toujours, Alain Besançon sera certainement surpris d’être placé par mes soins sous cette rubrique, qui n’est vraiment pas sa tasse de thé. Besançon a pourtant souligné, de façon convaincante l’anomisme ou l’antinomisme hyperchrétien du grand écrivain russe, Dostoïevski, ses délires, ses mensonges et ses folies qui deviennent ensuite sous d’autres regards, sous d’autres cieux, la vérité et la sagesse dostoïevskienne en effet.
Nous en arrivons maintenant à l’immense troupe de ce que Vico appellerait les Républicains. Mais en fait il faudrait y inclure une population beaucoup plus vaste, les hommes d’État des démocraties, certes, mais aussi les pas vraiment républicains, les dictateurs que nous avons évoqués en une cohorte assez bigarrée, parmi lesquels quelques-uns des monstres dont j’ai évité de parler au début du présent exposé pour ne pas inauguré mon discours par une redoutable fausse note.
On se référera d’abord, parmi les Républicains authentiques, à l’exposé de notre confrère Michel Albert, relativement à Robert Schuman ; personnage peut-être mûr pour la béatification, voire la canonisation, puisqu’il est mort, dit-on, après une vie admirable de créativité politique au cours de laquelle il avait, à ce qu’on m’a raconté, préservé entièrement, la pureté de son baptême, ou comme disait autrefois le duc de Saint-Simon, “ il avait préservé son innocence baptismale ”. Il en irait de même, du reste, de Newton, semble-t-il.
Nous rangerons, sans doute possible à mon sens, M. Gorbatchev dans la catégorie des démocrates. Se fussent-ils rendus dignes de cette titulature un peu sur le tard. Et sur ce point, je ne puis que citer la belle conclusion de M. Soutou :
“ Malgré toutes les critiques qu’on peut lui faire, le grand mérite de Gorbatchev devant l’Histoire sera d’avoir compris le caractère inéluctable d’un bouleversement qu’il avait lui-même lancé, même s’il dépassa ses intentions initiales, et d’avoir accepté que ce bouleversement se produise sans effusion de sang en Allemagne ou en Europe orientale, et en URSS même de façon beaucoup moins dramatique que l’on ne pouvait le craindre. Quant à sa volonté, progressivement clarifiée, de sortir du communisme mais de façon ordonnée et sans rupture brutale, elle pose une question de fond passionnante sur le communisme soviétique lui-même : était-il ou non capable de se transformer de façon à aboutir à quelque chose de tout à fait différent ? Sur le plan théorique on peut en douter ; mais sur le plan historique pratique, si on constate que Gorbatchev n’a pas pu éviter une rupture, au lieu de la transition qu’il souhaitait, on constate également que la société soviétique, dans une complexité qui nous apparaît aujourd’hui plus clairement, était capable de sécréter des anticorps et que l’Homo sovieticus n’avait pas tout envahi. Sans oublier bien sûr la fermeté et en même temps l’ouverture de la politique occidentale depuis 1947, selon l’inspiration définie dès le départ par Georges Kennan, visant à résister prudemment à l’URSS pour l’amener à se transformer de l’intérieur : sans cette politique, pas de Gorbatchev. ”
Nous en arrivons maintenant à une tout autre catégorie, celle des dictateurs. M. Milza nous a donné un portrait très détaillé de Mussolini et il a intégré les analyses fondamentales de De Felice, biographe du Duce, et vraisemblablement le plus grand historien italien, ou l’un des plus grands du XXe siècle. Pourtant la scène mussolinienne la plus intéressante et la plus importante peut-être décrite par Milza se trouve dans la biographie du Duce, rédigée par ce même auteur. C’est la scène au cours de laquelle, en septembre 1943, Hitler déclare à Mussolini que si celui-ci (Mussolini) n’accepte pas de reprendre le pouvoir, lui, Hitler, mettra à exécution son plan primitif consistant à détruire par bombardements Gênes, Turin et Milan. Vous remarquerez le “ goût exquis ” (!) du Führer, qui n’envisage pas de raser Florence, ni Venise, ni Rome. Et qui plus est, le même Führer traitera le peuple italien, comme un peuple esclave. Et Milza d’ajouter, page 841 de sa biographie de Mussolini : “ face à cette menace de polonisation de l’Italie, Mussolini n’avait guère d’autre choix que celui de se soumettre aux desiderata de Hitler… ”
Le remarquable Franco de M. Benassar est-il justiciable d’analyses analogues. Au lieu des banalités dualistes sur les Blancs et les Rouges, M. Benassar s’est efforcé de nous servir un Franco découpé en tranches successives, un peu comme le melon de Bernardin de Saint-Pierre que le Créateur avait pourvu de côtes, afin qu’il put être mangé en famille. Il y a la tranche des années 1930 où un Franco évidemment des plus contestables, l’adjectif est beaucoup trop faible, s’oppose à une révolution espagnole qui prend par moment des allures de processus soviétique. Puis surgit la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle de très nombreuses exécutions de Républicains sont accomplies : elles déshonorent une fois de plus le régime franquiste. Enfin, progressivement, vient l’époque de la croissance d’après guerre, y compris à l’époque du Caudillo finissant, puis au-delà.
Quoi qu’il en soit M. Benassar parle de la guerre civile espagnole comme d’une sorte d’ordalie, dont sortira beaucoup plus tard cette Espagne moderne que nous aimons et que nous admirons.
Le Lénine de M. Nicolas Werth est sans concessions. Werth voit dans ce personnage l’inventeur de la police politique et du premier Goulag des îles Solovsky. Werth ayant parlé, il ne reste pas grand-chose du leader génial, ni de la statue de ce même Lénine, ainsi déboulonnée (une fois de plus) par Werth…, il ne reste pas grand-chose de ce que des générations de communistes ont voulu présenter, au point de départ du système soviétique, comme un antidote léniniste, préalable à un stalinisme détestable.
Sur Staline, M. Stéphane Courtois ne peut s’empêcher de pousser, si je peux dire, de longs cris d’admiration. Quel prodigieux organisateur que ce Joseph Vissarionovitch ! M. Courtois, bien sûr, n’est en rien stalinien, mais il considère que Staline était parfaitement programmé pour accomplir la sinistre besogne qui laissera la Russie dans l’état délabré où elle était encore il y a peu. De nos jours, bien sûr, les choses changent et, espérons-le, vont changer encore très vite. Dans quelle direction, dans quel sens, il serait difficile de le prédire, et je n’ai pas la prétention d’être prophète à ce propos.
Quant à Hô Chi Minh, cet autre président-dictateur, je crois qu’il faut quand même employer ce “ syntagme ”, Mme Dulong-Sainteny nous a donné un texte important, qui condense notamment une grande partie de son expérience personnelle au Vietnam, qui condense aussi de nombreuses et savantes lectures de la part de cette historienne.
Nous avons beaucoup de chance en ce qui concerne cet étonnant personnage que fut Hô Chi Minh, même si les Vietnamiens ont eu parfois moins de bonheur avec lui, puisque vient d’être réédité une biographie d’Hô Chi Minh, biographie due à M. Brocheux. Hô Chi Minh est incontestablement un grand homme quant au nation-building, un personnage souvent cruel, pourquoi ne pas le dire, et ne faisant pas toujours beaucoup de cas de la vie humaine, fut-ce par personne interposée. On nous dit que ses amis “ exécutèrent ”, la phrase est de M. Brocheux, les trotskistes vietnamiens. Ne pourrait-on s’exprimer plus clairement et faire remarquer que ceux-ci furent tout simplement assassinés ?
Mme Dulong-Sainteny est parfaitement consciente de l’essence totalitaire, oppressive, et goulaguisante de certains aspects du régime mi-politique, installé au temps de ce leader. Reste que cet étonnant individu, Hô, aimait les fleurs, qu’il écrivait de jolis poèmes, et que son récent biographe a pu de la sorte en faire une personnalité complexe et séduisante, à mi-chemin de l’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, et des petits vieillards modèles de la comtesse de Ségur.
Sur Mao Tsé-toung, Mme Bastid-Bruguière a eu de singuliers mérites : il lui fallait à la fois faire connaître un personnage dont l’essentiel des actions était presque inconnu de beaucoup d’entre nous, et en même temps tirer de lui, les idées générales et les conclusions de portée universelle qu’on attend d’un conférencier parlant de De Gaulle ou de Bismarck, deux hommes qui sont l’un et l’autre plus proches de nous que Mao, et là aussi, je ne puis mieux faire que de citer la conclusion de Mme Bastid :
“ Les souverains préférés de Mao étaient les empereurs qui par les convulsions de transformations brutales avaient frayé la voie à l’âge d’or des Han et des Tang. Ce fut peut-être la fonction de Mao. Avec Tchang Kaï-chek Chiang Kaï-chek, Mao fut le premier autocrate chinois modernisateur et occidentalisant. L’imagination politique a fait la victoire de Mao, sa grandeur et les aberrations meurtrières de son règne. Cette imagination était nourrie chez lui, sans l’ombre d’un complexe ou d’un doute, par le sentiment absolu de son identité chinoise, et par une totale confiance dans la puissance de cette identité ; n’a-t-elle pas, en définitive, aguerri les forces populaires d’une renaissance nationale, libératrice et moderne ? C’est ce qu’exprimait à la veille de sa mort, lors de la manifestation d’opposition sur la place Tiananmen le 5 avril 1976, un poème de protestation contre le régime de Mao :
La Chine n’est plus la Chine de jadis
Le peuple chinois n’est plus ignare
La société féodale du Premier empereur Qin est à jamais révolue. »
Hitler, il nous faut y venir : aux excellents développements que propose M. Burrin, je me contenterai d’ajouter quelques suggestions qui venant du non-spécialiste que je suis risquent de paraître éventuellement déplacées.
Je crois d’abord que Hitler est un révolutionnaire au sens le plus déplorable, le plus détestable de ce terme. Je vois dans notre histoire européenne, ou même plus qu’européenne, trois groupes de révolutions, par ailleurs fécondes, qui constituent le passage progressif de l’Ancien Régime à cette démocratie dont je parlais tout à l’heure ; l’heureuse révolution anglaise de 1640, puis 1688, la Révolution française et les paraphernalia qui l’entourent ; enfin les révolutions européennes si destructrices qui courent de 1917 à 1945, voire jusqu’en 1990 ; elles ont jeté bas l’Ancien Régime dans la plupart des pays d’Europe ; Hitler en est l’une des parties prenantes, il en est même l’un des coryphées, tout à fait haïssable bien évidemment à la différence de tant de héros positifs de ces vingt-huit années, à commencer par les antifascistes et autres résistants…
En second lieu, il me semble, et vous me pardonnerez d’enfoncer cette porte ouverte, qu’Hitler est un esprit faux fut-il par ailleurs assez doué, et intelligent à certains égards.
En 1941, il attaque l’URSS et décrète que ce pays s’effondrera comme un château de cartes ou comme un château de sable. Ses espérances sur ce point ayant été réfutées ou déçues, il déclare qu’au fond lui, Hitler, ne regrette pas quand même de s’être trompé de la sorte, parce que s’il avait mieux apprécié la puissance de l’URSS, il n’aurait pas attaqué ce pays. Or sa mission, en quelque sorte, tracée depuis Mein Kampf, consistait à attaquer, à envahir et à occuper la Russie pour y installer la Grande Allemagne, et il était donc bon, ajoutait le Führer, qu’il se soit lui-même trompé, puisque ainsi, se nourrissant d’illusions, il avait procédé sans crainte à cette offensive, indispensable de toute manière, dans les perspectives historiques allemandes, lesquelles étaient pour lui “ européennes ” sur le mode pervers, l’offensive anti-russe qui s’est avérée beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que ne le pensait ce chef nazi et comme vous le savez, suite et fin de l’histoire, elle s’est terminée de façon effroyable, à tous points de vue.
Les dictateurs, encore, ou les collaborateurs des dictateurs : Goebbels, dont nous a parlé avec talent Marc Ferro, à propos des problèmes de propagande. Immonde salopard, certes, c’est le moins qu’on puisse dire ; canaille, comme l’appellera Joachim Fest, Goebbels est aussi l’auteur d’un prodigieux Journal de 15 000 pages, en une langue allemande relativement facile, et qui comme tel ne sera jamais traduit en français intégralement.Journal publié par un grand éditeur scientifique allemand, éditeur antinazi sans concessions ; le texte ainsi produit est devenu l’une des sources essentielles de la biographie hitlérienne en tous points convaincante qu’a donnée récemment M. Kershaw.
Les rois maintenant, et leurs ministres.
Louis XIV, nous fut présenté deux fois : par l’excellent exposé de M. Petitfils ; et par Denis Maraval qui, au titre des biographies sur lesquelles il s’est exprimé (ci-après) avec beaucoup de talent, avait publié jadis l’excellent Louis XIV de Bluche.
La Révocation, tous nos auteurs, M. Petitfils lui-même et Bluche bien entendu le soulignent, fut certainement l’erreur cardinale du Roi-Soleil, tout comme l’expédition des Dardanelles fut la faute capitale de Churchill. Il est vrai que l’Europe française du Siècle des Lumières est un peu le résultat, la fille putative de cette Révocation, les Huguenots, hélas exilés, ou s’exilant eux-mêmes s’étant empressés d’exporter dans les pays voisins, comme autant de professeurs de français la connaissance de notre langue. Il est vrai aussi que la Révocation louis-quatorzienne s’inscrit dans un contexte européen, certes haïssable, lui aussi, de la Constitution de l’État moderne, par éradication des différences religieuses. Éradication qui du reste n’a pas réussi. Les Anglais en Irlande, les Autrichiens vis-à-vis des Turcs, les Russes à l’égard des vieux croyants ne se sont pas mieux comportés que ne firent les dragons casqués et bottés du roi de France » convertisseur » des calvinistes.
Cette comparaison bien sûr n’est pas une excuse : la France étant la nation matricielle (au point de vue conceptuel) de toutes les autres nations, la France ayant créé le modèle national, se devait de donner l’exemple d’une conduite tolérante et ouverte. Elle se devait d’être le bon élève de la classe. Le moins qu’on puisse dire, est qu’elle ne s’est pas engagée immédiatement dans cette direction. Même si par la suite, la tolérance au XVIIIe siècle, jusqu’à l’édit de libération des protestants de 1787, a retrouvé une grande partie de l’ampleur que lui avait donnée déjà, un siècle auparavant, Henri IV.
De l’œuvre de M. André Zysberg, l’un de nos communicants, j’évoquerai bien sûr le bel exposé qu’il nous a donné sur la marine au temps des trois Rois : Louis XIV, XV et XVI. Mais je voudrais signaler également l’apport considérable qui fut le sien quant à notre connaissance du régime de Louis XV ; lors de son exposé d’abord, et dans un livre en tous points excellent consacré à ce même sujet. M. Zysberg est le premier à avoir montré, par les statistiques de galériens qu’il a publiées, que les envois des Huguenots aux galères s’effondrent en tant que nombres, en tant qu’effectifs de ces malheureux à partir de 1713-1715, et sous la Régence et sous Louis XV. Les règlements draconiens antiprotestants pris par le duc de Bourbon en 1724 contre les calvinistes ne sont pas réellement appliqués à la lettre, même si, hélas, des pasteurs sont encore mis à mort.
M. Zysberg est aussi l’un des premiers à avoir remarqué le mouvement de bascule, d’alternance, qui a emporté le règne de Louis XV, tantôt vers le clan des faucons ou des durs à la d’Argenson, au milieu du XVIIIe siècle, des “ durs ” aussi à la Maupeou un peu plus tard ; tantôt, en d’autres occasions parmi les hommes d’État plus modérés et plus ouverts, comme Fleury et Orry au début du règne, et Choiseul ; voire Turgot après la mort de Louis XV.
M. Chaussinand-Nogaret nous a dépeint un Louis XVI qui certes, avait su magnifiquement mener sa guerre d’Amérique, avec Vergennes – peu de gratitude nous en revient aujourd’hui des États-Unis –, ajoutons que ce fut la première et la dernière guerre gagnée par la France à l’encontre des Anglais en moins de cent ans. Ceci méritait d’être signalé. Mais Louis XVI fut ensuite incapable par aboulisme, dirai-je, par maladie de la volonté, de faire face aux flux révolutionnaires. Remarquons quand même à ce propos que des souverains certes plus ou moins doués selon les cas, comme Pie IX en 1848, ou Guillaume II, Nicolas II, Louis-Philippe, Napoléon III, ne se sont pas montrés capables, eux non plus, de résister à ce que les Anglo-Saxons, sans aucune connotation péjorative appelleraient volontiers une super-vague révolutionnaire ; ces vagues » pyramidales » de 30 mètres de haut qui sont capables d’engloutir d’un coup un pétrolier géant, ou du moins de le casser, de le briser ; à plus forte raison (dans un tout autre contexte !) de faire périr l’Ancien Régime.
Que dire de Pierre le Grand, nous sommes toujours dans les chapitres des rois et des empereurs, sinon paraphraser ce qu’a énoncé avec beaucoup de talent M. Berelovitch en sa communication savante. Je retiens l’image de Pierre, tenant dans ses bras l’enfant Louis XV âgé d’une dizaine d’années lors de la visite de Pierre le Grand en Europe occidentale. Va-t-il le lancer au plafond, ce petit Louis XV, pour qu’il se fracasse en retombant sur le plancher ? Certes non. Mais l’œuvre du tsar autocrate et réformateur reste tributaire de ce que deviendra ultérieurement la grande Russie, passant du quasi-zéro jusqu’à l’infini, puis de l’Etre au Néant, au travers de résurrections diverses, fussent-elles problématiques. “ Faut voir d’où ils viennent ”, disait-on des Russes. C’est l’éternel propos des admirateurs de Pierre au XVIIIe siècle, des communistes français vers 1950-60, et de ceux qui font aujourd’hui confiance ou non à la Russie poutinienne en notre temps.
Après les Rois et les empereurs, ou avant eux, viennent les serviteurs de la monarchie ou des monarchies. J’en dénombre trois dans nos Annales académiques de 2003 : Bismarck, Churchill, Thatcher. Bismarck, en dépit ou à cause des magnifiques contributions de M. Bled, je ne pourrais pas tout à fait lui donner l’absolution, ni le Bon Dieu sans confession. Certes Bismarck a su éviter la guerre sur deux fronts, dans laquelle pataugeront sur le mode sanguinaire ses successeurs plus ou moins immédiats, tant Guillaume II que Hitler. Certes, Bismarck a su être multilatéral et non pas unilatéral comme on dit de nos jours. Mais c’était au fond pour mieux nous humilier, nous, les Français. Disons pour enfoncer une porte ouverte que je préfère infiniment Adenauer, Schmidt, Köhl, Schröder, grands amis de la France. Ma mère n’aimait pas Frédéric II ; pour ma part, je n’apprécie qu’à moitié le chancelier de fer.
Churchill, on l’admirera pour sa politique, raide comme barre, au meilleur sens de ce terme ; et néanmoins, comme l’a montré M. Anthony Rowley, Winston Churchill a fait bêtise sur bêtise, avant de devenir sur le tard le très grand homme que nous savons. Et puis l’on pense à ses bons mots, fussent-ils de mauvais goût sans aucun doute, mais le mauvais goût peut être la marque du génie, qui se permet toutes les licences. Phrase churchilienne, à propos d’Hitler et Staline : “ We killed the wrong pig ” (Nous avons tué le mauvais cochon), disait-il au sujet d’Hitler, en regrettant de n’avoir pas tué Staline aussi par la même occasion ! Cela à la manière de ces chasseurs normands ou chinois du temps jadis qui d’une seule flèche d’arbalète, transperçaient en vol deux canards sauvages. “ The Wrong Pig ”, le mauvais cochon, serait-ce aujourd’hui Saddam Hussein ? Dont on peut se demander si c’est à lui d’abord, ou à lui surtout qu’il fallait porter les premiers coups.
Mme Thatcher enfin, vue par un grand historien de Gironde, fera transition avec les femmes, dernière catégorisation un peu sacrifiée comme toujours, du fait de Gianbattista Vico. La dame de fer a remis l’Angleterre sur pied, même si, à propos de l’Europe unie en général, et de la France en particulier, cette chère Margaret fut maintes fois insupportable.
Jeanne d’Arc, avec notre cher et grand confrère Contamine, n’est pas en reste ; non point d’insupportabilité, mais de grâce mystique. J’ai encore les oreilles remplies du vacarme récent d’un film à propos de cette Sainte, ce film qui du reste ne m’a pas laissé indifférent. C’est en effet, pour en revenir à ce que je disais à l’instant, le mysticisme international de Jeanne d’Arc, mysticisme français, mais répercuté aussi sur l’Italie, que M. Contamine a souligné.
Les reines de France, par ailleurs, celles qu’illumine la science de Madame Cosandey, nous ont offert un tableau des rites à la Giesey – c’est le grand historien américain des funérailles royales –, mais cette fois, il ne s’agit plus d’inhumation, bien plutôt de la ritualisation du cursus de ces grandes bonnes femmes, reines ou régentes de France, ou simplement conseillères du Pouvoir, comme fut Anne de France, et puis Catherine de Médicis… L’une et l’autre ayant exploré les chemins d’un étatisme ouvert. Mentionnons aussi Anne d’Autriche, en son couple paradoxal, et peut-être platonique, Anne et Mazarin, “ pavant la route ” pour l’absolutisme “ new-look ” des années 1660…
Le présent texte était écrit(2) quand nous eûmes le privilège d’entendre Olivier Todd sur Malraux, à propos duquel le conférencier a bousculé quelques légendes… “ résistantialistes ”.
Il nous restait encore à prendre connaissance de Trotski et des trotskistes, notamment en France, dans un exposé presque de fin d’année de Marc Lazar. Cet exposé a stimulé sans doute, et de la belle manière, nos réflexions, en un pays où le trotskisme qu’on a longtemps considéré comme une pure et simple secte accueille dorénavant, ou recueille désormais, 10 % au moins des suffrages exprimés. Ce qui, nous le reconnaîtrons, n’est pas du tout un pourcentage sectaire, même si l’idéologie mise en cause, l’idéologie trotskiste, elle, conserve encore, d’innombrables traces de sectarisme. Mais après tout, Ceylan, Sri Lanka a bien été gouvernée par une femme trotskiste, pendant quelque temps, Mme Bandaranaiké. Alors dirons-nous, pour satisfaire ou contrister les uns et les autres, dirons-nous que rien n’est perdu ? Que tout n’est pas dit, avec ou sans trotskisme, en ce qui concerne notre Hexagone, ingouvernable certes, presque par essence, et qui entend le rester…
(1) Le texte qu’on va lire fut d’abord un exposé “ sous la coupole ” présenté par Emmanuel Le Roy Ladurie, en conclusion de l’année académique, qu’il avait présidée depuis janvier 2003 jusqu’au début de l’année 2004. Ce texte conserve donc un certain caractère de “ discours ” oral.
(2) Ce texte, rédigé à l’automne de 2003 pour un exposé “ sous la coupole ”, prenait acte de la majorité des exposés tout en anticipant sur quelques autres.
La France du nouveau siècle

sous la direction de
Thierry de Montbrial
Avant-propos
L’Académie des sciences morales et politiques est l’une des cinq académies qui constituent l’Institut de France. Selon une tradition bien établie, son président est entièrement responsable de l’organisation du travail de la Compagnie pendant la durée de son mandat. Ayant été élu pour l’année 2001, j’ai ainsi proposé à mes confrères de procéder à un vaste tour d’horizon de la France au début du XXIe siècle, en faisant appel à un ensemble de personnalités très expérimentées. La plupart de leurs contributions sont rassemblées dans ce livre, accompagnées de deux textes de synthèse que j’ai rédigés. Un second volume, publié séparément, regroupe cinq communications sur les thèmes complémentaires de la démographie et de la protection sociale, présentées lors d’un colloque à la Fondation Singer-Polignac, pour lequel nous sommes particulièrement redevables au chancelier honoraire de l’Institut, M. Édouard Bonnefous.
Le lecteur constatera que nous n’avons pas cherché l’exhaustivité. C’est ainsi que, en dépit de mes fonctions de directeur de l’Institut français des relations internationales, j’ai écarté de ce tour d’horizon la politique étrangère et la défense. Je suis en effet convaincu que les capacités d’action d’un pays à l’extérieur sont avant tout fonction de l’état de ses ressources humaines, morales et économiques. C’est donc délibérément que ce travail collectif met l’accent sur les principales réformes internes dont la France a besoin.
Thierry de Montbrial
Sommaire
Introduction — La France du nouveau siècle, par Thierry de
Montbrial
Première partie — Points de vue extérieurs
Félix ROHATYN — L’état de la France vu des États-Unis
Henrik UTERWEDDE — L’état de la France vu d’Allemagne
Mgr Jean-Louis TAURAN — Les relations Église-État en France : de la séparation imposée à l’apaisement négocié
Deuxième partie — Les bastions de la République
René RÉMOND — La France d’un siècle à l’autre : continuité et ruptures
Pierre ROSANVALLON — Fondements et problèmes de l’« illibéralisme » français
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT — Pourquoi la France ne doit pas disparaître
Jean-Denis BREDIN — La France et les droits de l’homme
Jean-Marie ZEMB — La racine langagière du génie français
Michel ZINK — Les humanités et la formation de l’esprit
Dominique LECOURT — L’idée française de la science
Dominique WOLTON — L’identité culturelle française face à la mondialisation de la communication
Alain-Gérard SLAMA. — Le débat intellectuel dans la France contemporaine
Jean-Claude CASANOVA — L’Université française du XIXe au XXIe siècle
Pierre JOXE — L’efficacité de l’État
Michel ALBERT — Le système fiscal français
Troisième partie — Réformer
Hervé GAYMARD — Engagement politique et Nation
Dominique PERBEN — La fonction publique
Jean-Marc VARAUT — La révolution judiciaire
Jean-Marie COLOMBANI — La France et la Corse
Serge FENEUILLE — Vous serez tous des savants
Jean-Pierre BOISIVON — L’efficacité de l’école exige-t-elle toujours plus de moyens ?
Denis GAUTIER-SAUVAGNAC — Débrider le dialogue social
Bernard BRUNHES — Partenaires et acteurs du contrat social : crise française et perspectives européennes
Nicole NOTAT — Les relations sociales en France : le nouveau contexte, le rôle des différents acteurs, les perspectives
Jean-Pierre DELALANDE — Violence, société et humanisme
Claude BÉBÉAR — Mondialisation : émigration-immigration
Jean DRUCKER — La télévision est un enjeu économique et culturel
François TERRÉ — Juillet 1901 – juillet 2001 : repenser une loi centenaire
Quatrième partie — La France des entrepreneurs
Louis SCHWEITZER — Le cas Renault
Bertrand COLLOMB — Entreprise, humanisme et mondialisation
André LEVY-LANG — Nouvelles technologies, innovation et jeunes pousses
Michel PÉBEREAU — Le système financier français dans le marché mondial
Jean-François DEHECQ — Le triangle entreprise, État, Europe
Conclusion — Quel avenir pour la France ? par Thierry de
Montbrial





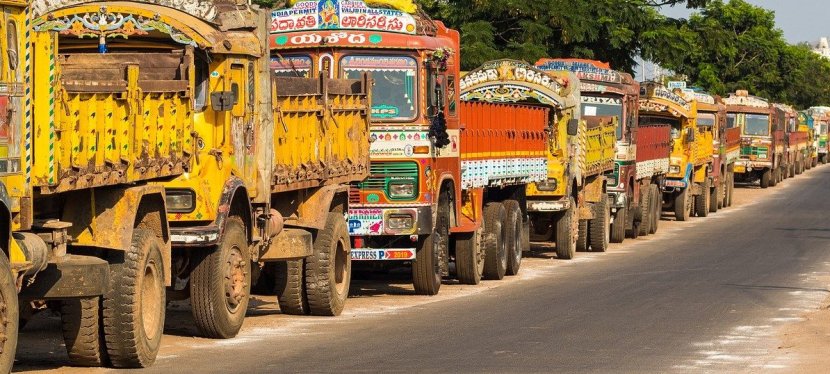
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.