Étiquette : Histoire
Peut-on faire confiance aux historiens ?
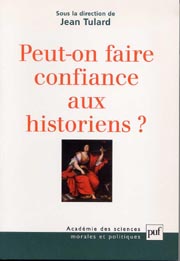
sous la direction de
Jean Tulard
Peut-on avoir confiance dans les historiens ? La question est aujourd’hui brûlante. L’Histoire s’écrira-t-elle au Parlement ou dans les prétoires plutôt que dans les bibliothèques et les dépôts d’archives ?
Personnalités politiques, médecins, sociologues et historiens débattent de ce problème devant l’Académie des Sciences morales et politiques.
Sommaire
Introduction — Jean TULARD
Première partie — Grandes figures
Qu’est-ce qu’un historien ? De Guizot à de Gaulle, la diversité est grande. Sacha Guitry lui-même n’affirmait-il pas faire œuvre d’historien au début de son film Si Paris nous était conté ?
Gabriel DE BROGLIE — Guizot
Xavier DARCOS — Mérimée et l’histoire
Jean PIAT — Sacha Guitry
Bernard VALADE — Du bon usage de l’histoire selon Pareto
Alain LARCAN — De Gaulle historien
Deuxième partie — Modes d’approche
Où commence l’histoire ? Dans les dépôts d’archives ou dans la presse, dans les documentaires cinématographiques ou dans le roman ?
Martine DE BOISDEFFRE — Les Archives nationales
Denis MARAVAL — Le choix de l’éditeur
Henri PIGEAT — Le journaliste et l’historien
Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER — L’histoire au péril des médias
Jean A. CHÉRASSE — Le film documentaire historique vérités et mensonges
Françoise CHANDERNAGOR — Peut-on écrire des romans historiques ?
Robert KOPP — Le roman, une histoire du présent ?
Troisième partie — Avancées et reculs
L’Histoire s’est élargie à des domaines qu’avaient négligés Thucydide ou encore Lavisse. Mais, en s’interrogeant sur le réchauffement de la planète ou sur l’évolution des saveurs en cuisine, ne condamne-t-elle pas les vieux livres d’histoire à l’obsolescence ?
Jean BAECHLER — Peut-on écrire une histoire universelle ?
Emmanuel LE ROY LADURIE — Peut-on écrire l’histoire du climat ?
Jean-François LEMAIRE — Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?
Jean VITAUX — Peut-on écrire l’histoire de la gastronomie ?
François MONNIER — L’obsolescence des œuvres historiques
Quatrième partie — Légendes et falsifications
Déjà Tacite et Suétone étaient soupçonnés de dénigrement systématique envers la dynastie julio-claudienne. Que dire des falsifications et des déformations de l’histoire contemporaine ou des révisions du passé ? L’historien se voit dépossédé de son pouvoir de dire la vérité au profit du juge. Thémis supplante Clio.
Jacques DUPÂQUIER — L’Ancien Régime vu par les manuels d’histoire de la IIIe République (1871- 1914)
Jean-Paul CLÉMENT — Chateaubriand, Byron et Pouchkine face à Napoléon
Jean DES CARS — Les historiens et la légende noire du Second Empire
Alain BESANÇON — Fluctuations de l’historiographie de la Russie
Bernard BOURGEOIS — La fin de l’histoire
Conclusion — Jean TULARD
Introduction
Jean Tulard
A Sainte-Hélène, Napoléon découvre la sagesse. S’interrogeant sur l’image que les historiens donneront de lui, il confie à Las Cases : « II faut en convenir, les véritables vérités sont bien difficiles à obtenir pour l’historien. Heureusement que la plupart du temps, elles sont bien plutôt un objet de curiosité que de réelle importance. »
C’est dire le peu d’intérêt attaché par Napoléon à l’Histoire. Du moins en apparence.
Pour lui la vérité historique n’existe pas. Elle n’est le plus souvent, dit-il, qu’un mot. « Elle est impossible au moment même des événements, dans la chaleur des passions et si, plus tard, on trouve un accord, c’est que les intéressés et les contradicteurs ne sont plus. Qu’est alors la vérité historique ? Une fable convenue. »
Et Napoléon de souligner l’absurdité de toute biographie. « J’ai donné un ordre, mais qui a pu lire le fond de ma pensée, ma véritable intention ? Et pourtant chacun va se saisir de cet ordre, le mesurer à son échelle, le plier à son plan, à son système individuel. »
Non, il est impossible de pénétrer dans l’âme humaine. Orson Welles le rappellera dans son film Citizen Kane. L’enquêteur ne saura jamais ce que signifiait le dernier mot prononcé par le magnat de la presse, « Rosebud », et la grille de Xanadu se refermera, comme elle s’était ouverte, sur l’écriteau « No trespassing », « défense d’entrer ». Défense d’entrer dans la vie d’un homme.
Napoléon s’indigne : « 0n me supposera des projets que je n’eus jamais ; on se demandera si je visais à la monarchie universelle ou non. On raisonnera longuement pour savoir si mon autorité absolue et mes actes arbitraires dérivaient de mon caractère ou de mes calculs, si mes guerres constantes vinrent de mon goût ou si je n’y fus conduit qu’à mon corps défendant. »
« Il en sortira, conclut l’Empereur, la fable convenue qu’on appellera mon histoire. »
L’Histoire une fable convenue ? La question peut se poser en un temps où le juge tend à se substituer à l’historien, Celui-ci est-il impartial et Tacite n’a-t-il pas volontairement noirci Néron ? L’historien dispose-t-il de toutes les sources au moment où les modes modernes de transmission sont en train de les raréfier ? Et l’obsolescence des livres d’histoire ne connaît-elle pas, avec l’inflation des ouvrages, une brusque accélération ? Bref, faut-il faire confiance aux historiens ?
Tel est le débat qui a animé l’Académie des Sciences morales et politiques au cours de l’année 2005. On trouvera dans ce volume les communications qui ont été présentées sur ce sujet.
Conclusion
Jean Tulard
Fin de l’Histoire Déjà Volney, l’un des premiers membres de l’Institut, dans ses leçons sur l’Histoire prononcées à l’éphémère Ecole normale de l’an III, condamnait cette prétendue science et écrivait : « Plus j’ai analysé l’influence journalière qu’exerce l’Histoire sur les actions et les opinions des hommes, plus je me suis convaincu qu’elle était l’une des sources les plus fécondes de leurs préjugés et de leurs erreurs. »
Faut-il rêver d’un monde sans Histoire ? Un monde où se substituerait au devoir de mémoire l’obligation d’oubli ? Les Parisiens passeraient devant la colonne Vendôme sans savoir ce qu’elle représente. Les noms des rues et des places (Général Leclerc, Jean Jaurès, Wagram) ne diraient plus rien. Les livres d’histoire seraient proscrits des librairies.
Utopie ? Mais pensons aux fellahs égyptiens en 1797 qui vivaient à l’ombre de monuments en ruines dont la signification leur échappait puisqu’ils ne pouvaient en déchiffrer les inscriptions. Le passé était abolit ils ignoraient Ramsès et Aménophis. Paisiblement ils se contentaient d’attendre les crues du Nil.
Paisiblement car l’absence de passé signifie l’absence de mauvaise conscience, l’absence de polémiques, l’absence d’esprit de revanche. C’est l’Histoire qui crée les guerres. Tous les dictateurs, tous les conquérants y font référence. L’Histoire justifie tout : massacres, viols et pillages. Excité par le souvenir du passé, on rend à l’ennemi la monnaie de sa pièce. Tel fut le terrible engrenage des conflits franco-allemands.
Supprimer l’Histoire pour établir la paix ? Même Volney n’y a pas songé sérieusement. Au demeurant l’Histoire débarqua rapidement à Alexandrie sous la forme de Bonaparte, de ses soldats et de ses savants. Ramsès et Aménophis ressuscitèrent.
On n’échappe pas à Clio, muse menteuse et volage, mais finalement si charmante. Qu’elle soit un art ou une science, qu’on la déclare quantitative ou narrative, qu’on la veuille philosophique ou érudite, qu’importe : l’Histoire est la meilleure source de l’émotion et du plaisir. Continuons de faire semblant de faire confiance aux historiens.
Personnages et caractères XVe-XXe siècles
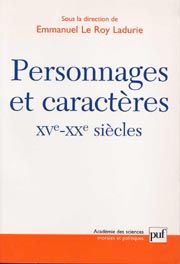
sous la direction de
Emmanuel Le Roy Ladurie
Avant-propos
Le livre ci-après regroupe les communications qui furent données et prononcées en 2003 dans le cadre de l’Académie des sciences morales et politiques (A.S.M.P.). Elles s’adressaient, avec l’aide des meilleurs spécialistes, aux thèmes de la biographie et plus généralement de la personnalité, envisagée sous l’angle d’une réflexion, et non pas simplement d’un récit qui serait relatif au déroulement événementiel de telle ou telle existence particulière. En tant que président de cette compagnie pour l’année mise en cause, j’ai d’autre part organisé dans le même esprit un colloque (au mois d’octobre 2003), lequel concernait des sujets proches du thème académique précédemment indiqué (soit : Le meilleur et le pire, personnages et caractères, titre de notre entreprise collective “ ASMP ”). Ce colloque donnait de surcroît à l’ensemble de nos débats, et au livre qui en résulte ici, un élément d’unité terminale, en bref une perspective d’ensemble en forme de ligne de fuite ou d’experimentum crucis, ou tout simplement de point focal ; il s’agissait pour le coup de développements, et de communications relatives à l’ouverture, concernant un certain nombre de personnalités elles aussi du monde moderne et contemporain (XVIe-XXe siècle), monde politique, religieux, culturel… Ce problème, devenu classique en notre temps, de l’ouverture se référait, s’agissant de son point de départ, au livre bien connu de Karl Popper, La Société ouverte et ses ennemis. Le susdit colloque qui sera édité séparément s’avérera, somme toute, complémentaire de la publication du présent ouvrage.
Il m’est agréable, en ce contexte, de remercier du fond du cœur M. Edouard Bonnefous, chancelier honoraire de l’Institut de France et M. Jean Cluzel, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, sans lesquels une telle entreprise “ duelle ”, au titre de l’Institut de France, en sa ramification morale et politique, n’aurait pu voir le jour.
Emmanuel Le Roy Ladurie
Sommaire
Introduction — Emmanuel LE ROY LADURIE
Chapitre Premier — La Scienza nuova, fragments d’une grande bibliothèque
Alain PONS — Vico
François STASSE — Vieille Dame, grande Dame : la BNF
Olivier TODD — Malraux, épidémiologie d’une légende
Alain BESANÇON. — Dostoïevski
Marc FUMAROLI — Continuité et changement du caractère français dans les Mémoires d’outre-tombe
Chapitre II — Dieu et Son homme
Régis DEBRAY — Dieu
André DAMIEN — Jean-Paul II
Chapitre III — Héros et fondateurs
Pierre MESSMER — De Gaulle en direct
Jean-Paul BLED — Bismarck
Wladimir BERELOWITCH — Pierre le Grand
Chapitre IV — De quelques rois Bourbons
Jean-Christian PETITFILS — Louis XIV
André ZYSBERG — Les Bourbons à bon port
Guy CHAUSSINAND-NOGARET — Louis XVI
Chapitre V — Le peuple
Henri AMOUROUX — Le peuple français comme acteur de l’Histoire (1940-1944)
Chapitre VI — Démocrates et Républicains
Michel ALBERT — Robert Schuman
Anthony ROWLEY — Churchill
Georges-Henri SOUTOU — Gorbatchev
Chapitre VII — Autoritaires et Totalitaires
Pierre MILZA — Mussolini
Bartholomé BENNASSAR — Franco
Nicolas WERTH — Lénine
Stéphane COURTOIS — Staline
Marianne BASTID-BRUGUIÈRE — Mao Zedong
Claude DULONG-SAINTENY — Hô Chi Minh
Marc FERRO — Goebbels et Staline face à Roosevelt. Conceptions diverses de la propagande
Philippe BURRIN — Hitler
Marc LAZAR — Trotski, les trotskistes et la France
Chapitre VIII — Femmes : mystique et politique
Fanny COSANDEY — La reine de France à l’époque moderne
Philippe CONTAMINE — Jeanne d’Arc
Philippe CHASSAIGNE — Thatcher
Conclusions
Emmanuel LE Roy LADURIE — Monstres honnis, monstres sacrés
Jean-Pierre BARDET — Les sources autobiographiques
Denis MARAVAL — Au regard d’un éditeur, la Biographie
Introduction
Emmanuel Le Roy Ladurie
Le pire… Le meilleur… Notre année académique a oscillé entre ces deux pôles, au gré des communications qui composèrent le programme annuel mis en cause et dont je tenterai de faire une synthèse initiale dans le texte ci-après.
On me permettra d’abord de placer cette introduction(1) sous le signe de Gianbattista Vico, brillamment explicité, ici même, face aux Académiciens des sciences morales, par M. Alain Pons, spécialiste de la pensée de ce grand auteur italien. Vico a proposé une série de classifications à sept termes, plus riche, somme toute, que le vieux système trifonctionnel à trois fonctions cher à Dumézil. D’icelui le thème est connu : la fonction cléricale, première fonction dumézilienne ; les nobles et/ou militaires, éventuellement héroïques, deuxième fonction ; enfin, en tierce position, les paysans, ou tout simplement le peuple, voire le tiers état, y compris la bourgeoisie ; disons au total oratores, bellatores, laboratores : ceux qui prient, ceux qui font la guerre, ceux qui labourent la terre. Braudel me disait un jour, avec beaucoup d’admiration de sa part : Dumézil a eu trois très grandes idées dans sa vie, la première fonction, la deuxième fonction, la troisième fonction – celles-là même que je viens d’énumérer. A vrai dire qui d’entre nous ne serait pas ravi d’avoir eu au moins trois idées importantes dans son existence… C’est le plus bel hommage qu’on puisse rendre à cet immense savant qu’était Dumézil. Néanmoins Braudel et Dumézil, ce sont là jeux de princes qui passent très au-dessus de la tête des modestes mortels, sinon immortels que nous sommes. Venons-en par conséquent, à Vico. Sa série se décline comme suit, sur le mode approximatif, dans la Scienza nuova : 1) les Géants ou les Monstres ; 2) les dieux ; 3) les héros ; 4) le peuple et sa culture – incidemment les dieux, les héros, le peuple, ce sont les trois fonctions duméziliennes dont je parlais tout à l’heure ; 5) les Républicains ; 6) la Monarchie, éventuellement impériale ; 7) les femmes dont l’action selon Vico, reproductive, conjugale et familiale traverse, inévitablement les six catégories précédentes, ce qui après tout, est tout à l’honneur de l’élément féminin en question. Même si le féminisme actuel, non sans raisons voit les choses tout autrement et d’une façon infiniment plus ouverte. Au surplus aurai-je l’occasion, en fin de parcours, de politiser ou même de “ mysticiser ” les femmes évoquées de la sorte.
Dans la liste des personnages, personnalités, caractères, qui ont illustré, sur le mode partiellement biographique, notre année d’académie, la place des Géants, ou plutôt en ce qui concerne nos travaux d’un an, celle des Monstres, serait à chercher – c’est le numéro Un de Vico, voyez supra – du côté de personnages plutôt sinistres, les fameux “ monstres ” en question, même si ces hommes ne sont évidemment pas monstrueux à 100 % (au minimum, à 99,99 %), dès lors qu’il s’agit “ d’abominables bonhommes ”, en effet, comme Hitler ou Staline. Mais point ne serait convenable d’inaugurer le présent rapport par les noms tout à fait révoltants du chef national-socialiste, ou du dictateur de l’URSS. C’est pourquoi je débuterai mon exposé par les hommes de Dieu – André Damien nous a superbement parlé de Jean-Paul II – et peut-être rappellerai-je simplement ici deux épisodes de la vie ou de l’action de cet homme, Wojtyla, à la fois homme de paix, tombeur aussi d’un certain soviétisme. Et d’abord, ce Pape a refusé une condamnation ex-cathedra de l’athéisme communiste, parce que, lui, Jean-Paul II, souhaitait que tout vienne, que tout procède, en cette affaire, d’une pure, simple, et intime conviction intérieure, sans diktat extérieur. Il a conservé aussi au concept certes égalitaire à son gré de peuple chrétien ou de peuple de Dieu cependant que la vieille notion de hiérarchie ecclésiastique (et autre, voyez Louis Dumont) restait pour lui essentielle ou plus fondamentale. Faudrait-il dire de la part de Jean-Paul II : un coup à droite, préservation de la hiérarchie ; un coup à gauche, point trop de condamnations simplistes d’un athéisme communiste ?…
Je m’aperçois que j’ai évoqué le Jean-Paul II de notre confrère Damien avant de mentionner et plus que mentionner l’excellent Dieu de M. Régis Debray. Je ne puis que citer sa conclusion, la conclusion de Debray, toujours précise et pleine d’humour, comme si souvent dans la prose que je me permettrai d’appeler “ régissienne ”. Régis Debray – c’est lui qui parle – déclare en évoquant l’un de nos grands déistes anticléricaux : “ Dieu, écrit Voltaire, a fait l’homme à son image, et l’homme le lui a bien rendu. Un humaniste respectueux des divins mystères – Debray en personne sans doute – serait plutôt tenté de renverser la vapeur. L’homme a fait Dieu à son image ; or le Dieu de Moïse et de Josué, de saint Vincent de Paul et de la Saint-Barthélemy, de Ib’n Arabi et de Bin Laden le lui a bien rendu. Parfois même au centuple. ” Comme quoi les diverses facettes du problème divin, le meilleur et le pire sont abordées avec impartialité, générosité aussi par M. Régis Debray.
Des hommes de Dieu, passons aux héros. De Gaulle s’offre à nous, tout naturellement, grâce au chancelier Messmer qui nous mit en scène, en fonction de son expérience courageuse et personnelle, un admirable “ De Gaulle en direct ”. Le cursus biographique de M. Messmer fut assez héroïque, lui aussi, à divers moments fondamentaux. Il reste que l’un des plus grands mérites de De Gaulle, vers la dernière partie de sa vie, c’est d’avoir donné à la République une colonne vertébrale quelque peu monarchienne ou monarchisante en l’occurrence, basée sur l’Institution d’une certaine Présidence républicaine, style Cinquième République en effet. Ainsi aurons-nous eu dans toute notre histoire cinq dynasties, cinq “ races ”, comme on disait autrefois, d’un mot aujourd’hui banni, cinq lignages successifs à la tête du pays : les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Napoléonides… et les Républicains, en la personne, tout dernièrement, des quatre chefs d’État qui succédèrent ou succèdent à De Gaulle. Leurs noms sont sur toutes les lèvres : Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac.
Le peuple et sa culture, troisième catégorie de Vico. Henri Amouroux a évoqué pour nous le peuple français, spectateur et acteur de l’histoire entre 1940 et 1944 ou 1945. Et peut-être à mon gré la date la plus essentielle, au cours d’un tel quinquennat très approximatif, est-elle novembre 1942, première quinzaine de ce mois, quand Stalingrad est encerclé, quand les Américains débarquent en Afrique du Nord, quand Rommel doit plus ou moins se retirer de toute une partie de la Libye, quand le sort de la Seconde Guerre mondiale, pivote en somme comme un décor ou une scène de théâtre, mais ce n’est pas du Feydeau, plutôt du Shakespeare. Dans son Journal intime, à la date même de cette “ quinzaine ”, et dès ce moment, avec lucidité, Drieu la Rochelle annonce qu’il va se suicider ; il a tenu parole. Quant à Josée Laval, comtesse de Chambrun, désespérée, elle croit revivre, mais dans le vice versa, les heures tragiques de mai-juin 1940.
Le peuple et sa culture… Ici prend place l’excellent exposé de M. Stasse sur la Bibliothèque nationale de France, en tant que celle-ci est personnage ou personnalité collective, de nos jours émanée du peuple français constituant lui-même la base de nos institutions en effet nationales. Cette Bibliothèque a ses zones d’ombres – l’absurde architecture de l’établissement de Tolbiac n’est pas fonctionnelle, même si à l’usage elle acquiert une sorte de dimension gaullienne ; mais l’informatisation des catalogues, le confort intérieur, la richesse livresque immense de la maison, en font à bien des égards une vraie réussite, appréciée notamment par beaucoup d’étudiants venus des USA, y compris ceux d’une grande Université américaine : elle vient d’acquérir un ensemble immobilier important, paraît-il, à proximité du site Tolbiac.
Le peuple et sa culture, dans l’esprit de Vico, encore lui : on peut se reporter à ce sujet au grand exposé de M. Fumaroli sur l’avant et l’après-Révolution française, au gré de Chateaubriand. Je laisserai ci-après la parole à cet éminent historien de la littérature qu’est Marc Fumaroli, je dirai simplement ici ce qui est je crois le sentiment de beaucoup de membres de l’Académie des sciences morales : la Révolution française est incontournable, comme transition de l’Ancien Régime à une démocratie encore lointaine ; celle-ci, selon Furet, ne devant connaître tout à fait son avènement qu’à partir de 1880 ; mais c’est une Révolution par ailleurs, quelquefois déraisonnable, dérapée, selon le mot de Denis Richet, lors des années sanglantes du robespierrisme. Elle incarne ainsi au plus séduisant ou au plus déplorable sens de ce couple de mots, le meilleur et le pire, ne disons pas l’enfer et le paradis, puisque aussi bien le second à la différence du premier ne fait pas nécessairement partie de notre univers concret, quotidien, planétaire.
Le peuple et sa culture à la Vico, toujours, Alain Besançon sera certainement surpris d’être placé par mes soins sous cette rubrique, qui n’est vraiment pas sa tasse de thé. Besançon a pourtant souligné, de façon convaincante l’anomisme ou l’antinomisme hyperchrétien du grand écrivain russe, Dostoïevski, ses délires, ses mensonges et ses folies qui deviennent ensuite sous d’autres regards, sous d’autres cieux, la vérité et la sagesse dostoïevskienne en effet.
Nous en arrivons maintenant à l’immense troupe de ce que Vico appellerait les Républicains. Mais en fait il faudrait y inclure une population beaucoup plus vaste, les hommes d’État des démocraties, certes, mais aussi les pas vraiment républicains, les dictateurs que nous avons évoqués en une cohorte assez bigarrée, parmi lesquels quelques-uns des monstres dont j’ai évité de parler au début du présent exposé pour ne pas inauguré mon discours par une redoutable fausse note.
On se référera d’abord, parmi les Républicains authentiques, à l’exposé de notre confrère Michel Albert, relativement à Robert Schuman ; personnage peut-être mûr pour la béatification, voire la canonisation, puisqu’il est mort, dit-on, après une vie admirable de créativité politique au cours de laquelle il avait, à ce qu’on m’a raconté, préservé entièrement, la pureté de son baptême, ou comme disait autrefois le duc de Saint-Simon, “ il avait préservé son innocence baptismale ”. Il en irait de même, du reste, de Newton, semble-t-il.
Nous rangerons, sans doute possible à mon sens, M. Gorbatchev dans la catégorie des démocrates. Se fussent-ils rendus dignes de cette titulature un peu sur le tard. Et sur ce point, je ne puis que citer la belle conclusion de M. Soutou :
“ Malgré toutes les critiques qu’on peut lui faire, le grand mérite de Gorbatchev devant l’Histoire sera d’avoir compris le caractère inéluctable d’un bouleversement qu’il avait lui-même lancé, même s’il dépassa ses intentions initiales, et d’avoir accepté que ce bouleversement se produise sans effusion de sang en Allemagne ou en Europe orientale, et en URSS même de façon beaucoup moins dramatique que l’on ne pouvait le craindre. Quant à sa volonté, progressivement clarifiée, de sortir du communisme mais de façon ordonnée et sans rupture brutale, elle pose une question de fond passionnante sur le communisme soviétique lui-même : était-il ou non capable de se transformer de façon à aboutir à quelque chose de tout à fait différent ? Sur le plan théorique on peut en douter ; mais sur le plan historique pratique, si on constate que Gorbatchev n’a pas pu éviter une rupture, au lieu de la transition qu’il souhaitait, on constate également que la société soviétique, dans une complexité qui nous apparaît aujourd’hui plus clairement, était capable de sécréter des anticorps et que l’Homo sovieticus n’avait pas tout envahi. Sans oublier bien sûr la fermeté et en même temps l’ouverture de la politique occidentale depuis 1947, selon l’inspiration définie dès le départ par Georges Kennan, visant à résister prudemment à l’URSS pour l’amener à se transformer de l’intérieur : sans cette politique, pas de Gorbatchev. ”
Nous en arrivons maintenant à une tout autre catégorie, celle des dictateurs. M. Milza nous a donné un portrait très détaillé de Mussolini et il a intégré les analyses fondamentales de De Felice, biographe du Duce, et vraisemblablement le plus grand historien italien, ou l’un des plus grands du XXe siècle. Pourtant la scène mussolinienne la plus intéressante et la plus importante peut-être décrite par Milza se trouve dans la biographie du Duce, rédigée par ce même auteur. C’est la scène au cours de laquelle, en septembre 1943, Hitler déclare à Mussolini que si celui-ci (Mussolini) n’accepte pas de reprendre le pouvoir, lui, Hitler, mettra à exécution son plan primitif consistant à détruire par bombardements Gênes, Turin et Milan. Vous remarquerez le “ goût exquis ” (!) du Führer, qui n’envisage pas de raser Florence, ni Venise, ni Rome. Et qui plus est, le même Führer traitera le peuple italien, comme un peuple esclave. Et Milza d’ajouter, page 841 de sa biographie de Mussolini : “ face à cette menace de polonisation de l’Italie, Mussolini n’avait guère d’autre choix que celui de se soumettre aux desiderata de Hitler… ”
Le remarquable Franco de M. Benassar est-il justiciable d’analyses analogues. Au lieu des banalités dualistes sur les Blancs et les Rouges, M. Benassar s’est efforcé de nous servir un Franco découpé en tranches successives, un peu comme le melon de Bernardin de Saint-Pierre que le Créateur avait pourvu de côtes, afin qu’il put être mangé en famille. Il y a la tranche des années 1930 où un Franco évidemment des plus contestables, l’adjectif est beaucoup trop faible, s’oppose à une révolution espagnole qui prend par moment des allures de processus soviétique. Puis surgit la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle de très nombreuses exécutions de Républicains sont accomplies : elles déshonorent une fois de plus le régime franquiste. Enfin, progressivement, vient l’époque de la croissance d’après guerre, y compris à l’époque du Caudillo finissant, puis au-delà.
Quoi qu’il en soit M. Benassar parle de la guerre civile espagnole comme d’une sorte d’ordalie, dont sortira beaucoup plus tard cette Espagne moderne que nous aimons et que nous admirons.
Le Lénine de M. Nicolas Werth est sans concessions. Werth voit dans ce personnage l’inventeur de la police politique et du premier Goulag des îles Solovsky. Werth ayant parlé, il ne reste pas grand-chose du leader génial, ni de la statue de ce même Lénine, ainsi déboulonnée (une fois de plus) par Werth…, il ne reste pas grand-chose de ce que des générations de communistes ont voulu présenter, au point de départ du système soviétique, comme un antidote léniniste, préalable à un stalinisme détestable.
Sur Staline, M. Stéphane Courtois ne peut s’empêcher de pousser, si je peux dire, de longs cris d’admiration. Quel prodigieux organisateur que ce Joseph Vissarionovitch ! M. Courtois, bien sûr, n’est en rien stalinien, mais il considère que Staline était parfaitement programmé pour accomplir la sinistre besogne qui laissera la Russie dans l’état délabré où elle était encore il y a peu. De nos jours, bien sûr, les choses changent et, espérons-le, vont changer encore très vite. Dans quelle direction, dans quel sens, il serait difficile de le prédire, et je n’ai pas la prétention d’être prophète à ce propos.
Quant à Hô Chi Minh, cet autre président-dictateur, je crois qu’il faut quand même employer ce “ syntagme ”, Mme Dulong-Sainteny nous a donné un texte important, qui condense notamment une grande partie de son expérience personnelle au Vietnam, qui condense aussi de nombreuses et savantes lectures de la part de cette historienne.
Nous avons beaucoup de chance en ce qui concerne cet étonnant personnage que fut Hô Chi Minh, même si les Vietnamiens ont eu parfois moins de bonheur avec lui, puisque vient d’être réédité une biographie d’Hô Chi Minh, biographie due à M. Brocheux. Hô Chi Minh est incontestablement un grand homme quant au nation-building, un personnage souvent cruel, pourquoi ne pas le dire, et ne faisant pas toujours beaucoup de cas de la vie humaine, fut-ce par personne interposée. On nous dit que ses amis “ exécutèrent ”, la phrase est de M. Brocheux, les trotskistes vietnamiens. Ne pourrait-on s’exprimer plus clairement et faire remarquer que ceux-ci furent tout simplement assassinés ?
Mme Dulong-Sainteny est parfaitement consciente de l’essence totalitaire, oppressive, et goulaguisante de certains aspects du régime mi-politique, installé au temps de ce leader. Reste que cet étonnant individu, Hô, aimait les fleurs, qu’il écrivait de jolis poèmes, et que son récent biographe a pu de la sorte en faire une personnalité complexe et séduisante, à mi-chemin de l’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, et des petits vieillards modèles de la comtesse de Ségur.
Sur Mao Tsé-toung, Mme Bastid-Bruguière a eu de singuliers mérites : il lui fallait à la fois faire connaître un personnage dont l’essentiel des actions était presque inconnu de beaucoup d’entre nous, et en même temps tirer de lui, les idées générales et les conclusions de portée universelle qu’on attend d’un conférencier parlant de De Gaulle ou de Bismarck, deux hommes qui sont l’un et l’autre plus proches de nous que Mao, et là aussi, je ne puis mieux faire que de citer la conclusion de Mme Bastid :
“ Les souverains préférés de Mao étaient les empereurs qui par les convulsions de transformations brutales avaient frayé la voie à l’âge d’or des Han et des Tang. Ce fut peut-être la fonction de Mao. Avec Tchang Kaï-chek Chiang Kaï-chek, Mao fut le premier autocrate chinois modernisateur et occidentalisant. L’imagination politique a fait la victoire de Mao, sa grandeur et les aberrations meurtrières de son règne. Cette imagination était nourrie chez lui, sans l’ombre d’un complexe ou d’un doute, par le sentiment absolu de son identité chinoise, et par une totale confiance dans la puissance de cette identité ; n’a-t-elle pas, en définitive, aguerri les forces populaires d’une renaissance nationale, libératrice et moderne ? C’est ce qu’exprimait à la veille de sa mort, lors de la manifestation d’opposition sur la place Tiananmen le 5 avril 1976, un poème de protestation contre le régime de Mao :
La Chine n’est plus la Chine de jadis
Le peuple chinois n’est plus ignare
La société féodale du Premier empereur Qin est à jamais révolue. »
Hitler, il nous faut y venir : aux excellents développements que propose M. Burrin, je me contenterai d’ajouter quelques suggestions qui venant du non-spécialiste que je suis risquent de paraître éventuellement déplacées.
Je crois d’abord que Hitler est un révolutionnaire au sens le plus déplorable, le plus détestable de ce terme. Je vois dans notre histoire européenne, ou même plus qu’européenne, trois groupes de révolutions, par ailleurs fécondes, qui constituent le passage progressif de l’Ancien Régime à cette démocratie dont je parlais tout à l’heure ; l’heureuse révolution anglaise de 1640, puis 1688, la Révolution française et les paraphernalia qui l’entourent ; enfin les révolutions européennes si destructrices qui courent de 1917 à 1945, voire jusqu’en 1990 ; elles ont jeté bas l’Ancien Régime dans la plupart des pays d’Europe ; Hitler en est l’une des parties prenantes, il en est même l’un des coryphées, tout à fait haïssable bien évidemment à la différence de tant de héros positifs de ces vingt-huit années, à commencer par les antifascistes et autres résistants…
En second lieu, il me semble, et vous me pardonnerez d’enfoncer cette porte ouverte, qu’Hitler est un esprit faux fut-il par ailleurs assez doué, et intelligent à certains égards.
En 1941, il attaque l’URSS et décrète que ce pays s’effondrera comme un château de cartes ou comme un château de sable. Ses espérances sur ce point ayant été réfutées ou déçues, il déclare qu’au fond lui, Hitler, ne regrette pas quand même de s’être trompé de la sorte, parce que s’il avait mieux apprécié la puissance de l’URSS, il n’aurait pas attaqué ce pays. Or sa mission, en quelque sorte, tracée depuis Mein Kampf, consistait à attaquer, à envahir et à occuper la Russie pour y installer la Grande Allemagne, et il était donc bon, ajoutait le Führer, qu’il se soit lui-même trompé, puisque ainsi, se nourrissant d’illusions, il avait procédé sans crainte à cette offensive, indispensable de toute manière, dans les perspectives historiques allemandes, lesquelles étaient pour lui “ européennes ” sur le mode pervers, l’offensive anti-russe qui s’est avérée beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que ne le pensait ce chef nazi et comme vous le savez, suite et fin de l’histoire, elle s’est terminée de façon effroyable, à tous points de vue.
Les dictateurs, encore, ou les collaborateurs des dictateurs : Goebbels, dont nous a parlé avec talent Marc Ferro, à propos des problèmes de propagande. Immonde salopard, certes, c’est le moins qu’on puisse dire ; canaille, comme l’appellera Joachim Fest, Goebbels est aussi l’auteur d’un prodigieux Journal de 15 000 pages, en une langue allemande relativement facile, et qui comme tel ne sera jamais traduit en français intégralement.Journal publié par un grand éditeur scientifique allemand, éditeur antinazi sans concessions ; le texte ainsi produit est devenu l’une des sources essentielles de la biographie hitlérienne en tous points convaincante qu’a donnée récemment M. Kershaw.
Les rois maintenant, et leurs ministres.
Louis XIV, nous fut présenté deux fois : par l’excellent exposé de M. Petitfils ; et par Denis Maraval qui, au titre des biographies sur lesquelles il s’est exprimé (ci-après) avec beaucoup de talent, avait publié jadis l’excellent Louis XIV de Bluche.
La Révocation, tous nos auteurs, M. Petitfils lui-même et Bluche bien entendu le soulignent, fut certainement l’erreur cardinale du Roi-Soleil, tout comme l’expédition des Dardanelles fut la faute capitale de Churchill. Il est vrai que l’Europe française du Siècle des Lumières est un peu le résultat, la fille putative de cette Révocation, les Huguenots, hélas exilés, ou s’exilant eux-mêmes s’étant empressés d’exporter dans les pays voisins, comme autant de professeurs de français la connaissance de notre langue. Il est vrai aussi que la Révocation louis-quatorzienne s’inscrit dans un contexte européen, certes haïssable, lui aussi, de la Constitution de l’État moderne, par éradication des différences religieuses. Éradication qui du reste n’a pas réussi. Les Anglais en Irlande, les Autrichiens vis-à-vis des Turcs, les Russes à l’égard des vieux croyants ne se sont pas mieux comportés que ne firent les dragons casqués et bottés du roi de France » convertisseur » des calvinistes.
Cette comparaison bien sûr n’est pas une excuse : la France étant la nation matricielle (au point de vue conceptuel) de toutes les autres nations, la France ayant créé le modèle national, se devait de donner l’exemple d’une conduite tolérante et ouverte. Elle se devait d’être le bon élève de la classe. Le moins qu’on puisse dire, est qu’elle ne s’est pas engagée immédiatement dans cette direction. Même si par la suite, la tolérance au XVIIIe siècle, jusqu’à l’édit de libération des protestants de 1787, a retrouvé une grande partie de l’ampleur que lui avait donnée déjà, un siècle auparavant, Henri IV.
De l’œuvre de M. André Zysberg, l’un de nos communicants, j’évoquerai bien sûr le bel exposé qu’il nous a donné sur la marine au temps des trois Rois : Louis XIV, XV et XVI. Mais je voudrais signaler également l’apport considérable qui fut le sien quant à notre connaissance du régime de Louis XV ; lors de son exposé d’abord, et dans un livre en tous points excellent consacré à ce même sujet. M. Zysberg est le premier à avoir montré, par les statistiques de galériens qu’il a publiées, que les envois des Huguenots aux galères s’effondrent en tant que nombres, en tant qu’effectifs de ces malheureux à partir de 1713-1715, et sous la Régence et sous Louis XV. Les règlements draconiens antiprotestants pris par le duc de Bourbon en 1724 contre les calvinistes ne sont pas réellement appliqués à la lettre, même si, hélas, des pasteurs sont encore mis à mort.
M. Zysberg est aussi l’un des premiers à avoir remarqué le mouvement de bascule, d’alternance, qui a emporté le règne de Louis XV, tantôt vers le clan des faucons ou des durs à la d’Argenson, au milieu du XVIIIe siècle, des “ durs ” aussi à la Maupeou un peu plus tard ; tantôt, en d’autres occasions parmi les hommes d’État plus modérés et plus ouverts, comme Fleury et Orry au début du règne, et Choiseul ; voire Turgot après la mort de Louis XV.
M. Chaussinand-Nogaret nous a dépeint un Louis XVI qui certes, avait su magnifiquement mener sa guerre d’Amérique, avec Vergennes – peu de gratitude nous en revient aujourd’hui des États-Unis –, ajoutons que ce fut la première et la dernière guerre gagnée par la France à l’encontre des Anglais en moins de cent ans. Ceci méritait d’être signalé. Mais Louis XVI fut ensuite incapable par aboulisme, dirai-je, par maladie de la volonté, de faire face aux flux révolutionnaires. Remarquons quand même à ce propos que des souverains certes plus ou moins doués selon les cas, comme Pie IX en 1848, ou Guillaume II, Nicolas II, Louis-Philippe, Napoléon III, ne se sont pas montrés capables, eux non plus, de résister à ce que les Anglo-Saxons, sans aucune connotation péjorative appelleraient volontiers une super-vague révolutionnaire ; ces vagues » pyramidales » de 30 mètres de haut qui sont capables d’engloutir d’un coup un pétrolier géant, ou du moins de le casser, de le briser ; à plus forte raison (dans un tout autre contexte !) de faire périr l’Ancien Régime.
Que dire de Pierre le Grand, nous sommes toujours dans les chapitres des rois et des empereurs, sinon paraphraser ce qu’a énoncé avec beaucoup de talent M. Berelovitch en sa communication savante. Je retiens l’image de Pierre, tenant dans ses bras l’enfant Louis XV âgé d’une dizaine d’années lors de la visite de Pierre le Grand en Europe occidentale. Va-t-il le lancer au plafond, ce petit Louis XV, pour qu’il se fracasse en retombant sur le plancher ? Certes non. Mais l’œuvre du tsar autocrate et réformateur reste tributaire de ce que deviendra ultérieurement la grande Russie, passant du quasi-zéro jusqu’à l’infini, puis de l’Etre au Néant, au travers de résurrections diverses, fussent-elles problématiques. “ Faut voir d’où ils viennent ”, disait-on des Russes. C’est l’éternel propos des admirateurs de Pierre au XVIIIe siècle, des communistes français vers 1950-60, et de ceux qui font aujourd’hui confiance ou non à la Russie poutinienne en notre temps.
Après les Rois et les empereurs, ou avant eux, viennent les serviteurs de la monarchie ou des monarchies. J’en dénombre trois dans nos Annales académiques de 2003 : Bismarck, Churchill, Thatcher. Bismarck, en dépit ou à cause des magnifiques contributions de M. Bled, je ne pourrais pas tout à fait lui donner l’absolution, ni le Bon Dieu sans confession. Certes Bismarck a su éviter la guerre sur deux fronts, dans laquelle pataugeront sur le mode sanguinaire ses successeurs plus ou moins immédiats, tant Guillaume II que Hitler. Certes, Bismarck a su être multilatéral et non pas unilatéral comme on dit de nos jours. Mais c’était au fond pour mieux nous humilier, nous, les Français. Disons pour enfoncer une porte ouverte que je préfère infiniment Adenauer, Schmidt, Köhl, Schröder, grands amis de la France. Ma mère n’aimait pas Frédéric II ; pour ma part, je n’apprécie qu’à moitié le chancelier de fer.
Churchill, on l’admirera pour sa politique, raide comme barre, au meilleur sens de ce terme ; et néanmoins, comme l’a montré M. Anthony Rowley, Winston Churchill a fait bêtise sur bêtise, avant de devenir sur le tard le très grand homme que nous savons. Et puis l’on pense à ses bons mots, fussent-ils de mauvais goût sans aucun doute, mais le mauvais goût peut être la marque du génie, qui se permet toutes les licences. Phrase churchilienne, à propos d’Hitler et Staline : “ We killed the wrong pig ” (Nous avons tué le mauvais cochon), disait-il au sujet d’Hitler, en regrettant de n’avoir pas tué Staline aussi par la même occasion ! Cela à la manière de ces chasseurs normands ou chinois du temps jadis qui d’une seule flèche d’arbalète, transperçaient en vol deux canards sauvages. “ The Wrong Pig ”, le mauvais cochon, serait-ce aujourd’hui Saddam Hussein ? Dont on peut se demander si c’est à lui d’abord, ou à lui surtout qu’il fallait porter les premiers coups.
Mme Thatcher enfin, vue par un grand historien de Gironde, fera transition avec les femmes, dernière catégorisation un peu sacrifiée comme toujours, du fait de Gianbattista Vico. La dame de fer a remis l’Angleterre sur pied, même si, à propos de l’Europe unie en général, et de la France en particulier, cette chère Margaret fut maintes fois insupportable.
Jeanne d’Arc, avec notre cher et grand confrère Contamine, n’est pas en reste ; non point d’insupportabilité, mais de grâce mystique. J’ai encore les oreilles remplies du vacarme récent d’un film à propos de cette Sainte, ce film qui du reste ne m’a pas laissé indifférent. C’est en effet, pour en revenir à ce que je disais à l’instant, le mysticisme international de Jeanne d’Arc, mysticisme français, mais répercuté aussi sur l’Italie, que M. Contamine a souligné.
Les reines de France, par ailleurs, celles qu’illumine la science de Madame Cosandey, nous ont offert un tableau des rites à la Giesey – c’est le grand historien américain des funérailles royales –, mais cette fois, il ne s’agit plus d’inhumation, bien plutôt de la ritualisation du cursus de ces grandes bonnes femmes, reines ou régentes de France, ou simplement conseillères du Pouvoir, comme fut Anne de France, et puis Catherine de Médicis… L’une et l’autre ayant exploré les chemins d’un étatisme ouvert. Mentionnons aussi Anne d’Autriche, en son couple paradoxal, et peut-être platonique, Anne et Mazarin, “ pavant la route ” pour l’absolutisme “ new-look ” des années 1660…
Le présent texte était écrit(2) quand nous eûmes le privilège d’entendre Olivier Todd sur Malraux, à propos duquel le conférencier a bousculé quelques légendes… “ résistantialistes ”.
Il nous restait encore à prendre connaissance de Trotski et des trotskistes, notamment en France, dans un exposé presque de fin d’année de Marc Lazar. Cet exposé a stimulé sans doute, et de la belle manière, nos réflexions, en un pays où le trotskisme qu’on a longtemps considéré comme une pure et simple secte accueille dorénavant, ou recueille désormais, 10 % au moins des suffrages exprimés. Ce qui, nous le reconnaîtrons, n’est pas du tout un pourcentage sectaire, même si l’idéologie mise en cause, l’idéologie trotskiste, elle, conserve encore, d’innombrables traces de sectarisme. Mais après tout, Ceylan, Sri Lanka a bien été gouvernée par une femme trotskiste, pendant quelque temps, Mme Bandaranaiké. Alors dirons-nous, pour satisfaire ou contrister les uns et les autres, dirons-nous que rien n’est perdu ? Que tout n’est pas dit, avec ou sans trotskisme, en ce qui concerne notre Hexagone, ingouvernable certes, presque par essence, et qui entend le rester…
(1) Le texte qu’on va lire fut d’abord un exposé “ sous la coupole ” présenté par Emmanuel Le Roy Ladurie, en conclusion de l’année académique, qu’il avait présidée depuis janvier 2003 jusqu’au début de l’année 2004. Ce texte conserve donc un certain caractère de “ discours ” oral.
(2) Ce texte, rédigé à l’automne de 2003 pour un exposé “ sous la coupole ”, prenait acte de la majorité des exposés tout en anticipant sur quelques autres.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.