L’Académie des sciences morales et politiques, le Conseil d’Etat, la Cour européenne des droits de l’homme et la Fondation René Cassin organisaient, ce vendredi 20 février 2026, une journée d’hommage pour commémorer les 50 ans de sa disparition.
Déroulé et discours prononcés
Journée d’hommage à René Cassin (1887-1976)
Vendredi 20 février 2026
René Cassin s’est éteint il y a juste cinquante ans, le 20 février 1976. Alors que je vois encore son cercueil exposé en octobre 1987 en haut de l’escalier d’honneur du Conseil d’Etat, avant son transfert au Panthéon, à l’occasion du centenaire de sa naissance, il m’est très précieux d’ouvrir cette journée d’hommage qui a été organisée par l’Académie des sciences morales et politiques, le Conseil d’Etat, la Cour européenne des droits de l’homme et la Fondation René Cassin.
Les nombreuses facettes d’un parcours exceptionnel seront rappelées cet après-midi. De l’action au service des anciens combattants de la première guerre mondiale à l’attachement aux facultés de droit, en particulier d’Aix-en-Provence, où il est étudia, de Lille puis de Paris où il enseigna, de la décision de rejoindre, dès juin 1940, le général de Gaulle à Londres à la participation à toutes les activités de la France libre, de la vice-présidence du Conseil d’Etat de 1944 à 1960 à la nomination au Conseil constitutionnel, de la rédaction, à partir de la Commission des droits de l’homme des Nations-Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme à la présidence de la Cour européenne des droits de l’homme, de la présidence de l’Union israélite universelle au prix Nobel de la Paix, René Cassin a parcouru d’un pas toujours énergique et déterminé un chemin sur lequel il était porté par l’amour de la liberté, la solidarité envers tous les hommes, la croyance inaltérable dans les forces de l’éducation et de la culture, la conviction qu’au-delà des obstacles et en dépit des tragédies de l’histoire, la marche vers davantage de lumière ouvrirait des horizons meilleurs, marqués par le droit, la justice, le progrès.
Nommé vice-président du Conseil d’Etat le 22 novembre 1944, René Cassin fut installé dans ses fonctions le 23 décembre suivant, en présence du général de Gaulle. Dans l’émouvant discours qu’il a prononcé à cette occasion, il évoque « ce moment décisif où notre France, remontant de l’abîme, reparaît à la lumière et reprend à l’avant-garde des nations, sa place de mère des arts, des armes et des lois ». Ainsi commençait, alors que la guerre n’était pas encore achevée, une présidence particulièrement marquante.
Elu dans notre académie en 1947, au fauteuil numéro 2 de la section Législation, droit public et jurisprudence, qu’occupe aujourd’hui Bruno Cotte, René Cassin en fut jusqu’à son décès un membre assidu. Il prononça le 22 octobre 1951 la notice sur la vie et les travaux de Paul Tirard, membre du Conseil d’Etat décédé en 1945, auquel il succédait, et qui s’était notamment illustré dans les fonctions de secrétaire général du protectorat français au Maroc, sous l’autorité du Maréchal Lyautey, puis dans celles de président de la Haute commission interalliée des territoires rhénans qui lui avait été confiée, au lendemain de la première guerre mondiale, par Georges Clemenceau à l’initiative du maréchal Foch. Evoquant avec prescience ces dernières fonctions, René Cassin écrivait alors : « « Quels que puissent être les évènements à venir et notamment les conditions dans lesquelles pourra s’opérer une réunification de l’Allemagne, il n’y a aucune chance de faire une Europe pacifique si, dans le sein du monde germanique, l’influence de la Rhénanie, proche de l’Occident, ne se fait pas puissamment sentir ». Pour conclure son propos sur Paul Tirard, il déclarait que « le Conseil d’Etat, où se sont formés tant d’excellents artisans de la continuité et de la grandeur de la France, peut être fier de sa mémoire ».
Lors de la séance solennelle de rentrée de notre académie du lundi 8 décembre 1958, René Cassin prononça un discours sur la Déclaration universelle des droits de l’homme qui, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-Unies réunie au palais de Chaillot le 10 décembre 1948, allait fêter, deux jours plus tard, son dixième anniversaire. Il était plus qualifié que quiconque pour expliquer la nature et exposer les apports de ce texte, dont il avait été l’un des principaux rédacteurs. Il montrait aussi que la Déclaration préparait et appelait une évolution des mentalités collectives et individuelles. Avec autant de détermination que de pragmatisme, il déclarait : « La préparation des esprits à la reconnaissance des libertés fondamentales de l’homme, la pratique du respect des droits d’autrui, la compréhension des changements nécessaires pour l’amélioration de la condition de tous : telles sont les conditions préliminaires qu’il faut donc s’efforcer tous les jours de réaliser pour que certaines barrières puissantes, comme les préjugés raciaux et l’esprit de discrimination, puissent céder progressivement et durablement ». Légitimement fier du texte adopté, il relevait que « quelque chose est changé dans le monde depuis que la Déclaration universelle a été proclamée » et que, même sans force juridiquement sanctionnée, celle-ci avait eu « un retentissement moral incomparable dans les lieux les plus reculés de la terre ». Dans des termes qui résonnent encore fortement aujourd’hui, il concluait que « la Déclaration, qui a pris une vie propre, demeurera et est appelée à exercer une influence indépendante sur les conceptions et les mystiques d’union et de construction en face des mystiques de destruction, de violence et de compartimentation impossible du Monde ».
Elu sur le fauteuil laissé vacant par le décès du président Cassin, le professeur René Battifol soulignait, dans la notice sur la vie et les travaux de celui-ci qu’il lut devant notre académie le 28 février 1978, « les bienfaits de l’activité d’un homme qui fut toujours inquiet du bien ».
La voix de René Cassin va de nouveau se faire entendre aujourd’hui à l’Institut, au travers des témoignages qui viennent lui rendre hommage. En ouverture, nous allons écouter deux personnalités qui l’ont personnellement connu, l’un au travers des liens familiaux, Alain Berthoz, membre de l’Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, l’autre au début de sa propre carrière professionnelle, au Conseil d’Etat et à l’Organisation des Nations-Unies, Nicole Questiaux, ancienne ministre et présidente de section honoraire au Conseil d’Etat.

Monsieur le Chancelier, Monsieur le secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les Présidents, Chères consoeurs et chers confrères, Mesdames, Messieurs.
Je remercie l’Académie des sciences morales et politiques, le Conseil d’Etat, la Cour européenne des droits de l’homme et la Fondation René Cassin, organisateurs de cet hommage de m’avoir invité. C’est un honneur, pour un simple neurophysiologiste de prendre la parole en présence de tant d’éminentes personnalités et de spécialistes du droit. Je me limiterai, comme on me l’a suggéré, à quelque témoignages et projets liés à des souvenirs personnels, mais aussi à l’inspiration que m’insuffla celui qui fut mon grand-oncle.
Dans son discours de réception du prix Nobel de la paix, René Cassin a dit, je le cite : « « La déclaration proclame comme principe l’ensemble des droits et facultés, sans la satisfaction desquels l’homme ne peut déployer pleinement sa personnalité physique, morale et intellectuelle » fin de citation. Cette phrase témoigne, au-delà de l’importance que révêtait pour lui le caractère universel des qualités et des droits de l’Homme, de son intérêt profond et de sa complète compréhension de l’originalité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Je peux ici témoigner de son émerveillement devant cette variété. Sur son lit d’hôpital, peu avant son décès, il s’intéressait avec bienveillance au destin personnel de chaque soignant qui entrait dans sa chambre. Il transformait cette visite de routine en un échange humain éphémère mais d‘une rare intensité. Cette attention au vécu individuel est aussi manifeste dans les lettres quasi quotidienne ( il en reste, dans ses archives, plus d’une centaine) qu’il écrivait, au cours de ses nombreux déplacements dans le monde, à sa soeur Félice, ma grand-mère, lui décrivant avec la réserve qui s’imposait, ses rencontres, mais aussi s’intéressant au détail des nouvelle familiales.
Cette passion pour l’individu dans sa diversité, fut, sans doute, un puissant moteur pour toutes les actions qu’il entrepris au cours de son si remarquable cheminement et son acharnement à combattre les obscurantismes et favoriser l’œcuménisme. En même temps il était convaincu que chaque action individuelle est essentielle si elle est guidée par une grande valeur. Un jour il me rendit visite, à Chicago, dans le laboratoire ou je me formais aux techniques de la neurophysiologie, il fut impressionné par le caractère si restreint de notre exploration du cerveau, limité à l’enregistrement de l’activité quelques neurones dans des conditions expérimentales si élémentaires. En me quittant il me fit part de son inquiétude de voir le cerveau de l’homme, réduit à ce point de détail. Bien qu’il en comprenne la nécessité. Il me conseilla alors de ne jamais perdre de vue le « global » « le tout » et de jeter des ponts entre disciplines. Il avait insisté sur cette coopération interdisciplinaire dans son discours d’ouverture d’une session de la formation permanente organisée à l’ENA en 1952 sous la présidence du mathématicien Paul Montel.
C’est ce désir de franchir les frontières du savoir qui inspira notre création du nouveau domaine multidisciplinaire des Sciences de la Cognition auquel participèrent, entre autres, nos confrères Michel Imbert Daniel Andler avec le soutien de Jean Pierre Changeux. Une nouvelle génération, aux frontières des disciplines émergea, passionnée à la fois par l’unité et la diversité des humains. Elle aurait, je le crois sincèrement, enchanté René Cassin.
René Cassin s’intéressait beaucoup à la technologie et a écrit peu de textes sur la science ; toutefois voici un extrait de son discours d’ouverture de la dixième session du Centre des Hautes Etudes Administratives le 20 Mars 1952. Je le cite « Notre pays ne représente plus, en force militaire et en population une très grande puissance du monde. Mais le cerveau inventif des Français, la ténacité avec laquelle depuis des siècles, il représente l’effort intellectuel désintéressé, mais aussi l’ingéniosité dans les applications, tout cela fait que si notre pays veut défendre non pas seulement sa grandeur et son rayonnement, mais même son existence, il doit attacher plus d’importance qu’il ne le fait aux problèmes de la sécrétion des idées, aux problème de l’invention, aux problèmes de la recherche scientifique». fin de citation. Toutefois j’ai noté son inquiétude vis à vis de la perversion éventuelle des découvertes scientifiques. Il recommanda le jour de l’inauguration de l’Institut des Droits de l’Homme à Strasbourg, que l‘Institut : je le cite « prévienne la déshumanisation de la Science et rappeler aux savants qui pourraient l’oublier, comme à tous les puissants, que la science est au service de l’homme» fin de citation
Que l’on me permette ici de dire, très brièvement, quelques mots sur l’écho de sa préoccupation sur rapport entre l’universel et le particulier car c’est aussi un des fondements de l’approche scientifique du vivant. La biologie moderne, par exemple, prend en compte à la fois le génotype , c’est-à-dire le caractère général de la base génétique de chaque espère animale, et de l’homme, et le phénotype, c’est-à-dire les multiples variations des formes prises par une même espèce. Le passage du général au particulier est possible, entre autres, grâce aux processus épi-génétiques, récemment découverts qui produisent une expression originale de la fonction codée par les gènes et dépendent de facteurs internes et de facteurs de l’environnement dans lequel se trouve le bébé qui apparait au monde. Ils sont aussi déterminants pour élaborer la merveilleuse diversité des facultés cognitives et les traditions culturelles. Cette diversité vicariante est un puissant facteur de la créativité, mais aussi un fondement de la démocratie qui la respecte, par contraste avec la dictature qui lamine les individualités, comme le font aussi certaines méthodes de management des entreprises qui réduisent les travailleurs à des pions interchangeables.
J’ai le sentiment que s’il avait été parmi nous, René Cassin eut aimé que nous ne parlions pas seulement du passé mais que, nous nous projetions vers l’avenir. Il me dit un jour sa satisfaction de voir nos efforts pour chercher des perspectives nouvelles. C’est pourquoi permettez moi de mentionner, pour terminer, deux exemples de questions, qui mériteraient peut être une coopération multi et interdisciplinaire avec le domaine du droit.
Le premier, concerne les fondements de la tolérance et de la « pluralité interprétative » qui fut l’objet d’un colloqueau Collège de France en 2008 organisé avec mes collègues des Sciences Humaines Carlo Ossola, Brian Stock et auquel le Président Emmanuel Decaux, et Barbara Cassin participèrent. J’y avait exposé qu’à certains moments de leur développement les enfants peuvent acquérir la capacité de « changer de point de vue » et d’apprendre la tolérance. L’hypothèse est que si entre 8/9 et 12/13 ans, que nous appelons une « période critique », il sont réduits à une perception unique, biaisée, haineuse, d’autrui, ces enfants peuvent, durablement, être la proie, puis les acteurs, de tous les fanatismes. Ce fut le cas des jeunesses hitlériennes, en Angola, et encore aujourd’hui dans les sectes et les écoles de la haine, et aussi chez les « enfants-soldats » que l’on enrôle dans des guerres,. La suggestion, est qu’un véritable « droit à la pluralité interprétative » soit étudié pour protéger les enfants de ce dramatique destin.
Le second est le « Le syndrome E » décrit dans un article publié par le médecin et neurophysiologiste Itzhak Fried dans Lancet. Il s’agit de personnes capables de massacrer de façon répétitive, quasi automatique, des victimes, sans en éprouver la moindre émotion., mais ensuite rentrer chez eux et d’être.de « bons pères de famille ». Ce comportement dual traverse les âges jusqu’à aujourd’hui. Que se passe-t-il dans leur cerveau ? Quels sont les facteurs de la négation de la dignité des victimes et de leur « déshumanisation » ? Ce ne sont pas des psychopathes ni des « tueurs en série ». Ce sont des hommes et des femmes sains inhibant totalement l’émotion et l’empathie. Ils ont une « une fracture cognitive », comme celle qui peut atteindre ceux qui pratiquent la torture. Quel est le poids de la norme sociale car ils agissent toujours en groupe, de l’idéologie, et de la contrainte par la peur dans cette négation des droits les plus élémentaires de la personne humaine ? Une longue réflexion collective sur ce sujet a rassemblé des experts de nombreux domaines à l’Institut d’Etudes Avancées de Paris. Le Président Jean Paul Costa et James Stewart, procureur adjoint la Cour Pénale Internationale, y ont participé et elle fut publiée aux Editions Odile Jacob. Mais il s’agit d’un problème complexe et le défi reste immense. Il nous faut l’aborder avec une grande humilité.
Il y a bien d’autres sujets possibles, très actuels, comme la perte de contact avec le réel dus aux mondes virtuels et à l’intelligence artificielle. Mais mon temps de parole est épuisé. J’espère avoir simplement témoigné ici mon admiration pour la pensée et la personne de René Cassin, de son extraordinaire joie de vivre, et sa confiance dans l’avenir, malgré un monde dont il avait éprouvé la férocité dans sa chair.
Alain Berthoz
.

- Nicole Questiaux, Présidente de section honoraire du Conseil d’Etat
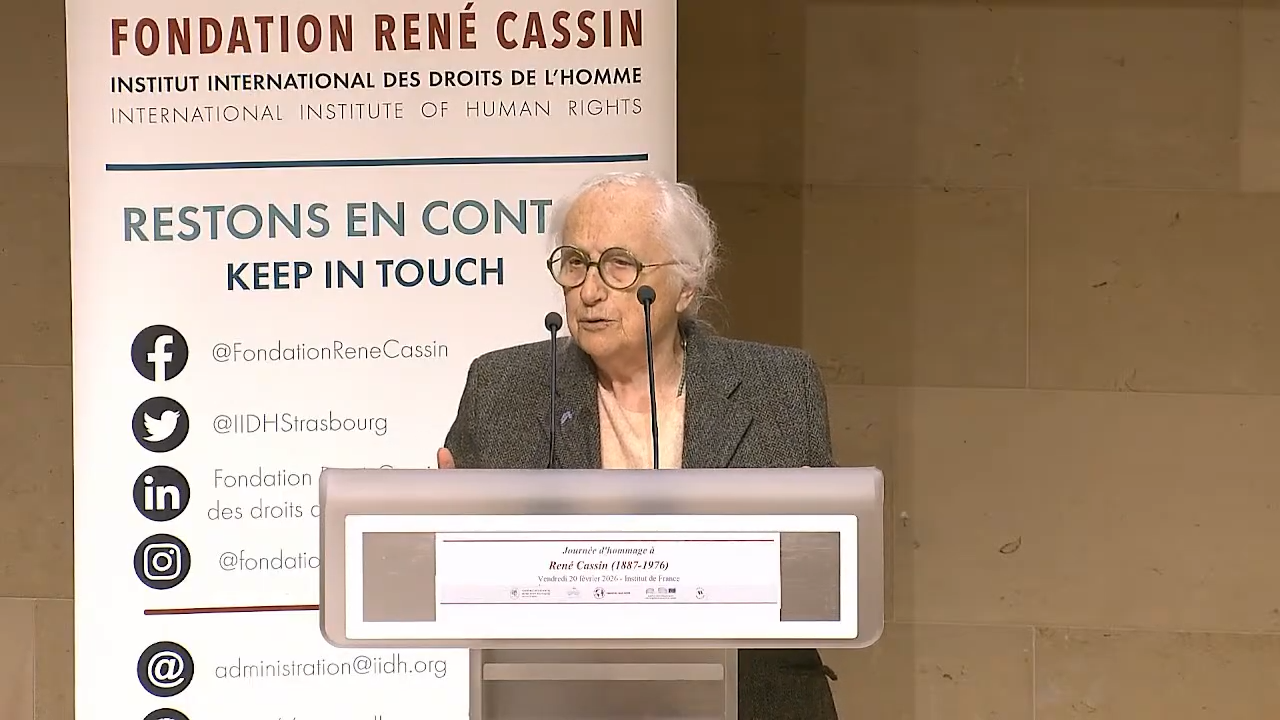
14h30 – 15h30 René Cassin face à l’Histoire – sous la présidence de Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France.

Monsieur le Vice-président du Conseil d’État, Monsieur le président de la Cour européenne des droits de l’homme,
Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le président de la Fondation René Cassin, chers Emmanuel Decaux et Bernard Stirn -qui savent l’un et l’autre pourquoi je les salue ici tout particulièrement, du plus loin d’une très ancienne amitié,
Chers confrères, chères consoeurs de l’Institut de France,
Chers collègues,
Mesdames, messieurs,
Je remercie tous les organisateurs de cette journée d’hommage de m’avoir fait l’honneur d’y prendre la parole, mais je pense qu’il est nécessaire de préciser ici les deux limites de cette prise de parole : je ne suis aucunement un spécialiste de « la vie-et-l’œuvre » de René Cassin et, surtout, je ne suis aucunement juriste -même si, sur ce dernier point, je dois avouer que j’ai beaucoup appris au contact de Bernard Stirn au long de nos nombreuses années communes à l’Institut d’études politiques de Paris -nous avons, même, pendant un an, assuré ensemble un cours sur le « Service public »…- et si c’est au long de ces années communes que j’ai découvert qu’il existait -comment dire ?- deux sensibilités au droit légèrement distinctes, celle des facultés de droit et celle du Conseil d’État. Avec ce petit moment d’autobiographie je ne pense pas m’être éloigné de l’objet de cet après-midi…
Emmanuel Decaux a qualifié récemment (dans l’édition 2025 des Hommes partis de rien, p. 8) de « récit canonique » le texte, publié en 1950, dans lequel René Cassin a raconté sa rencontre avec le général de Gaulle, le 29 juin 1940. On trouve dans ce texte une phrase au fond assez énigmatique :
« Cinq minutes à peine après le début de notre entretien, je me mis donc à ce travail décisif (il s’agit des futurs accords Churchill-De Gaulle) « auquel trente années de labeur dans les domaines les plus variés et les plus étrangers à ma profession m’avaient mystérieusement préparé ».
Tentons de traduire : le René Cassin de 1940 -je dirais : de juin 1940 ; je dirais : du 29 juin 1940 (car il y a des moments dans l’histoire d’un homme, dans l’histoire d’un pays, dans l’histoire du monde où, en effet, chaque minute compte -« cinq minutes à peine après le début de notre entretien »-), oui, le René Cassin de ce moment-là a une « profession » qu’il n’explicite pas- et « depuis trente années » il œuvre « dans les domaines les plus variés » de ladite profession, mais aussi dans « les domaines les plus étrangers » à celle-ci. Il importe maintenant d’essayer de traduire cette traduction : ce sera l’objet de ce cet exposé.
La « profession » de René Cassin, c’est, incontestablement, celle du droit, du droit enseigné, dans la continuité d’études qui vous conduisent dans ce cas du doctorat à l’agrégation.
Né en 1887 le juriste Cassin a :
vingt-et-un ans à l’issue de son cursus de licence en droit, couronné par la mention « très bien » et un premier prix au concours général des facultés de droit ;
vingt-six ans à l’issue de son cursus doctoral, couronné non par une mais par deux thèses, soutenues à trois mois d’intervalle : l’une de « sciences juridiques », l’autre de « sciences politiques et économiques » ;
vingt-huit ans quand il se voit confier une première charge de cours -en faculté de droit ;
trente-trois ans quand il est reçu à l’agrégation de droit privé – classé troisième de ce concours national- et, par voie de conséquence, élu professeur des facultés de droit.
Dès cette époque fondatrice on commence cependant à discerner les « domaines les plus variés » et les « domaines les plus étrangers ». Ainsi du choix -qui n’est pas si rare à son époque mais qui est très significatif- d’ajouter, en parallèle de la licence de droit, une licence d’histoire ; ainsi d’une remarquable ouverture des problématiques du droit privé vers des horizons plus larges, ouverture perceptible lors d’une conférence que donne à l’Université d’Aix-en-Provence le jeune chargé de cours dans le grand amphithéâtre non pas, en effet, de la faculté de droit mais de la faculté de lettres. L’intitulé dit tout de cette ouverture ou, si l’on veut, de ce glissement : « L’Inégalité entre l’homme et la femme dans la législation civile » : formulation juridique, enjeu politique. Et le glissement est accentué par l’égide non de ce cours mais de cette conférence : celle de l’Union française pour le suffrage des femmes, une organisation féministe, modérée, assurément, mais pas modérément féministe. Ce juriste de « profession » a donc des curiosités intellectuelles et des engagements -appelons-les, déjà- politiques.
Voilà une certaine façon de voir les choses. Mais je n’apprendrai ici rien à personne en disant que l’Histoire, avec un grand H -« avec sa grande hache », disait, vous le savez, Georges Pérec-avait déjà à ce moment donné un tout autre sens à cette carrière, qu’elle était en train de transformer en destin. À cet égard la date de soutenance des deux thèses de doctorat dit tout : avril 1914 pour la première, juin 1914 pour la seconde.
L’Histoire en question s’appelle donc la Première guerre mondiale -dénommée dès ses tout premiers jours -notons le-, du côté français, non pas la « Grande Guerre » -formulation qui apparaîtra quelques mois plus tard- mais « la Guerre du Droit » (discours de Raymond Poincaré, président de la République française, devant les deux chambres -l’acmè de la solennité-, le 4 août 1914). La conférence d’Aix sur « L’Inégalité entre l’homme et la femme dans la législation civile », où le jeune Cassin n’hésite pas à qualifier de « suranné » « le principe de l’incapacité de la femme mariée en matière d’actes juridiques » s’éclaire de même par sa date : 26 janvier 1919.
La métamorphose d’une carrière de juriste, honorable et honoré, en destin d’humaniste, Prix Nobel de la Paix, s’origine donc dans la manière dont René Cassin va agir et réagir face à la violence extrême d’une guerre au sein de laquelle -suivant la formule convenue- « il donne de sa personne » (65 % d’invalidité) et face aux non moins violentes questions qu’elle pose aux valeurs d’un individu né et grandi sous la Troisième république. Ce que l’individu résumera en ces termes à un moment capital de son existence, son discours d’Oslo, à la remise, en effet, de son Prix Nobel, le 11 décembre 1968 : « Par une sorte de pudeur, et même de méfiance vis à vis de mes impulsions (notons le mot) « je me suis abstenu, pendant toute la durée de mes études supérieures de droit et de lettres (notons : « et de lettres ») en vue du professorat, de traiter des sujets d’ordre politique » (…). C’est véritablement la guerre de 14-18 qui m’a tiré du confort moral provisoire ou, pour être moins sévère, de la concentration à laquelle je m’étais astreint »
Le René Cassin de l’Histoire -cette fois avec le grand H d’« Humanité »- est ainsi déjà celui qui, grand invalide, monte en généralité, en participant, dès mars 1916, à la création à Aix de l’une des premières associations de mutilés de sa région, puis en s’investissant dans un programme inédit d’acquisition de prothèses destinées aux gueules cassées. Premiers pas vers un engagement de tous les instants qui ne prendra fin que lorsque le ralliement au général de Gaulle transformera le sens de toute une vie. L’importance politique et philosophique de cette transformation de 1940 a fait parfois oublier que, pendant un quart de siècle (1916-1940), des mutilés d’Aix au Secours national, le nom de René Cassin était déjà connu, et jusqu’à une échelle internationale, dans un milieu dont on a, le temps passant, oublié la triple importance sociale -y compris dans l’histoire des politiques sociales-, politique (y compris dans l’histoire des politiques internationales- et morale (y compris dans l’histoire des grands basculements idéologiques de l’Entre-deux-guerres, la bien et tristement nommée- : les Anciens combattants, toujours associés et élargis ici aux « victimes de guerre », y compris (je cite) « veuves, ascendants et orphelins de guerre » comme le précise l’intitulé de l’Union fédérale à laquelle Cassin adhère dès sa fondation, en 1918 -ces anciens combattants qui vont représenter, en fait, 42 % de la population masculine française de plus de vingt ans-.
Dans les cinq années qui suivent la guerre René Cassin a déjà parcouru tout l’orbe des responsabilités au sein de cette Union fédérale, de cette « UF » : administrateur en 1919, secrétaire général en 1920, vice-président en 1921, président en 1922, président d’honneur en 1923… Précisons que l’UF sera dans l’Entre-deux-guerres la première association française d’anciens combattants par le nombre d’adhérents.
Les initiatives auxquelles le nom de Cassin sera associé résument bien la nature de cet engagement. Le juriste épaule l’humaniste dans l’élaboration de la loi dite Lugol, du 31 mars 1919, instaurant un droit à la reconnaissance et à la réparation pour les mutilés de guerre, comme dans la mise en place de la carte puis de la retraite du combattant, au nom du « droit au secours ». L’un et l’autre perfectionnent la formule des « offices nationaux », de gestion paritaire, qu’ils appliquent aux mutilés et aux pupilles de la Nation.
Cet engagement pourrait suffire à un seul homme -il suffira à la grande majorité des responsables de l’Union-. Mais, le temps passant, sur les vingt années qui séparent et qui unissent 1919 de 1939, cette focalisation ne sera pas sans ambiguïté pour la plupart d’entre eux, qu’on retrouvera en 1940 réunis autour du maréchal Pétain, voire d’une équivoque plus grave encore pour certains dirigeants, à commencer par le plus proche camarade de Cassin, Henri Pichot, président -lui- permanent de l’UF à partir de 1934, qui se laissera séduire par la propagande du IIIème Reich, son interlocuteur d’outre-Rhin, un certain Otto Abetz, rencontré à l’époque où il était jugé proche du SPD, restant son interlocuteur quand il sera devenu nazi, Pichot acceptant de devenir le secrétaire général du tristement célèbre Comité France-Allemagne.
Par contraste avec ce cheminement celui de René Cassin éclaire ce qu’on peut dès lors appeler son engagement politique. Deux noms d’organisation le résument : le Parti républicain radical et radical-socialiste et la Société des nations. Il adhère au premier et candidate à deux reprises -mais en vain- à son investiture pour une élection locale, mais l’essentiel pour lui -et pour son avenir- va tenir dans la victoire du Cartel des gauches aux élections de 1924, qui lui permet d’entrer dans les cercles gouvernementaux du parti. Léon Bourgeois le recommande à Édouard Herriot comme membre de la délégation française non pas exactement auprès de la SDN, comme on le dit parfois, mais auprès de l’Assemblée générale de la SDN, réunie une fois par an un mois à Genève. Il y entre avec le titre de « délégué adjoint », fonction qui, reconduite chaque année, par-delà les changements de majorité gouvernementale, restera la sienne jusqu’en 1938. Il y figure au titre de l’UF, considérée par les observateurs comme l’association d’anciens combattants proche des radicaux et des socialistes, à distance respectivement de l’UNC, nettement à droite, et de l’ARAC, proche du Parti communiste.
Et c’est là que se précise la figure d’un intellectuel auquel certains de ses contemporains vont, à l’époque, associer le qualificatif de « pacifiste ». Un terme qui n’a pas de définition rigoureuse -parce qu’il ne peut pas en avoir- mais qui est dans la logique de ce positionnement au centre-gauche, entre aile gauche du Parti radical et SFIO de Léon Blum, et que confirme, sur le plan diplomatique, l’attachement de Cassin à Aristide Briand -du vivant du ministre comme après sa mort, en 1932. Il est présent le 14 décembre 1925 quand Briand vient à Genève participer à l’enregistrement des accords de Locarno. Il l’est aussi le 30 septembre 1930 quand -le point n’est pas négligeable, à considérer la suite- Briand définit les limites de ce qu’il appelle désarmement, « dans des conditions de sécurité telles qu’il n’y ait pas de dupes ni de victimes ». Il prend la parole à Paris en 1937 à l’inauguration du monument du Quai d’Orsay, dans une conjoncture désormais très assombrie, il la prend a de nouveau en 1965, saluant à travers Briand le triptyque, désormais ressuscité, « conciliation, arbitrage et règlement judiciaire international ».
Ce mot d’ « intellectuel » -que j’ai défini jadis comme une figure de légitimité culturelle (ici celle d’un juriste reconnu) qui met cette légitimité au service d’une cause politique plus large- convient tout à fait au Cassin de la Société des nations, fidèle à sa première réflexion juridique, en 1917-18, sur « la condition des sujets ennemis pendant la guerre », cheville ouvrière de la Conférence internationale des associations de mutilés et d’anciens combattants (CIAMAC), qui réunit au sein d’une même entité les ennemis d’hier, ou encore soutien actif de l’Institut international de coopération intellectuelle, ancêtre de l’UNESCO et, comme le sera celle-ci, installé à Paris.
Notre mémoire collective a, dès avant le déclenchement de la Seconde guerre mondiale, oublié l’activisme de tous ces intellectuels, regroupés -en même temps que dispersés…- entre plusieurs associations françaises ou internationales, un Georges Huisman ou un Gustave Monod, un Paul Appell ou un Julien Cain, un Georges Scelle… : il faudrait donc y ajouter le nom de René Cassin. La mémoire de celui-ci, en revanche, n’a pas oublié jusques après la Seconde guerre mondiale l’engagement international d’un Paul Mantoux, d’un Albert Thomas ou d’un Adrien Tixier et c’est dans cet univers genevois -qui ne se limite pas aux stratégies amoureuses du Solal d’Albert Cohen-, qu’il va tisser des liens anticipateurs avec un Anthony Eden ou un James T. Shotwell, que Cassin saluera plus tard comme « (son) associé dans la recherche de la prévention d’une seconde guerre mondiale ».
L’échec absolu de ce qu’il qualifiera lui-même de « mystique SDN » permet de mieux délimiter là où se situe Cassin, qui fait clairement partie de ces déçus du pacifisme qui, tels un Jean Guéhenno ou un Pierre Brossolette, se découvrent partisans de la « résistance » -le mot apparaît en 1938- face à la montée des nouveaux impérialismes. L’année de Munich celui qui venait tous les ans se ressourcer à Genève se refusera à y revenir,
voyant désormais en cette ville un lieu dont il importait de se tenir « résolument à l’écart ». Le texte douloureux que Cassin lira sur l’antenne de la BBC le 8 septembre 1940, pour l’anniversaire de la bataille de la Marne, refermera la problématique de l’Entre-deux-guerres sous la forme d’une prosopopée du Soldat inconnu s’exclamant : « Ce n’est pour cela que je suis mort ! » Cette instrumentalisation de l’ancien combattant idéal -renouvelée en 1938 avec le deuxième J’accuse ! d’Abel Gance- est ici retournée, dans un sens patriotique.
Les textes que René Cassin va publier pendant la Drôle de guerre établissent en effet déjà le substrat théorique d’un universalisme, qu’il s’agit désormais de concilier avec le patriotisme. L’essai qu’il publie en avril 1940 chez Gallimard oppose, au nom des droits de « l’homme » « l’État Léviathan » à « la communauté humaine » et esquisse l’ébauche d’une déclaration en effet « universelle ». Dans Les Hommes partis de rien René Cassin ira jusqu’à écrire qu’il a (je cite) « un moment hésité à répondre positivement à l’appel du 18 juin », « par scrupule d’abandonner une mission humanitaire » -en l’occurrence l’animation du Secours national, organisation de secours aux premières victimes civiles de la Seconde guerre mondiale, reconstituée sur le modèle du Secours national de la Première. On ne dit pas plus clairement où se situe le moteur profond de cette vie exemplaire : le droit, sans doute, mais conçu comme la mise en institution d’une philosophie de l’homme inspirée des valeurs des Lumières.
Ainsi revient-on, pour finir, au texte de 1950 : « ce travail décisif auquel trente années de labeur dans les domaines les plus variés et les plus étrangers à ma profession m’avaient mystérieusement préparé ». On a pu mesurer ce que recouvrait « les domaines les plus variés » et « les domaines les plus étrangers ». On a aussi compris comment ladite profession est la porte d’entrée sur tout le reste. Demeure un mot mystérieux : le mot « mystérieusement ». Sans doute faut-il y voir une coquetterie de l’auteur. Car le mystère en question n’est pas si mystérieux que cela. Il y entre sans doute l’auto-réflexivité d’un juif de culture libérale, d’un laïque de la Troisième république, d’un enfant de l’Affaire Dreyfus,… : j’arrête ici l’énumération. À chacun, à chacune d’entre nous, de poursuivre l’enquête. Ce sera -si je l’ai bien compris- l’objet de cette journée d’hommage.

INSTITUT DE FRANCE
HOMMAGE À RENÉ CASSIN
20 février 2026
Le « Légiste de la France Libre »
Hervé GAYMARD
À quoi tiennent les destinées ?
Si René Cassin avait été désigné en 1932, comme il le souhaitait, par le parti radical pour être candidat aux élections législatives à Albertville, – dont je fus le député -, aurait-il embarqué dans le même bateau que Raymond Aron, dès le 23 juin 1940 à Saint-Jean de Luz, après avoir salué les siens au cimetière, et réglé ses impôts, pour rallier parmi les premiers le général de Gaulle ? Connaissant sa rigueur et son intégrité, on peut imaginer que s’il avait été parlementaire, sa tentation inassouvie depuis 1928, il serait resté d’abord sur le territoire national et aurait compté parmi ceux qui auraient refusé le 10 juillet 1940 le sabordage de la République à Vichy.
Parlementaire, il ne le fut point – sauf brièvement nommé à l’Assemblée Consultative d’Alger du 17 septembre 1943 au 31 mai 1944 – et c’est un éminent juriste, ancien combattant, mutilé de guerre, président de l’Union Nationale des Combattants, qui se présente le 30 juin 1940 devant le général de Gaulle, qui lui rend un hommage appuyé dans ses Mémoires de Guerre : « Quelques-uns, pourtant, furent tout de suite à mes côtés et apportèrent aux devoirs qu’ils assumèrent à l’improviste une ardeur et une activité grâce auxquelles, en dépit de tout, le navire prit et tint la mer. Le Pr Cassin était mon collaborateur – combien précieux ! – pour tous les actes et documents sur lesquels s’établissait, à partir de rien, notre structure intérieure et extérieure. »
« À partir de rien… » Ce n’est pas par hasard qu’il choisit le titre Les Hommes partis de rien pour ses mémoires parues en 1974. Avoir eu la chance de voir son petit carnet de cette année-là, aux pages noircies d’une écriture serrée, fait mesurer le dénuement et l’espérance, qui animaient ces Français Libres du premier jour. Et évoquer, en quelques minutes, « le Légiste de la France Libre », révèle un pan oublié de cette épopée inouïe, dont les aspects militaires, diplomatiques et politiques, ont occulté le fait que la France Libre mena aussi un combat juridique pour que la France recouvre sa souveraineté et son honneur. Et c’est René Cassin, assisté de Pierre Tissier, seul membre du Conseil d’État à Londres, qui mena ce combat. On connait le dialogue fameux entre le chef de la France Libre et le Professeur de droit. René Cassin lui dit : « Nous sommes non une légion, mais donc des alliés reconstituant l’armée française et visant à maintenir l’unité française ? » Et c’est un militaire qui lui répond : « Nous sommes la France. » René Cassin commente dans ses mémoires : « Si Hitler regardait par le trou de la serrure, et entendait ce civil efflanqué, ce professeur qui doctrinait : « Nous sommes l’armée française » et ce grand général à titre provisoire qui renchérissait : « Nous sommes la France », il s’écrierait certainement : « Voilà deux fous dignes du cabanon. » Le droit est un savoir, la connaissance d’une tradition, d’une jurisprudence, c’est un art d’interprétation, qui nécessite de l’imagination. Mais il est rare pour un juriste de s’aventurer en terrain vierge. Il s’y était plus ou moins consciemment préparé, car il s’attelle à cette tâche avec ardeur : « Je me mis donc à ce travail décisif auquel trente années de labeur dans les domaines les plus variés et les plus étrangers à ma profession m’avaient mystérieusement préparé ». Dès 1936, l’homme de paix s’angoisse de la perspective de « mourir sans avoir donné toute sa mesure », et de n’avoir jamais investi « la place où l’on exécute soi-même ce que l’on conçoit ». C’est sans doute un trait commun aux Français libres de 1940, le fait d’étouffer dans une France des années 1930 corsetée par les petitesses, les rancœurs et les conservatismes craintifs que décrivait Marc Bloch. Le grand vent de l’histoire cingle Cassin là où il inhibe tant d’autres.
Le général de Gaulle n’écrit jamais rien au hasard, et quand il évoque « notre structure intérieure et extérieure », c’est bien la feuille de route qu’il assigna à René Cassin, et dont il s’acquittera avec persévérance et brio.
Dans l’ordre extérieur, la priorité est la mise au net des relations juridiques entre le gouvernement britannique et la France Libre. Après un mois de négociations serrées, un accord est conclu le 7 août 1940. De Gaulle n’arrive pas à obtenir la garantie du retour aux frontières de 1940 de la métropole et de l’Empire, mais une formule due au talent de René Cassin permet de préserver l’avenir : « la restauration intégrale de l’indépendance et de la grandeur de la France. » Le juriste se fait également financier : le 19 mars 1941, un accord financier, économique et monétaire est conclu avec la Grande-Bretagne : la Treasury consentira une avance à la France Libre, qui sera intégralement remboursée après-guerre. Le juriste se fait également diplomate. Dès le début de l’opération Barbarossa en juin 1941, de Gaulle télégraphie depuis Beyrouth à René Cassin, pour lui demander, ainsi qu’à Maurice Dejean, d’entrer en contact avec Ivan Maïski, l’ambassadeur soviétique à Londres. Affaire rondement menée : le 26 septembre, par un échange de lettres, l’Union Soviétique reconnaît le Comité National français.
Mais c’est également dans l’ordre interne et le rétablissement de la légalité républicaine que René Cassin jouera un rôle majeur, dans les fonctions diverses que lui assigna le général de Gaulle pendant ces quatre années, couronnées par sa nomination comme Vice-Président du Conseil d’État, le 22 novembre 1944.
Le 27 octobre 1940, il fait partie des neuf membres du Conseil de Défense de L’Empire, première ébauche de gouvernement provisoire, avec Catroux, Muselier, Larminat, Sicé, Sautot, Éboué, d’Argenlieu et Leclerc. Le 29 janvier 1941, le général de Gaulle lui en confie le secrétariat permanent. Dans cette fonction capitale, il assume la responsabilité des services de Londres, quand de Gaulle est absent, avec Muselier, Pleven et Dejean. Absent, de Gaulle le consulte souvent comme en témoignent les longs et nombreux télégrammes échangés au premier semestre 19411.
Le 24 septembre 1941, il est nommé parmi les neuf membres du Comité National Français, chargé de la Justice et de l’Instruction publique. Jacques Maritain et Alexis Léger ont refusé d’en faire partie. C’est René Pleven qui en sera l’animateur, car de Gaulle estime que René Cassin n’est pas suffisamment habitué à prendre des décisions fermes. C’est une époque où il voyagera beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique, visiter les établissements d’enseignement français. Mais dès que le général de Gaulle rallie Alger au printemps 1943, c’est à lui qu’il confie la gestion des affaires courantes à Londres en son absence.
Mais son œuvre majeure est évidemment, d’une part de bâtir le corpus juridique de la France Libre, par 60 ordonnances de 1940 à juin 1943, et d’autre part de mettre en œuvre les voies et moyens du retour à la légalité républicaine, par 131 ordonnances dans l’année qui précède la Libération. À Londres d’abord, il préside dès le 24 septembre 1941 une commission de législation installée près le Comité national français. Dès juillet 1943, de Gaulle l’appelle auprès de lui à Alger, pour participer à la restauration de l’État républicain. Louis Joxe est nommé secrétaire général du gouvernement. Un mois plus tard, René Cassin préside le « Comité Juridique », qui joue, quant aux avis à fournir et aux textes à mettre en
forme, le rôle normalement dévolu au Conseil d’État. » Un Comité du Contentieux, présidé par Pierre Tissier, joue le rôle du Conseil d’État en matière juridictionnelle.
Rappelons brièvement quelle fut cette « marche en avant » juridique menée d’arrache-pied par René
Cassin et qui s’étend sur quatre années.
L’Appel du 18 juin 1940, fut ce « Non ! » du premier jour, qui seul est resté dans les mémoires.
Mais le manifeste de Brazzaville du 27 octobre 1940, et la déclaration organique du 16 novembre 1940, œuvres de René Cassin et Pierre Tissier, sont au moins aussi importants, car ces deux textes témoignent de la volonté de restauration de l’État républicain. La France Libre devient une force militaire au service d’un État souverain, qui depuis les ralliements des territoires français du Pacifique et d’Afrique Équatoriale a désormais une assise territoriale. Symbolique à ce titre, sont la nature des publications officielles auxquelles veille René Cassin. L’accord du 7 août 1940 avec la Grande-Bretagne avait été publié le 15 août 1940 dans le numéro 1 du Bulletin Officiel des Forces Françaises Libres. À partir de l’automne 1940, l’État républicain est de retour. On imagine la fierté de René Cassin de voir sortir des presses le 20 janvier 1941 le premier numéro du Journal Officiel de la France Libre, dont la typographie et le mise en page sont l’exacte décalque du Journal Officiel de la République Française.
Avec ces deux textes juridiques majeurs, on peut parler d’une « Constitution de Brazzaville ». Est institué une ébauche de gouvernement provisoire, le Conseil de Défense de l’Empire, ainsi qu’un Ordre national, l’Ordre de la Libération. Mais surtout, par une analyse juridique serrée, constatant que Vichy foule aux pieds les principes républicains, que la
loi de 1884 qui dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision » est toujours en vigueur, ainsi que les lois constitutionnelles de 1875, la France Libre reprend le flambeau de la République :
« La France traverse la plus terrible crise de son Histoire. Ses frontières, son Empire, son indépendance et jusqu’à son âme sont menacés de destruction. […] Or, il n’existe plus de Gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n’est, en effet, qu’un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l’honneur et l’intérêt du pays. Il faut donc qu’un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l’effort français dans la guerre. Les événements m’imposent ce devoir sacré, je n’y faillirai pas. J’exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, et je prends l’engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu’il lui aura été possible d’en désigner librement. »
En décembre 1940, René Cassin publie un article fondateur dans la revue France Libre, intitulé Un coup d’État, la soi-disant constitution de Vichy, dans lequel il développe pour le grand public les attendus de la déclaration organique du 16 novembre 1940, et déroule la chronique juridique de ce qui est advenu depuis le 10 juillet 1940. En février 1941, il répond au général de Gaulle qui le questionne sur l’attitude à adopter vis-à-vis de Vichy : « Exclusion, de principe, de relations avec Vichy, pour éviter la diminution de notre position morale vis-à-vis du peuple français […] Il faut plutôt insister actuellement sur le défaut de liberté et d’autorité, que sur l’illégalité, déjà acquise. » Radié de l’Université depuis le statut des juifs d’octobre 1940, il est déchu de sa nationalité française et condamné à mort par contumace en avril 1941.
Le 22 décembre 1943, il reçoit une instruction très détaillée du général de Gaulle, qui lui confie la mission de procéder à l’examen critique de tous les textes publiés à Vichy depuis le 10 juillet 1940, en liaison avec les Commissaires, en lui demandant de les classer en trois catégories : droit commun de la nullité avec effacement des effets dans le passé ; validation en bloc ; abrogation globale simple avec validation des effets dans le passé. C’est un travail titanesque, qui débouche notamment sur l’ordonnance du 9 août 1944. C’est rien moins que la mise en place de « l’État clandestin » qui apparaîtra au grand jour au fur et à mesure de la libération du territoire.
Dans le sixième alinéa de l’exposé des motifs de ce texte fondateur, apparaît la différence qui sépare la légalité, que l’on « rétablit », de la légitimité, au nom de laquelle on agit. En effet le « rétablissement de la légalité républicaine » s’assigne comme but, la continuité avec le « dernier gouvernement légitime de la République ». Sa date, fixée au 16 juin 1940, jour de la démission de Paul Reynaud et de la nomination légale du Maréchal Pétain, marque la fracture entre une légalité, qui existe encore pour quelques semaines, et une légitimité qui n’est plus opérationnelle en France. L’article 1 dispose que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister » . Fort logiquement, l’article 2 dispose que « Tout ce qui est postérieur à la chute du gouvernement dans la journée du 16 Juin 1940, du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité. »
Seize jours après la publication de cette ordonnance, Paris est libéré. Une autre époque commence pour la France, et une autre mission pour René Cassin, d’abord auprès du chef du gouvernement provisoire, puis comme Vice-Président du Conseil d’État.
Mais avant de conclure, je voudrais évoquer le rôle capital de René Cassin dans le rétablissement du décret Crémieux, qui avait donné en 1870 la pleine citoyenneté aux juifs d’Algérie, et qui fut abrogé par Vichy le 7 octobre 1940. On reproche parfois au général de Gaulle, et donc à René Cassin, de ne pas l’avoir rétabli immédiatement. Ce reproche est infondé. Soit il relève de la mauvaise foi. Soit il témoigne de la méconnaissance de la chronologie et du rapport de force sur l’échiquier complexe d’Alger en 1942-1943. Après le débarquement allié de novembre 1942, bien évidemment ni l’amiral Darlan, ni le général Giraud qui lui succède après son assassinat en décembre, ne veulent rétablir le décret. En effet, Giraud nomme comme gouverneur général de l’Algérie le 20 janvier 1943 Marcel Peyrouton, celui-là même qui avait abrogé le décret en 1940. Depuis Londres, de Gaulle et Cassin veulent tout simplement rétablir les lois de la République. Dès le lendemain du discours du 14 mars de Giraud, qui ne revient pas sur l’abrogation, Cassin2 rédige une note qui développe son argumentation : 1/ en réponse à la propagande allemande, qui tente d’exciter les élites musulmanes contre un « privilège » qui serait donné à la population juive, Cassin rappelle que la possibilité d’acquérir la citoyenneté française est aussi ouverte aux musulmans selon un autre des Décrets Crémieux, mais que seule une infime minorité a fait le choix pour cela de renoncer au statut et à la loi coranique, et 2/ surtout, l’immense majorité des juifs d’Algérie est née après 1870 : elle n’est pas française en vertu du décret Crémieux, mais parce que fils ou fille de Français.
Cependant, si le principe du rétablissement du décret ne fait aucun débat à Londres, la négociation politique avec Giraud complique la donne. Ce n’est que le 15 mai, lorsque l’accord avec Giraud est quasiment acquis, que Cassin obtient la publication d’une mise au point officielle affichant son argumentation, favorable à une ouverture progressive de la citoyenneté aux indigènes :
« Le Comité national ne saurait s’associer à une mesure qui retire à une catégorie de Français les droits que la République leur avait donnés […]. L’égalité entre les indigènes de l’Algérie, musulmans ou juifs, ne saurait être conçue comme un nivellement par le bas… »
Le dossier reste ouvert quand de Gaulle et Giraud instituent le mois suivant à Alger le Comité français de la libération nationale. Deux thèses sont en présence : à celle des Français Libres (rétablissement du décret Crémieux), s’oppose une thèse, fortement défendue en Algérie, qui tend à pérenniser l’abrogation du décret Crémieux, mais en accordant « en contrepartie » la citoyenneté française à tous les « sujets indigènes » d’Algérie, juifs ou musulmans, ayant la qualité, soit d’anciens combattants, soit de titulaires d’une décoration, soit de titulaires d’un diplôme de l’enseignement public à partir du certificat d’études, ce qui réintégrerait dans la nationalité française quelque 40 000 juifs algériens sur le total de 130 000. Cependant, dès le 1er septembre 1943, le grand rabbin Maurice Eisenbeth est autorisé à faire savoir que le CFLN a décidé l’« abrogation de l’abrogation » du décret Crémieux, mais que la mesure sera réalisée prochainement selon les opportunités politiques. Le 20 octobre 1943, c’est en vertu d’un subterfuge monté par Cassin que la décision est actée en se passant de la signature de Giraud.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, de Gaulle et Cassin n’ont donc pas tardé à rétablir le décret Crémieux. C’est seulement en septembre 1943 que de Gaulle prend définitivement l’ascendant sur Giraud, et qu’il a les mains libres pour rétablir les lois de la République en Algérie.
Le 30 juin 1944, René Cassin reçoit un message du général de Gaulle, depuis Rome, où il vient de passer en revue les troupes de l’Armée d’Italie :
Mon cher Professeur Cassin
La principale force des hommes d’honneur est la constance dans l’affirmation de leur volonté et l’inébranlable foi de ceux qui les suivent dans leur croisade. Cher professeur, ces quelques mots que je vous adresse au soir de mon audience avec Sa Sainteté témoignent de ma grande espérance et d’un sentiment d’immense fierté dans le combat que nous avons entrepris voilà quatre années.
Recevez mon cher ami, mes très sincères et cordiales salutations.
C. de Gaulle
C’est dire l’affection qui liait le chef de la France Libre à la première personnalité civile qui l’avait rallié. Il fut un légiste d’action, alliant la légalité à la légitimité, dernier rempart contre la barbarie. Sans doute aurait-il aimé jouer un rôle politique plus important. Mais on ne se refait pas. René Cassin n’était pas fait pour les joutes politiques impitoyables qui traversent la France libre. Après l’affaire Muselier, De Gaulle l’avait sommé de « s’affermir », et d’assumer la part de rapport de force inhérente à la relation avec l’allié britannique. Dès le début de l’année 1942, un politique comme Pleven le supplante. Dans l’entendement du chef de la France Libre, ce n’était pas une disgrâce. Car il savait confusément ce que serait le destin de ce Valeureux, dont la famille avait été décimée par les nazis. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il lui demanda de le représenter, avec Maurice Dejean, à la réunion interalliée du 12 juin 1941, ainsi qu’à la signature de la Charte de l’Atlantique le 24 septembre 1941. De Gaulle avait senti le rôle qu’il pouvait jouer pour le rayonnement de la pensée française dans le monde. René Cassin n’aura jamais été élu député, jamais nommé Garde des Sceaux, comme il en rêvait sans doute. L’aurait-il été, jamais la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, jamais le prix Nobel de la paix, ne seraient pour toujours associés à sa haute figure.
Méditons, dans les saisons gâtées que nous traversons, cette phrase qu’il a tracé de toute son âme en 1974 : « Au-dessus des personnalités plane la grande image de la France, et avec elle celle de l’humanité, dont notre patrie est une des incarnations ».
ANNEXE I
Manifeste de Brazzaville du 27 Octobre 1940
La France traverse la plus terrible crise de son Histoire. Ses frontières, son Empire, son indépendance et jusqu’à son âme sont menacés de destruction.
Cédant à une panique inexcusable, des dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l’ennemi. Cependant, d’innombrables preuves montrent que le peuple et l’Empire n’acceptent pas l’horrible servitude. Des milliers de Français ou de sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu’à la libération. Des millions et des millions d’autres n’attendent, pour le faire, que de trouver des chefs dignes de ce nom.
Or, il n’existe plus de Gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n’est, en effet, qu’un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l’honneur et l’intérêt du pays.
Il faut donc qu’un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l’effort français dans la guerre. Les événements m’imposent ce devoir sacré, je n’y faillirai pas.
J’exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, et je prends l’engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu’il lui aura été possible d’en désigner librement.
Pour m’assister dans ma tâche, je constitue, à la date d’aujourd’hui, un Conseil de Défense de l’Empire. Ce Conseil, composé d’hommes qui exercent déjà leur autorité sur des terres françaises ou qui synthétisent les plus hautes valeurs intellectuelles et morales de la Nation, représente auprès de moi le pays et l’Empire qui se battent pour leur existence.
J’appelle à la guerre, c’est-à-dire au combat ou au sacrifice, tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises qui sont ralliées à moi. En union étroite avec nos Alliés, qui proclament leur volonté de contribuer à restaurer l’indépendance et la grandeur de la France, il s’agit de défendre contre l’ennemi ou contre ses auxiliaires la partie du patrimoine national que nous détenons, d’attaquer l’ennemi partout où cela sera possible, et de mettre en œuvre toutes nos ressources militaires, économiques, morales, de maintenir l’ordre public et de faire régner la justice.
Cette grande tâche, nous l’accomplirons pour la France, dans la conscience de la bien servir et dans la certitude de vaincre.
ANNEXE II
Déclaration Organique du 16 Novembre 1940
Au nom du Peuple et de l’Empire français
Vu la loi du 13 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ;
Vu les lois constitutionnelles des 25 février 1875, 16 juillet 1875, 2 août 1875 et 14 août 1884 ;
Vu l’état de guerre existant entre la France et l’Allemagne depuis le 3 septembre 1939 et entre la France et l’Italie depuis le 10 juin 1940 ;
Vu notre prise de pouvoir et la création d’un Conseil de défense de l’Empire français par ordonnances en date du 27 octobre 1940, dans les territoires libres de l’Empire français ;
Attendu que cette prise de pouvoir et cette création ont pour but et pour objet la libération de la France tout entière ; qu’il importe, en conséquence, de faire connaître à tous les Français, ainsi qu’aux puissances étrangères dans quelles conditions de fait et de droit nous avons pris et exerçons le pouvoir.
Nous, Général de Gaulle,
Chef des Français libres
Considérant que tout le territoire de la France métropolitaine est sous le contrôle direct ou indirect de l’ennemi ; qu’en conséquence, l’organisme dit « Gouvernement de Vichy » qui prétend remplacer le Gouvernement de la République, ne jouit pas de cette plénitude de liberté qui est indispensable à l’exercice intégral du pouvoir ;
Considérant que c’est vainement que cet organisme affecte de justifier sa création et son existence sous les apparences d’une révision des lois constitutionnelles, qui n’est en réalité que la violation flagrante et répétée de la Constitution française ;
Que, sans nier qu’une révision de la Constitution pourrait être utile en soi, le fait de l’avoir provoquée et réalisée dans un moment de désarroi et même de panique du Parlement et de l’opinion suffirait à lui seul à ôter à cette révision le caractère de liberté, de cohérence et de sérénité sans lequel un tel acte, essentiel pour l’État et pour la Nation, ne peut avoir de réelle valeur constitutionnelle ;
Que le Président de la République s’est vu dépouiller, sans avoir donné sa démission, des droits et prérogatives de ses fonctions ;
Qu’aux termes formels de la Constitution de 1875, un vœu de révision doit être voté par la Chambre et le Sénat, délibérant séparément, après quoi seulement les propositions de révision sont soumises à l’Assemblée nationale, laquelle ne peut au surplus se réunir qu’à Versailles ;
Que ces règles simples considérées par les principaux législateurs de la République, en particulier Gambetta et Jules Ferry, comme une garantie nécessaire du consentement éclairé des Chambres, permettant d’éviter les révisions hâtives ou perfides de la Constitution, n’ont été respectées qu’en apparence ou ont été violées ; Qu’en réalité, ni les deux Chambres, ni l’Assemblée nationale n’ont pu délibérer librement et que certains principes fondamentaux traités dédaigneusement de « questions de procédure » par les représentants du prétendu Gouvernement défenseur du projet, ont été manifestement méconnus ;
Qu’en particulier un certain nombre de membres de l’Assemblée ont été empêchés d’y participer, le navire où ils se trouvaient régulièrement, ayant été retenu au loin sur l’ordre du Gouvernement ou d’accord avec lui ; qu’au cours des débats publics, une pression a été exercée sur les membres présents par l’intervention de tiers sans qualité ; qu’en violation du règlement, aucun procès-verbal des débats n’a été publié ;
Que la soi-disant Assemblée nationale a été réunie à Vichy, alors qu’en fixant à Versailles le siège de l’Assemblée, le législateur avait manifesté qu’il n’envisageait pas qu’on pût jamais profiter de la détresse d’un Parlement, chassé et dispersé par des armées en marche, pour le convoquer, tout à coup, dans un chef-lieu de canton, afin de l’y contraindre, par intimidation à porter la main sur les lois fondamentales de la République ;
Considérant que, eût-elle été saisie régulièrement d’un projet de révision, l’Assemblée de Vichy avait pour devoir d’en délibérer, article par article, et d’en voter le texte définitif, lequel serait devenu, après promulgation, une des lois constitutionnelles du pays ; mais que loin de réaliser l’objet essentiel de sa fonction, la dite Assemblée, abdiquant une compétence qui lui appartenait à elle seule, s’est bornée à prendre la décision, aussi inconstitutionnelle qu’insensée, de confier à un tiers un véritable blanc-seing, à l’effet d’élaborer et d’appliquer lui-même une nouvelle constitution ;
Considérant que la loi de 1884, édicte que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision » ;
Que, néanmoins, malgré cette promesse solennelle faite à la nation, le pseudo-gouvernement de Vichy qui s’était intitulé lui-même « Gouvernement de la République » en vue d’obtenir les pleins pouvoirs, a prononcé l’abolition, aussi bien dans la forme que dans le fond, morceau par morceau, de la Constitution républicaine ;
Qu’il a banni de ses actes prétendus constitutionnels jusqu’au mot de « République », attribuant au Chef de ce qu’il appelle « État français » des pouvoirs aussi étendus que ceux d’un monarque absolu, pouvoirs qu’il ne tient qu’à lui d’exercer sa vie durant ou de transmettre à toute autre personne choisie par lui seul et même de rendre héréditaires ;
Qu’enfin, il n’a pas hésité à étouffer le droit de libre disposition du peuple, considéré en France comme traditionnel et sacré, en conférant au Chef de l’État la possibilité, sur sa seule signature, de conclure et ratifier tous les traités, même les traités de paix ou de cession de territoires portant atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à l’existence de la France, de ses colonies, et des pays sous son protectorat ou son mandat ;
Qu’à la vérité, le blanc-seing qui a été délivré à ce soi-disant gouvernement prévoit que la prétendue Constitution nouvelle sera « ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées », mais que cette disposition est à dessein sans portée, attendu que le prétendu Chef de l’État a tout loisir de régler, à sa guise, la composition des futures assemblées, ainsi que les modalités de sa ratification ;
Qu’il peut reculer cette ratification à une date aussi lointaine qu’il lui plaira et même indéfiniment ; Qu’à défaut d’un Parlement libre et fonctionnant régulièrement, la France aurait pu faire connaître sa volonté par la grande voix de ses Conseils généraux ; que les Conseils généraux auraient même pu, en vertu de la loi du 15 février 1872, et vu l’illégalité de l’organisme de Vichy, pourvoir à l’administration générale du pays, mais que le dit organisme, par soi-disant décret du 20 août 1940, leur a interdit de se réunir et que par la prétendue loi du 12 octobre 1940, il les a remplacés par des commissions nommées par le pouvoir central ;
Considérant, en résumé, que, malgré les attentats commis à Vichy, la Constitution demeure légalement en vigueur, que, dans ces conditions, tout Français, et, notamment, tout Français Libre, est dégagé de tout devoir envers le pseudo-gouvernement de Vichy, issu d’une parodie d’Assemblée nationale, faisant fi des Droits de l’Homme et du Citoyen, et du droit de libre disposition du peuple, gouvernement dont au surplus tous les actes établissent péremptoirement qu’il est dans la dépendance de l’ennemi ;
Considérant que la défense des territoires d’outre-mer, aussi bien que la libération de la Métropole, exigent que les forces de la France, éparses dans le monde, soient placées, sans délai, sous une autorité centrale provisoire ;
Qu’il tombe sous le sens que la création de cette autorité centrale provisoire ne peut être réalisés actuellement et pour raisons de force majeure, dans les conditions prévues par la lettre des lois ;
Que les auteurs de la Constitution ne pouvaient prévoir, en effet, qu’un jour viendrait où des Français devraient procéder à la formation d’un pouvoir en dehors de la France continentale ;
Qu’on ne peut davantage songer à fonder actuellement ce pouvoir sur le système électif, car la mise au point d’un tel système en pleine guerre, et le fait qu’il faudrait l’organiser sous toutes les latitudes, entraîneraient d’inextricables difficultés et, en tous cas, de longs retards ;
Qu’il doit suffire, à l’heure où nous sommes, que la volonté des Français Libres se soit exprimée sans contrainte et sans équivoque à ce sujet, sous la réserve formelle que l’autorité provisoirement constituée devra, comme toute autre autorité, répondre de ses actes devant les représentants de la Nation, dès que ceux-ci auront la possibilité d’exercer librement et normalement leur mandat.
En conséquence,
Nous, Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
le Conseil de Défense de l’Empire entendu :
Constatons que, de tous les points du globe, par démarches individuelles ou collectives, des millions de Français ou de sujets Français et des territoires français Nous ont appelé à la charge de les diriger dans la guerre ;
Déclarons que la voix de ces Français, les seuls que l’ennemi ou l’organisme de Vichy, qui dépend de lui, n’avaient pu réduire au silence, était la voix même de la Patrie et que Nous avions, en conséquence, le devoir sacré d’assumer la charge qui Nous était imposée ; Déclarons que Nous accomplirons cette mission dans le respect des institutions de la France et que Nous rendrons compte de tous nos actes aux représentants de la Nation française dès que celle-ci aura la possibilité d’en désigner librement et normalement.
Ordonnons que la présente déclaration organique sera promulguée ou publiée partout où besoin sera.
Brazzaville, le 16 novembre 1940
C. de Gaulle
ANNEXE III
Lettre du Général de Gaulle à René Cassin
À René Cassin, à Alger
Alger, 22 décembre 1943
Monsieur le Président,
Aux termes de l’ordonnance du 6 août 1943, le Comité juridique étudie, à l’invitation du Comité de la Libération Nationale ou des Commissaires intéressés, la révision des textes législatifs ou réglementaires appliqués dans les divers territoires relevant de l’autorité du Comité en vue d’assurer l’uniformité de la législation et sa conformité avec les principes en vigueur le 16 juin 1940.
Je viens d’inviter Messieurs les membres du Comité à faire procéder dans les plus brefs délais à l’examen critique de tous les textes promulgués à Vichy depuis le 10 juillet 1940 et je leur ai indiqué que, pour faciliter leur travail, je vous demandais de faire entreprendre par le comité juridique le dépouillement systématique du « Journal Officiel » de Vichy.
Je pense que le plan de travail qui permettrait d’assurer à ce dépouillement un maximum d’efficacité dans le minimum de temps serait le suivant :
Le Comité juridique se mettra en rapport avec les différents Commissariats qui désigneront auprès de lui un représentant à cet effet ; puis, en s’inspirant des études générales déjà faites sur la législation de Vichy, « dressera pour chaque Commissariat le cadre dans lequel il propose » que soient répartis, par familles, tous les textes qui peuvent être traités en bloc parce qu’ils concernent la même matière ou des matières apparentées entre elles.
Lorsque les Commissaires intéressés auront donné leur accord sur le principe de ces classifications, le Comité juridique leur proposera d’appliquer à chacune de ces familles de textes l’un des trois régimes suivants :
– droit commun de la nullité avec effacement des effets dans le passé,
– validation en bloc,
– abrogation globale simple avec validation des effets dans le passé.
Après avoir apporté, s’il y a lieu, aux travaux du Comité juridique les modifications qu’ils jugeraient nécessaires, les Commissaires soumettront leurs propositions au Comité de la Libération qui définira les principes de la politique à suivre pour chaque famille de textes.
Sur la base des directives ainsi fixées, le Comité juridique entreprendra alors le dépouillement détaillé de toute la législation de Vichy et fera parvenir, aux Commissariats intéressés, au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux, les textes qui lui paraissent devoir être classés par familles et rentrer dans l’une des catégories ci-dessus ainsi que les textes qui ne peuvent être classés par familles et doivent faire l’objet d’un examen individuel.
Pendant tout le temps où s’effectueront ces travaux, le Comité juridique restera en liaison constante avec les Commissariats intéressés et leur soumettra toutes les suggestions que vous jugeriez utiles.
Lorsque ce dépouillement sera terminé et lorsque le Comité de la Libération se sera prononcé, à la demande des Commissaires intéressés, sur toutes les questions qui peuvent comporter de longs débats, MM. les Commissaires établiront, en liaison avec le Comité juridique, des projets d’ordonnances ou sera précisé, pour chaque département déterminé, le sort qui sera réservé, lors de la Libération, à tous les textes actuellement en vigueur en France métropolitaine.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Charles de Gaulle
ANNEXE IV
Ordonnance du 9 Août 1944
Exposé des motifs
La libération du territoire continental doit être d’une manière immédiate accompagnée du rétablissement de la légalité républicaine en vigueur avant l’instauration du régime imposé à la faveur de la présence de l’ennemi.
Le premier acte de ce rétablissement est la constatation que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister ».
C’est l’objet de l’article premier du projet ci-annexé.
Cette constatation primordiale exprimée, il s’ensuit une autre nécessaire : les lois et règlements que l’autorité de fait qui s’est imposée à la France a promulgués, les dispositions administratives individuelles qu’elle a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de sa volonté aucune force obligatoire et sont appelées à demeurer inefficaces. Cette conséquence logique du principe exprimé ci-dessus doit l’être à son tour.
C’est l’objet de l’article 2, alinéa premier, qui fixe le point de départ dans le temps des textes et actes nuls.
Tout ce qui est postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940 du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité.
Cependant, des considérations d’intérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans transition aux règles de droit en vigueur à la date susdite du 16 juin 1940 et à observer dans ce but soit une période transitoire comportant le maintien provisoire de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations acquises dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que leur confirmation.
Aussi bien des textes législatifs ou réglementaires sont intervenus qui n’eussent pas été désavoués par le régime républicain et des actes administratifs individuels ont été pris qui n’ont été inspirés que par l’intérêt bien compris de la bonne marche des services. Annuler ces textes et actes administratifs pour y substituer dans chaque cas des textes et actes administratifs nouveaux nécessairement identiques conduirait, en multipliant l’effort nécessaire pour assurer la reprise de la vie publique, à apporter dans celle-ci une confusion extrême et de longue durée.
D’où la nécessité de décider que la nullité doit être expressément constatée. C’est l’objet de l’article 2, alinéa 2.
Le principe ainsi énoncé emporte cette conséquence nécessaire que tant qu’une nullité n’a pas été expressément constatée, les actes de l’autorité de fait quels qu’ils soient continuent à recevoir provisoirement application.
Mais le projet exprime la volonté du gouvernement de mener à bonne fin dans le plus court délai possible la révision générale de ces actes, qui entraînera d’une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seront annulés et la validation de ceux qui seront maintenus.
L’article 7 exprime cette conséquence et cette volonté décisive.
Tous ces principes posés, le projet d’ordonnance édicte la nullité expresse d’un certain nombre de textes qui, à raison de leur caractère et de leur origine manifeste, doivent être avant tous autres exclus de toute validation, nullité qui atteint évidemment leurs effets dans le passé.
Ce sont ceux énumérés à l’article 3.
Il énumère ensuite, par référence à des tableaux annexes, tous ceux inconciliables avec les principes rétablis, et dont dès maintenant la validation définitive doit être également écartée, mais qu’il a paru opportun d’énumérer individuellement, et en les distinguant alors avec soin suivant que leurs effets passés sont effacés ou, au contraire, à raison des nécessités sociales reconnus (article 4 et tableaux I et II).
En ayant ainsi – provisoirement – terminé avec la législation de l’autorité de fait, le projet soumis au gouvernement introduit sans délai un certain nombre de textes déjà pris par celui-ci dont l’introduction immédiate est indispensable.
Toujours dans les vues susdéfinies, il indique que les autres textes déjà intervenus – ce qui comprend évidemment sans distinction, comme il le précise, les textes de la France libre, ceux de la France combattante, ceux du commandement en chef français civil et militaire depuis le 14 mars 1943 et ceux enfin du Comité français de la Libération nationale – ne seront applicables, sous réserve d’ailleurs des droits acquis sous leur empire, qu’à partir de la date qui devra être expressément fixée pour chacun d’eux (articles 5 et 6).
L’ordonnance en projet traite ensuite des décisions des juridictions d’exception (dont elle a annulé les textes constitutifs) et des actes administratifs individuels.
Elle valide rétroactivement les premières à l’exception de celles qui relèvent de l’ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, lesquelles demeurent soumises à cette ordonnance, et maintient provisoirement les seconds (articles 8 et 9).
Le texte enfin déclare dissous, outre la légion française des combattants, les groupements antinationaux qu’il énumère. Il ordonne le séquestre de leurs biens et interdit, sous les sanctions pénales qu’il édicte, leur reconstitution. Tous ces groupements étaient liés trop étroitement à l’autorité de fait pour que le texte rétablissant la légalité républicaine n’édicte pas lui-même leur suppression.
Telle est l’ordonnance portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, c’est-à-dire en France métropolitaine, exception faite de la Corse, où la situation législative, résultant d’une libération antérieure aux dispositions ainsi prises, appelle un texte particulier qui interviendra incessamment.
Elle a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d’inspiration ennemie qui l’étouffait, mais aussi de lui éviter le désordre juridique ou même l’incertitude.
Sans doute elle appelle d’autres textes, mais sur le plan législatif elle est un acte de libération déjà décisif.
Ordonnance
Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du commissaire à la justice ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble
l’ordonnance du 3 juin 1944 ;
Vu l’avis exprimé par l’Assemblée consultative à sa séance du 20 juin 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :
Article premier.
La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister.
Article 2.
Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.
Cette nullité doit être expressément constatée.
Article 3.
Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
l’acte dit « loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 »,
tous les actes dits : « actes constitutionnels »,
tous les actes qui ont institué des juridictions d’exception,
tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l’ennemi,
tous les actes relatifs aux associations dites secrètes, tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif. l’acte dit « décret du 16 juillet 1940 » relatif à la formule exécutoire. Toutefois les porteurs de grosses et expéditions d’actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l’acte dit « décret du 16 juillet 1940 » pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.
Article 4.
Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance. Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 5.
Sont déclarés immédiatement exécutoires sur le territoire continental de la France, les textes visés au tableau III de la présente ordonnance.
Article 6.
Les textes publiés au Journal officiel de la France libre, au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du commandement en chef français civil et militaire depuis le 18 mars 1943, enfin au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le territoire continental de la France qu’à partir de la date qui sera expressément fixée pour chacun d’eux.
Toutefois, doivent être dès maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l’empire des dits textes.
Article 7.
Les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français » dont la nullité n’est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application.
Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l’article 2.
Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.
Article 8.
Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d’exception visées à l’article 3 lorsqu’elles ne relèvent pas de l’ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Article 9.
Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.
Article 10.
Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes :
– la légion française des combattants.
– Les groupements anti-nationaux dits :
– le service d’ordre légionnaire,
– la milice,
– le groupe collaboration,
– la phalange africaine,
– la milice antibolchevique,
– la légion tricolore,
– le parti franciste,
– le rassemblement national populaire,
– le comité ouvrier de secours immédiats,
– le mouvement social révolutionnaire,
– le parti populaire français,
– les jeunesses de France et d’outre-mer.
Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l’administration de l’enregistrement et à la diligence de celle-ci.
Sans préjudice de l’application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 100 000 francs quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.
Article 11.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au territoire continental au fur et à mesure de sa libération.
Une ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
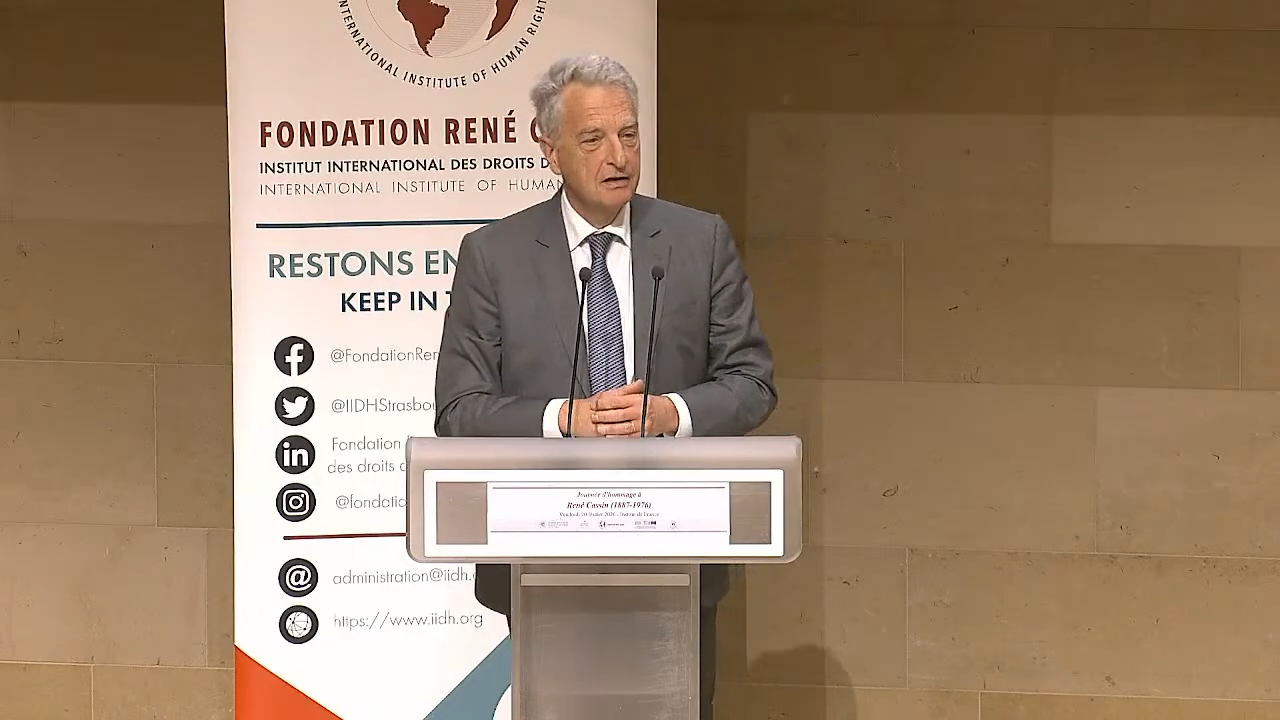

HOMMAGE A RENE CASSIN (1887-1976)
Institut de France, 20 février 2026
LA FRANCE LIBRE ET LES FONDATIONS DE LA PAIX
par Emmanuel Decaux,
professeur émérite de l’Université Paris Panthéon-Assas
président de la Fondation René Cassin
Parler des fondations de la paix, au milieu des combats de la France libre, c’est souligner la continuité et la cohérence de l’engagement de René Cassin, lui qui remarquait chez le général de Gaulle deux ordres de qualité, les « qualités d’action » et les « qualités de prévision ». C’est s’inscrire dans le temps long, là où le nouveau désordre international obéit aux injonctions de l’actualité, sans conscience du poids de l’histoire ni stratégie d’ensemble.
Dès le tournant des années trente, René Cassin avait perdu ses illusions sur la SDN. Lors de l’hommage national rendu à Aristide Briand, le 13 juin 1937 – à l’occasion de l’inauguration du monument devant le Quai d’Orsay, en présence de Léon Blum alors président du conseil et de Joseph Paul-Boncour, président de l’association française pour la SDN – Cassin rappelait que « l’apôtre de la paix avait misé sur la réalité et la puissance des forces morales, sans pour cela abandonner la terre ferme ». Briand « considérait une solide défense nationale et des progrès sociaux parallèles comme indispensables à l’organisation d’une paix effective entre les Nations, en attendant qu’elles puissent accorder leurs institutions économiques et juridiques, limiter leurs armements, se subordonner au conciliateur, au juge et, en cas de nécessité, au bras séculier de la communauté ». Et Cassin concluait « Nous voulons, malgré tous les obstacles, continuer (son) action afin que (…) face à l’anarchie des souverainetés et à la guerre, [notre patrie] mette toute sa force au service de la raison, de l’intérêt solidaire et de la paix organisée sur le Droit ». A la suite de Léon Bourgeois, le fondateur du solidarisme, et à l’image d’Aristide Briand, René Cassin conjuguait ainsi solidarité interne et solidarité internationale, tout en ne concevant la force qu’au service d’une paix fondée dans sur le Droit ! Dans le texte du discours, le mot « Droit » est écrit avec une majuscule.[1]
Face à la montée du nazisme René Cassin n’a cessé de dénoncer les menaces de « l’Etat-Leviathan contre l’homme et la communauté humaine », esquissant déjà dans une étude parue en avril 1940 dans les Nouveaux Cahiers, l’idée d’une « déclaration universelle des droits de la personne humaine », tout comme la nécessité d’organiser « la force coercitive collective contre tout Etat agresseur ou rebelle ». Pour lui, il faut à la base restituer aux individus, « avec le sens de leur dignité, celui des responsabilités contrepartie de leurs libertés », tout en assurant au sommet des « disciplines communes à tous les groupements humains, régionaux ou d’ordre universel » avec des « moyens préventifs tirés des forces morales autant que des solidarités matérielles ». Il voit dans la guerre en cours l’affrontement « de deux conceptions du monde, l’une totalitaire et l’autre basée sur la libre confrontation des droits et des intérêts, sur le juste équilibre à établir entre l’individu et les exigences de la vie en société, sur une terre rapetissée par la science, plus féconde et plus peuplée », redoutant que « les nécessités de la lutte (ne) fassent perdre de vue l’enjeu suprême de celle-ci », en sacrifiant les libertés.[2]
On retrouve le fruit de ces réflexions sur les causes de l’échec de la SDN et les « conditions de la paix » dans son engagement au service de la France libre qui vient d’être rappelé magnifiquement par Hervé Gaymard. La contribution de René Cassin à la préparation de l’ordre international de l’après-guerre se manifeste par une pleine implication, faite de diplomatie, de clairvoyance et de ténacité, dans une série d’initiatives décisives.
I – LES BUTS DE GUERRE : la participation aux conférences de Saint-James.
C’est d’emblée, dès 1941, la participation de René Cassin aux conférences interalliées de Saint-James qui permettent à la France libre de rappeler sa place au milieu des démocraties en guerre. En tant que représentant du « chef des Français libres » – selon la formule retenue par les Britanniques – René Cassin participe aux premières conférences interalliées de Saint-James, alors qu’il est en tant que secrétaire permanent du Conseil de défense de l’Empire, un des plus proches collaborateurs du général de Gaulle. L’exercice est délicat pour ces Hommes partis de rien, car il faut faire reconnaitre la France libre sur un pied d’égalité au milieu des dominions du Commowealth et des gouvernements alliés en exil, mais également défendre la souveraineté nationale, sans s’engager sur des questions de fond, faute de pouvoir s’appuyer sur une consultation du peuple français.
Lors de la première réunion du 12 juin 1941, René Cassin affirme au nom du général de Gaulle que la France « ne conçoit pas la paix sans la liberté », avant de souscrire à la résolution commune visant « la solidarité des peuples libres, tant en guerre qu’en temps de paix ». L’action de la France libre s’inscrit ainsi dans la croisade des démocraties. On conserve une image forte de cette réunion historique avec la photographie de René Cassin, accompagné par Maurice Dejean auprès du roi George VI et du général Sikorski, au milieu des représentants de tous les gouvernements alliés de Hubert Pierlot à Jan Masaryk. Pour Winston Churchill, mis en valeur par la photo, « it was the most artistic grouping he had ever seen, better than any of the groups painted by Sargent on similar occasions and yet quite haphazard ». [3]
La situation est plus complexe lors de la deuxième réunion qui a lieu le 24 septembre 1941, au lendemain de l’adoption de la « Charte de l’Atlantique » par Churchill et Roosevelt. Alertés par le précédent des « 14 points de Wilson », les négociateurs français – de Gaulle le premier – ont de fortes réticences sur des questions de fond. Comment renoncer par principe à « des agrandissements d’aucune sorte », comme le prévoit la Charte, alors que la question du Rhin reste cruciale pour la sécurité de la France ? Comment accepter « l’accession aux matières premières sur pied d’égalité de l’Allemagne et de l’Italie avec les pays dépouillés par elles », alors pas la moindre mention n’est faite de la question des réparations cruciale pour la France saignée à blanc ?
Invoquant « les droits des représentants du peuple français de faire valoir, après sa libération, leur point de vue sur la nécessité d’éviter toute prime à l’agression », René Cassin évite une opposition frontale tout en préservant l’avenir. Très habilement, Cassin fait une proposition audacieuse sur le fond en déclarant que « Les Français considèrent comme nécessaire à l’établissement d’une paix véritable la consécration pratique des libertés essentielles de l’homme et l’utilisation concertée, en vue de la sécurité économique et sociale des peuples, des progrès techniques créateurs de richesses nouvelles ». Dans ses souvenirs parus en 1974, René Cassin souligne que « ce passage devait favoriser singulièrement l’élan des futures Nations Unies en faveur des droits de l’homme et de la coopération internationale. Il s’est révélé très important car il a été la base de mon action depuis trente-cinq ans ». [4] On retrouve dans un effet de miroir, le comput mis en lumière par Pascal Ory, comme si tout convergeait autour de son engagement à Londres.
Une troisième réunion interalliée fut organisée le 13 janvier 1942 à l’initiative du représentant de la Pologne, le général Sikorski, au sujet des « criminels de guerre ». De Gaulle y participe lui-même – quelques semaines après de l’exécution des 50 otages de Nantes – pour dénoncer la barbarie allemande, tandis que Cassin est en tournée d’inspection et de propagande au Levant. Mais le juriste s’est investi pleinement dans la préparation de la réunion. La déclaration commune, après avoir rappelé le « droit des gens », notamment la convention de La Haye de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, inscrit « parmi les buts principaux de guerre, le châtiment, par les voies d’une justice organisée, des coupables ou responsables des crimes de guerre, qu’ils les aient ordonnés, perpétrés ou qu’ils y aient participé ». [5]
A la suite de la création du Comité national de la France libre intervenue le 24 septembre 1941, René Cassin se trouve cantonné dans les fonctions de commissaire national à la justice et à l’instruction publique jusqu’en août 1943 date de la mise en place du « comité juridique » de la France combattante, avec tout un travail technique souvent ingrat. C’est donc dans le cadre de missions ponctuelles, que « le professeur Cassin » va continuer à traiter certains dossiers liés à la préparation de l’après-guerre.
II – DES CHANTIERS JURIDIQUES : La genèse de la justice pénale internationale.
Faute de pouvoir faire l’inventaire systématique des initiatives de René Cassin concernant l’organisation internationale de la paix, en maintenant des liens formels avec la SDN et l’OIT, il faut souligner son implication dans deux chantiers essentiels, avec un engagement personnel qui perdurera après la Libération.
C’est notamment le cas des travaux de la conférence des ministres de l’éducation qui déboucheront sur la création de l’UNESCO, comme nous le rappellera Mme Azoulay. Même quand il quitte le portefeuille de l’instruction publique – qui revient à un autre professeur de droit, René Capitant – Cassin continue à veiller sur la question, allant jusqu’à alerter le commissaire aux affaires étrangères, René Massigli, le 12 mai 1944 devant l’Assemblée consultative d’Alger, en présence du général de Gaulle : « Récemment le gouvernement américain a déposé à la Conférence de Londres un projet très important d’organisation des Nations Unies en matière d’éducation et de culture. Il serait scandaleux que la France qui a été à la source de l’activité de l’Institut international de coopération intellectuelle, ne puisse pas présenter un visage unique lorsqu’il ‘agit de négocier sur une organisation aussi importante, avec d’autre pays. Pour éviter tout risque, il faut prendre le problème de haut. Il faut qu’on mette les personnes les plus qualifiées à la tête d’un grand service de l’Etat concernant le rayonnement de la science, de la culture et de la langue française à l’étranger (…)».[6] René Cassin se chargera avec brio de cette mission, aidé par la présence à Londres du professeur Vaucher.[7]
Nous nous en tiendrons, ici, à la mise en oeuvre de la Déclaration sur les crimes de guerre, adoptée par la conférence de Saint-James. La position de principe de René Cassin est précisée dès une note du 26 septembre 1942. Il voit dans la « guerre totale » déclenchée par les puissances de l’Axe, une « criminalité totalitaire. Les crimes ainsi commis sur une échelle effrayante suscitent l’horreur et appellent un châtiment ayant à la fois un caractère de rétribution et un but exemplaire de prévention pour l’avenir ». [8]
A partir d’octobre 1943, Cassin, assisté par André Gros, représente la France au sein de la commission d’enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre. Cassin écarte l’argument relatif à la non-rétroactivité des lois pénales, pour tirer toutes les conséquences des « actes contraires à l’humanité commis par l’ennemi », en visant une responsabilité collective du Reich. Contrairement aux Anglo-saxons longtemps soucieux de s’en tenir à des crimes de guerre « occasionnels et individuels », il s’agissait pour René Cassin de poursuivre des « crimes de lèse-humanité » à l’égard de peuples martyrs.
René Cassin ne s’exprime pas seulement de manière théorique, il documente l’accusation. Ainsi prenant la parole le 12 mai 1944 devant l’Assemblée consultative d’Alger, il dénonce « la géo-politique, cette doctrine au service de la domination dans l’espace et le temps » héritée du pangermanisme dont Hitler a été « le plus affreux des symptômes », et démontre – citations de chefs du grand état-major allemand à l’appui – l’existence d’un plan systématique d’anéantissement des populations civiles dans les dernières phases de la guerre. Il cite notamment une note confidentielle du maréchal von Manstein pour qui : « ce pillage, conjugué avec la destruction des usines et des machines, avec la terreur, la déportation et la famine scientifique imposée aux enfants et aux civils, pourra nous assurer une revanche prochaine ».[9] Dans le même discours du 12 mai 1944, à la veille du Débarquement en Normandie, Cassin évoque la possibilité de représailles, de « terribles menaces » contre l’Allemagne, pour « sauver les populations civiles des pays occupés et opprimés » et « arrêter certains procédés de guerre atroce ».
René Cassin continuera à suivre les travaux menés par André Gros dans le cadre de la Commission d’enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre, jusqu’à la conclusion de l’Accord de Londres du 8 août 1945 qui crée le « Tribunal militaire international ». Dans une note en date du 14 septembre 1945, François de Menthon qui en tant que procureur général est «délégué du gouvernement français au Tribunal militaire international », souligne l’urgence de la désignation d’un juge afin de renforcer la présence de la France, alors que des questions sur « l’objet même du procès collectif » restent en discussion. Pour les Etats-Unis il s’agirait pour l’essentiel de faire « le procès de la conspiration américain pour une guerre d’agression et pour l’hégémonie mondiale », sans prendre en compte « la criminalité de guerre proprement dite ». Pour la France au contraire, « les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité prendraient également leur place, le tout découlant de la doctrine elle-même criminelle du national-socialisme », François de Menthon, « estime, étant donné les qualité diverses requises et la notoriété indispensable, que trois personnalités seraient seules capables, en France, de tenir ce poste important », en énumérant par ordre de préférence, trois grands juristes engagés dans la Résistance, « le professeur Jules Basdevant, le doyen Julliot de la Morandière et le professeur René Cassin ». [10] Tous trois chargés de responsabilités importantes se récuseront, laissant la place à un pénaliste Henri Donnedieu de Vabres, avec comme juge adjoint Robert Falco. [11]
A la suite du jugement de Nuremberg, Cassin prend la plume en octobre 1946, pour souligner l’objectif essentiel qui a été atteint en substituant la justice à la vengeance et pour affirmer « l’existence, au-dessus des Etats, d’un droit universel qui a sa source dans les exigences fondamentales de la conscience humaine ». Pour autant, rappelant sa fonction de vice-président de la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, il n’hésite pas à déplorer « la circonspection avec laquelle le tribunal de Nuremberg, pour qui le crime essentiel a été le déclenchement de la guerre d’agression et le complot mené à cette fin, a traité des crimes commis contre l’humanité sans lien direct avec la guerre. Ici, encore, la souveraineté jadis absolue des Etats doit plier devant des règles supérieures », au nom de « la communauté humaine tout entière ». A ses yeux, ce « premier arrêt de la première Cour pénale internationale » n’en est pas moins « l’expression première d’un droit international nouveau, appelé à se perfectionner » [12] Le président Bruno Cotte ne me démentira pas…
On ne peut qu’être frappé par le parallélisme entre l’adoption de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 9 décembre 1948, et le vote de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le 10 décembre, au Palais de Chaillot. Pour Cassin fort de l’expérience tragique de la guerre, ce sont les deux faces d’une même médaille, la responsabilité de protéger les peuples des crimes de masse allant de pair avec la promotion des garanties effectives des droits de l’homme.
III – LES ASSISES DE LA PAIX : le fil conducteur des droits de l’homme.
Dès ses premiers discours à la BBC, Cassin n’avait cessé de d’évoquer « la France des droits de l’homme » (Message à la jeunesse studieuse, 30 septembre 1940). Pour lui le Conseil de défense de l’Empire, par son existence comme par sa composition « constitue la négation des doctrines racistes que la France de 1789 et des droits de l’homme repousse avec horreur » (13 novembre 1940). Dans son Message aux Israélites de France du 12 avril 1941, il rappelle devant les discriminations raciales du régime de Vichy que « l’œuvre de l’abbé Grégoire, la Déclaration des droits de l’homme sont foulées aux pieds ».
Aux yeux de Cassin, cet enracinement historique doit être tourné vers l’avenir, ce message universel s’adressant à tous les hommes, partout dans le monde. Cassin ne se contente pas de rappels, parfois à contre-courant, il prend des initiatives qui porteront leurs fruits, C’est dans le cadre interne, que l’on peut observer la maturation progressive de l’idée même d’une nouvelle Déclaration des droits. A cet égard le fonds Cassin-Gros des archives diplomatiques contient deux documents de référence mis en lumière par le professeur Georges-Henri Soutou en 1998.
La « Commission d’étude des problèmes d’après-guerre » mise en place par la France combattante comportait une section sur la réforme de l’Etat dotée elle-même d’une sous-section sur les droits de l’homme. A la demande de René Cassin, commissaire national à la justice, et d’André Philip, qui était alors commissaire national à l’Intérieur, un groupe de travail présidé par Paul Vaucher a présenté le 14 août 1943 un projet de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. [13]La préface du rapport rappelle que « dès le début de cette guerre un groupe de Français, convaincu que la victoire des puissances totalitaires ruinerait les libertés fondamentales péniblement conquises par les hommes, proclama qu’au contraire leur défaite impliquerait, non seulement la réaffirmation des principes de 1789, mais une Déclaration internationale des droits de l’homme ». Et de relever les premières initiatives franco-britanniques de Cassin dès 1940, d‘abord au nom de l’Association française pour la SDN, puis au sein de la London International Assembly, pour qu’une « nouvelle Charte universelle dégageât le sens de la lutte des Nations alliées pour le triomphe des libertés humaines ». S’inscrivant dans cette perspective, les auteurs du projet ont « pensé que les Français se devaient de donner l’exemple en proposant un texte qui, rédigé pour leurs compatriotes, pourrait être ensuite discuté, amendé et proclamé par les alliés ».
La lecture du projet de Déclaration est d’autant plus intéressante que « respectueux des textes historiques », il entend introduire de nouvelles garanties, comme l’habeas corpus, et définir de nouveaux droits, à commencer par la sécurité sociale, comme vient de le rappeler Nicole Questiaux. C’est un texte très dense, évoquant aussi bien les droits que les devoirs, pour « aider les citoyens à prendre conscience des droits qu’ils possèdent, qu’ils ont à défendre et respecter chez autrui ». On retrouve l’inspiration qui animera les travaux de l’Assemblée constituante jusqu’à l’élaboration du Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946, mais aussi des éléments clef de la Déclaration du 10 décembre 1948. D’emblée l’ouverture internationale est affirmée sans exclusive : « D’autres initiatives vont répondre à la nôtre. D’autres projets vont paraître qui pourront être comparés à celui de notre Déclaration. Mais peut-être n’est-il pas mauvais que des voix françaises annoncent une nouvelle journée à l’aube de la délivrance ».
On connait la suite, avec la nomination de René Cassin dans la « commission nucléaire » mise en place par l’ECOSOC en février 1946, puis – non sans mal – comme représentant de la France au sein de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies qui devait tenir sa première session en janvier 1947. Au lendemain de cette session, un arrêté ministériel signé le 17 mars 1947 a créé une « commission consultative en vue de préparer les travaux des commissions des Nations Unies chargées de la codification du droit international et de la définition des droits et devoirs des Etats et des droits de l’homme», c’est l’ancêtre lointain de la CNCDH dont il faut saluer la présence de cinq présidents parmi nous aujourd’hui. Cette première « commission consultative » composée d’une douzaine de juristes et de diplomates, rattachée auprès du service des conférences du Quai d’Orsay est placée sous la présidence de René Cassin qui avait été à l’origine de l’initiative. [14]
C’est dans ce cadre restreint qu’a été préparé un « projet français de déclaration internationale des droits de l’homme » présenté à Lake Success où se tient la première session du comité de rédaction en juin 1947 et publié par la Documentation française le 12 août 1947, sera le fruit des travaux de Suzanne Bastid et de Charles Chaumont. [15] Comme on le voit, Cassin n’arrivait pas les mains vides à New York. C’est ce travail préparatoire intensif, comme la rigueur juridique et le sens diplomatique de René Cassin, qui lui permirent de jouer un rôle clef au sein de la Commission des droits de l’homme, faisant le pont entre les aspirations philosophiques et les préoccupations juridiques, les traditions libérales et les revendications sociales, les affirmations de principe et les garanties effectives, la consécration solennelle de « l’universalité » des droits et la nécessité d’un programme concret de mise en œuvre…
Ce n’est pas le lieu de revenir sur l’ensemble des travaux préparatoires au sein de la Commission des droits de l’homme puis de l’Assemblée générale des Nations Unies réunie à Paris, à l’automne 1948.[16] Mais il faut souligner que la Déclaration universelle des droits de l’homme n’était qu’un point de départ pour ses auteurs. René Cassin s’impatientera souvent des obstacles, liés à la guerre froide mais aussi à la décolonisation, retardant la réalisation du « programme de travail » de la Commission des droits de l’homme, même si sa présidence à en 1955-1956 permis de progresser vers l’adoption des deux Pactes internationaux, l’un relatifs aux droits civils et politiques, l’autre aux droits économiques, sociaux et culturels.[17] Il fera régulièrement des bilans d’étape, traçant des perspectives fécondes, dès son cours de la Haye de 1951.[18] Ce sera également le cas en 1958, devant l’Académie des sciences morales et politiques, comme en 1968, alors qu’il jouait encore un rôle moteur dans la Conférence internationale sur les droits de l’homme de Téhéran, à la veille de recevoir le Prix Nobel de la Paix le 10 décembre 1968 à Oslo.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme n’est pas un temple abandonné, « le linceul de pourpre où dorment les dieux morts », c’est un arbre vivant, un arbre aux racines historiques profondes, avec un tronc solide et des ramifications juridiques foisonnantes. C’est un droit vivant, ne s’adressant pas seulement aux Etats-membres, ni même à l’Organisation des Nations Unies en tant que telle, mais à « tous les peuples et toutes les nations », ainsi que « tous les individus et tous les organes de la société », avec une portée objective. [19] C’est aussi un enjeu diplomatique, qui donne lieu à des controverses idéologiques, au nom de l’absolutisme politique ou du relativisme culturel, mais qui connait aussi des avancées qui se développent dans le temps long, comme en témoignent les initiatives menées à bien par la France depuis près de cinquante ans pour lutter contre les disparitions forcées, en affirmant le droit à la justice et le « droit à la vérité », au carrefour des droits de l’homme et du droit international pénal. C’est aussi, on l’oublie trop souvent, un droit positif qui innerve nombre de droits nationaux, en étant incorporé dans les Constitutions et interprété par les jurisprudences internes. [20]
Le combat de René Cassin s’inscrit ainsi pleinement dans la « restauration du droit international » sur la base de la reconnaissance de la dignité humaine, affirmée dans la Charte de 1945 et réaffirmée dans la Déclaration de 1948. C’est aussi le combat de toute une génération, associant les vivants et les morts, comme le rappellent les premiers mots de la Charte des Nations Unies :
« Nous peuples des Nations Unies, résolus
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droit des hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes et petites »…
A travers ces années tragiques, avec lucidité et audace, René Cassin reste fidèle au passé pour mieux enraciner l’avenir, pour reconstruire le droit et défendre la justice. A chacun de nous de préserver cet héritage, face aux nouveaux défis à affronter, en sachant comme lui « regarder droit l’avenir ». [21]
[1] Les Grands discours de René Cassin, Dalloz, coll. A Savoir, 2026.
[2] René Cassin, La pensée et l’action, éditions F. Lalou, 1972, pp. 63 et sq.
[3] John Colville, The Fringes of Power (10 Downing Street Diaries 1939-1955), Norton & Cy, 1985, p.399.
[4] René Cassin, Les hommes partis de rien, Plon (1ere éd. 1974), 3ème ed, 2025. Avec les documents en annexe. La légende de la photo souvent reproduite de René Cassin arrivant à la conférence du 24 septembre 1941 ne mentionne jamais la présence à ses côtés de ses deux conseillers, Hervé Alphand et André Gros.
[5] Paradoxalement, l’entrée en guerre des Etats-Unis, à la suite de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 marginalise la France libre qui n’a pas été invitée à signe à Washington la « Déclaration des nations Unies » le 1er janvier 1942. L’hostilité américaine perdurera jusqu’à la conférence de San Francisco. Cf. Etienne Philippe, « Revenir vainqueur dans le concert des nations. La quête de la France libérée pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies », in AFRI 2025, pp.823 et sq.
[6] JORF, Débats de l’Assemblée consultative provisoire, 1er juin 1944, p.25.
[7] Paul Vaucher, un agrégé d’histoire qui était professeur à la London School of Economics, a rallié la France libre pour devenir « conseiller culturel » à Londres de 1942 à 1945. Cf. de Claude Nordmann, « En souvenir de Paul Vaucher (1887-1966) » Revue du Nord, 1967, pp.244-247.
[8] Gérard Israël, René Cassin (1887-1976), La guerre hors la loi, Avec de Gaulle, Les droits de l’homme, Bruylant, 2007, pp.166 et sq.
[9] JORF, op.cit.
[10] Documents diplomatiques français, 1945, tome II, Imprimerie National, 2000, n° 183, p.472.
[11] Sur les prises de positions du juge Donnedieu de Vabres, cf. Stéphanie Boissard et al, Nuremberg, l’Album du procès, Tallandier, 2026.
[12] Le Monde juif, 1946/3, en reprenant un article publié dans le quotidien France, Londres.
[13] Georges-Henri Soutou, La France et la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, Les éditions du diplomate, 2008. Le rapport est reproduit pp. 87-91.
[14] Eric Pateyron, La contribution française à la rédaction de la Déclaration universelle de droits de l’homme, René Cassin et la commission consultative des droits de l’homme, La Documentation française, 1998.
[15] La Documentation française, Notes et études documentaires, série textes et documents, n°691, 12 août 1947. Le projet figure dans les annexes de l’étude de M. Pateyron, pp.191-197, qui analyse en détail sa genèse au sein de la Commission consultative française.
[16] William Schabas, The ‘travaux préparatoires’ of the Universal Declaration of Human Rights, Cambridge University Press, 3 vol., 2013.
[17] Marc Bossuyt, Guide to the ‘travaux préparatoires’ of the International Covenant on Civil and political Rights, Martinus Nihoff, 1987.
[18] René Cassin, « La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », RCADI 1951, vol.79.
[19] Pour un bilan récent, Marina Eudes (sous la dir.), La Déclaration universelle des droits de l’homme, un « contrat social » pour le monde d’aujourd’hui, Pedone, 2025.Cf.aussi les deux grands colloques anniversaires de la CNCDH, La Déclaration universelle des droits de l’homme 1948-1998, Avenir d’un idéal commun, La Doc.fr. 1999 ; La Déclaration universelle des droits de l’homme 1948-2009, Réalité d’un idéal commun ? La Doc. fr. 2009 ; ainsi que la journée d’étude organisée au Conseil d’Etat, avec la CNCDH et l’Institut international des droits de l’homme, René Cassin, de la France libre aux droits de l’homme, La Doc. fr., 2009.
[20] Marc Gambaraza, La portée juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Pedone, 2016.
[21] Discours de René Cassin lors de la remise de son épée de membre de l’Aadémie des sciences morales et politiques à Louis Armand, in Les grands discours de René Cassin, op.cit.
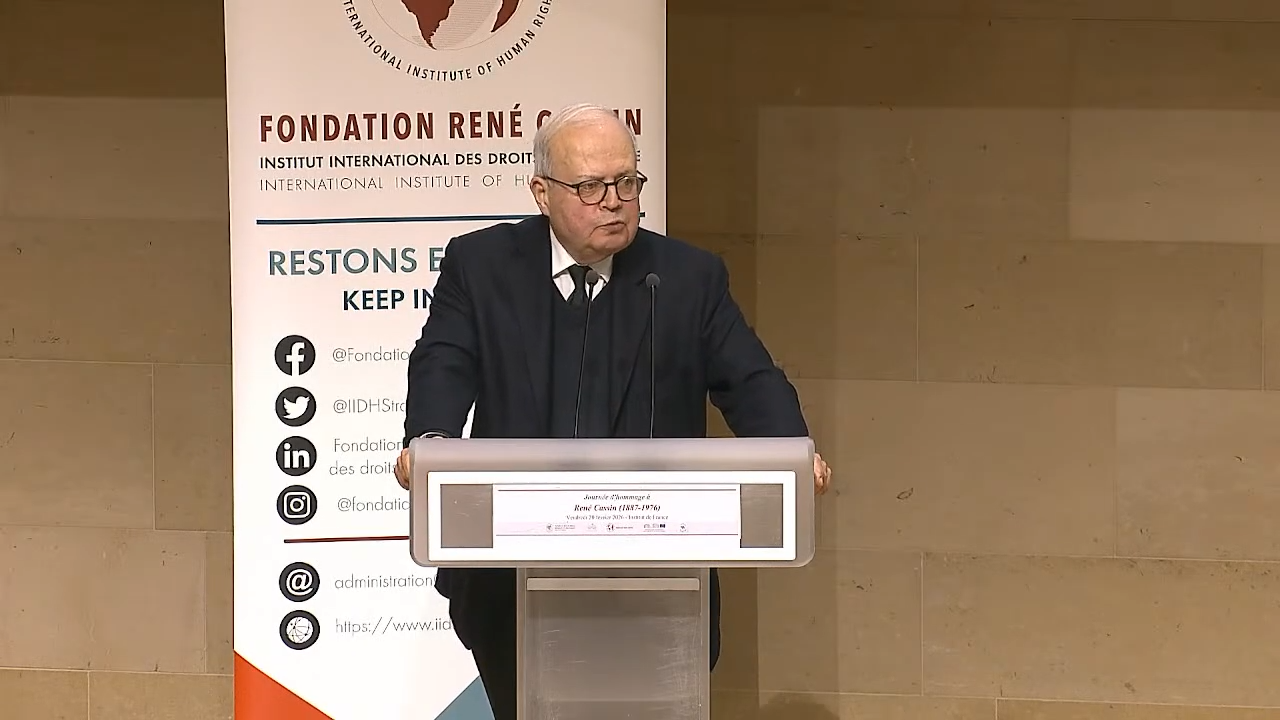

15h30 – 16h30 René Cassin dans son temps – sous la présidence de Philippe Etienne, Ambassadeur de France

René Cassin, Professeur de droit
(20 février 2026)
Absent à la Libération de Paris, le 25 août 1944, René Cassin regagne Paris aux premiers jours de septembre.
Une de ses premières démarches est de demander à l’administration des domaines, qui détient ses biens confisqués, que soient rapportées à la Faculté de droit de Paris sa robe et sa toque, symboles de la fonction universitaire ; volonté d’affirmer la continuité des institutions à travers l’épreuve de la guerre.
C’est ainsi en sa qualité de professeur à la Faculté de droit de Paris rétabli dans sa chaire qu’il siège à l’assemblée des professeurs, le 7 novembre 1944 ; et il restera jusqu’à sa retraite en 1960 « professeur à la Faculté de droit de Paris mis à la disposition du Conseil d’État » ainsi qu’en atteste le registre de la Faculté. Et c’est encore l’assemblée de la Faculté de droit de Paris qui, en 1968, sur l’initiative du Doyen Vedel, propose René Cassin pour le prix Nobel de la Paix.
René Cassin aura été professeur de droit toute sa vie ; et même au-delà depuis le transfert de ses cendres au Panthéon en 1987 à quelques pas de celle qu’il désignait comme sa chère Faculté.
Suivons cet itinéraire.
I / Un professeur de droit parmi les siens : du droit privé au droit international
Né à Bayonne en 1887, c’est à Nice que René Cassin passe toute son enfance. Très tôt – et contre la volonté de son père – il se sent attiré vers la matière juridique et ambitionne les carrières juridiques ; il obtient de s’inscrire à la Faculté de droit d’Aix-en-Provence ; et se découvre une véritable passion pour le droit dans l’étude duquel il va exceller, collectionnant prix et mentions jusqu’à une première place au concours général des facultés de droit en 1908 ; il a 21 ans.
Puis il « monte à Paris » pour ses études de doctorat et la préparation du concours d’agrégation de droit privé ; là encore contre la volonté de son père qui désespère lui voir reprendre l’entreprise familiale et qui lui coupe les vivres.
Menant rapidement l’affaire, René Cassin rédige sa thèse sur un sujet de droit des obligations qu’il parvient à renouveler : « l’exception d’inexécution dans les rapports synallagmatiques et ses relations avec le droit de rétention, la compensation et la résolution » ; thèse d’une grande richesse dépassant le commentaire de l’adage romain ; thèse soutenue en 1914 avec les plus grands éloges.
René Cassin se dispose alors à se présenter au cours d’agrégation de droit privé prévu pour l’automne 1914 quand survient la guerre. Mobilisé le 2 août 1914, gravement blessé le 12 octobre de la même année, il est réformé et renvoyé à la vie civile.
À peine sorti de convalescence, René Cassin regagne la Faculté de droit d’Aix-en-Provence. Nommé chargé de cours il assure de nombreux enseignements ; dans le cadre de la Faculté, mais également à l’extérieur de celle-ci, notamment à destination de réfugiés serbes. Ainsi en 1916/1917 il donne des leçons sous forme d’entretiens sur « la condition des sujets ennemis en France pendant la guerre » qui ont été publiées en 2021 par notre Académie.
Il se présente au concours d’agrégation de droit privé ouvert en 1919 ; il fait partie de cette légion de candidats, honorés de croix de guerre, de citations, de Légions d’honneur, qui portent les stigmates de la violence du conflit dans leur chair même ; avec notamment André Rouast, Paul-Louis Lucas, Henri Lévy-Bruhl, Louis Bodin ou encore André Amiaud.
Reçu troisième, il choisit d’être nommé à la Faculté de droit de Lille et rejoindra la Faculté de droit de Paris en 1929.
Derrière cette chronologie sèche mais qu’il fallait rappeler, se dévoile une belle carrière de professeur de droit assortie de charges, occupations, responsabilités universitaires et para universitaires de la nature de celles qui allaient alors tout naturellement aux professeurs de droit : missions d’enseignement et d’examens en Europe, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient ainsi qu’en Afrique ; l’année 1939, le trouvera encore en mission d’examens à Hanoï ; participation à de nombreuses commissions ; création des premières associations départementales puis de l’Union fédérale des associations de mutilées de guerre et d’anciens combattants dont s’il sera le président jusqu’en 1940.
Dans l’ordre international le professeur René Cassin est très présent. Dès les années 20 il assure la représentation de la France dans plusieurs institutions internationales : délégué adjoint de la France aux assemblées de la SDN depuis 1924 et jusqu’à 1938 ; il publie en 1926 un ouvrage sur les accords de Locarno et la SDN.
Il donne également un cours à l’Académie de droit international de La Haye sur « la nouvelle conception du domicile dans le règlement des conflits de loi », travail que Berthold Goldman lorsqu’il rejoint notre Académie en 1986 qualifie de travail fondateur.
Ainsi, sans délaisser le droit privé – la publication annuelle de ses cours de droit civil de doctorat se poursuit régulièrement jusqu’en 1938/1939 -, René Cassin est de plus en plus, par ses ouvrages, dans la presse et par ses activités de représentation, présent dans le domaine des relations et du droit international.
Il fait partie de ces professeurs de droit, nombreux dans l’entre-deux guerres qui mettent leur savoir au service de l’action publique. C’est cette volonté d’action, de transformation par le droit qui anime René Cassin lorsqu’il rejoint de Gaulle à Londres.
Et c’est ce qui fait que…
II / Le professeur René Cassin se fait légiste de la France libre.
Nicole Questiaux, qui nous honore de sa présence aujourd’hui et qui a bien connu René Cassin, disait de lui : « cet homme était un juriste, un professeur de droit ; son arme était la plume ; le droit, un levier pour faire avancer les choses ».
Quelle meilleure définition d’un légiste ?
Et c’est de cette qualité de légiste que le Général de Gaulle adoube René Cassin lorsqu’il l’accueille à Londres. La scène est bien connue. René Cassin n’a pas eu connaissance de l’appel du Général de Gaulle avant le 21 juin ; « 36 heures après, nous dit-il, embarqué à Saint-Jean-de-Luz, j’étais à Londres » ; le samedi 29 juin au matin, il est introduit auprès du Général de Gaulle . On sait le dialogue qui suit :
– Je suis juriste, professeur de droit ; je suis aussi invalide de la guerre de 1914/18 ; jugez-vous que mon concours puisse vous être utile ?
– Vous tombez à pic. Vous êtes juriste. Il est essentiel que la Grande-Bretagne dispose d’un statut des forces françaises libres. Rédigez-le.
– Mais, mon Général, je suis professeur de droit civil !
– Vous êtes l’armée française ! Je vous donne l’ordre de me remettre ce statut sous 48 heures.
Et c’est ce qui fut fait dès le 5 août ; conduisant à l’accord signé le 7 août avec Churchill par lequel le Royaume-Uni reconnaît la France libre, fixe le statut des forces françaises libres et traite de l’attitude du gouvernement britannique à l’égard de la France dans le présent et pour l’avenir.
Il fallait également élaborer les textes concernant le statut des Français libres engagés auprès de de Gaulle, leur situation individuelle, celles de leurs familles et de leurs ayants-droits.
Puis très rapidement, René Cassin étant nommé secrétaire permanent du Conseil de l’Empire dès octobre 1940, d’élaborer, à mesure que des territoires de la France d’outre-mer se rallient à la France libre, les textes permettant que l’administration s’exerce, que la justice soit rendue, les impôts prélevés, la monnaie renouvelée, etc.
Le Comité français de libération nationale avait dès le 15 septembre 1941 créé une Commission de législation chargée de préparer les projets d’ordonnances et de décrets ainsi que les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité républicaine.
La Commission de législation devient à Alger le Comité juridique de la France libre (ordonnance du 6 août 1943) placé sous la présidence de René Cassin ; de façon si l’on peut dire prémonitoire, Louis Joxe, alors secrétaire général du Comité français de libération nationale, le décrit comme « une espèce de Conseil d’Etat au petit pied présidé par René Cassin entouré de membres incontestables et incontestés ».
Le Comité juridique est consulté sur tous les projets d’ordonnances et la mise en forme des textes et investi d’une mission générale de conseil juridique ; à plusieurs reprises, René Cassin rappellera l’obligation de consultation du comité juridique pour tous les projets d’ordonnances. Le Comité juridique jouera, au cours des 99 séances qu’il tiendra, un rôle essentiel dans l’élaboration de la législation de la France libre. La disposition de ces textes est certainement pour beaucoup dans l’échec des projets radicaux et dangereux qu’avaient notamment les Américains pour l’administration de la France libérée.
Je n’insiste pas sur cet aspect qui a été développé par mon confrère Hervé Gaymard. Mais il essentiel de comprendre que René Cassin, arrivé à Londres comme un professeur de droit civil certes ouvert à la vie internationale, s’y accomplit en légiste au sens traditionnel et magnifique du terme, c’est à dire celui qui, par la loi, établit ou rétablit l’autorité de l’État et garantit le fonctionnement des services publics.
Et c’est ce professeur de droit accompli devenu légiste qui va rejoindre le Conseil d’Etat. Mais cela ne se fera pas immédiatement. Et la façon dont cela se fera est elle-même révélatrice.
III / Un professeur de droit devenu légiste qui transforme le Conseil d’Etat
La qualité de légiste que René Cassin s’était acquise le destinait naturellement aux fonctions de Garde des sceaux dans le gouvernement provisoire du Général de Gaulle ; mais il en fut différemment ; et ce n’est finalement qu’à la fin de 1944 (décret du 22 novembre 1944) que René Cassin est nommé vice-président du Conseil d’Etat dans la continuité de ses fonctions à la tête du Comité juridique de la France libre et dans les conditions qu’il avait souhaitées.
Quelle était alors la situation du Conseil d’Etat ?
Le Conseil d’Etat réuni encore en assemblée générale le 17 août 1944 sous la présidence d’Alfred Porché apparaît, une fois Paris libéré, dans une situation difficile. Sans doute, dépourvu de compétences législatives, n’a-t-il pas eu à connaître des lois de Vichy de 1940, 1941 et 1942 sur le statut des juifs, mais l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration administrative s’applique au Conseil d’Etat et conduit à écarter ceux de ses membres les plus engagés du côté de Vichy, principalement ceux qui ont exercé des fonctions en dehors du Conseil.
Partie prenante aux institutions de Vichy, il se trouve d’autre part confronté aux organes de substitution mis en place dans le cadre de la France libre, au premier rang desquels le Comité juridique présidé par René Cassin.
Dès la Libération de Paris, le Comité juridique de la France libre s’installe à Matignon ; il conserve les fonctions qu’il avait à Alger d’examen de tous les projets d’ordonnances ; il est d’ailleurs renforcé dans ses effectifs et dans ses moyens ; et c’est ainsi qu’il examine dans les trois mois de sa réinstallation quelques 900 projets d’ordonnances, des demandes d’avis et des projets de décrets.
Le Conseil d’État quant à lui, modifié dans sa composition, retrouve progressivement les fonctions presque exclusivement contentieuses qui étaient les siennes sous la IIIe République.
Les deux fonctions demeurent strictement séparées : au comité juridique, la préparation des lois et ordonnances ; au Conseil d’Etat, le retour progressif du contentieux ; et René Cassin y veillera jusqu’à ce que, à la fin de novembre 1944, celui-ci soit nommé vice-président du Conseil d’Etat réalisant ainsi en sa personne le cumul de cette nouvelle fonction avec celle qu’il exerçait comme président du Comité juridique.
Cette nomination a d’abord une signification politique. Je cite Bernard Ducamin, « elle est une chance pour le Conseil d’Etat, dans l’immédiat et à long terme ; c’est d’un corps traumatisé, moralement diminué que René Cassin prend la tête… Cette nomination sert de caution morale et efface ce qu’il y a pu y avoir de douteux dans l’attitude du Conseil d’Etat pendant quatre années difficiles ». Et ce d’autant plus que René Cassin gérera la chose avec beaucoup de doigté : lors de son installation au Conseil en présence du Garde des Sceaux, il se déclare soucieux de la continuité historique et s’inscrit « dans la lignée des chefs éminents qui ont dirigé ce grand corps de l’État ».
Mais, au-delà de cet aspect politique et sur un plan plus technique, René Cassin nommé vice-président du conseil d’État apporte avec lui sa qualité de légiste au plus haut niveau, l’expertise réaffirmée à la Libération d’une participation active à l’élaboration de la loi.
Et c’est tout naturellement que l’ordonnance du 31 juillet 1945 portant statut du Conseil d’Etat, d’ailleurs préparée par René Cassin, prévoit la consultation du Conseil sur tous les projets de loi.
Le Conseil d’État acquiert, héritée du Comité juridique d’Alger et apportée par René Cassin, une compétence de participation systématique à l’élaboration de la loi qu’il n’avait pas sous la IIIe République. Et c’est encore René Cassin qui, fidèle à lui-même, demandera et obtiendra en 1958 que la consultation du Conseil d’Etat sur les projets de lois et ordonnances soit inscrite dans la Constitution elle-même.
C’est une véritable transformation, rien moins qu’un nouveau positionnement du Conseil d’Etat au sein des pouvoirs publics dont celui-ci se trouve enrichi avec l’arrivée à sa tête de René Cassin ; une compétence de fabrication de la loi héritée du Comité juridique de la France libre ;
une compétence dont on n’a peut-être pas pris immédiatement la mesure, mais qui se révèlera considérable de conséquences : aujourd’hui, par ses avis désormais publiés et comportant un examen complet du projet de loi, de la proposition de loi ou encore d’amendements parlementaires, au regard notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le Conseil d’État a développé une véritable fonction d’accompagnement du législateur dans la confection de la loi ; renouant avec une fonction qu’il n’avait plus depuis le Tribunat.
C’est sans doute là l’apport majeur de René Cassin au Conseil d’Etat
Mais on ne saurait conclure sans relever que, parallèlement, tant qu’il était au Conseil et encore par la suite jusqu’à sa mort en 1976, René Cassin a développé une activité de type universitaire, activité d’ouverture, d’études, d’enseignements, d’organisation de colloques, de publications ; une activité qui n’était pas dans la tradition du Conseil d’Etat ; une activité vouée là encore à un bel avenir.
Et je ne peux mieux faire à cet égard que reprendre les propos conclusifs du vice-président Tabuteau lors de la conférence qu’il a bien voulu présenter devant notre Académie l’année dernière : au-delà de ses fonctions essentielles, le Conseil d’État doit aussi, disait-t-il, « être parmi les lieux où il est possible de prendre du recul et le temps de se projeter dans l’avenir avec la force et la légitimité que lui donne son enracinement dans l’histoire de notre pays » ; parole que le professeur René Cassin aurait sans doute bien volontiers faite sienne pour sa chère Faculté de droit.
Yves, Gaudemet
20 février 2025
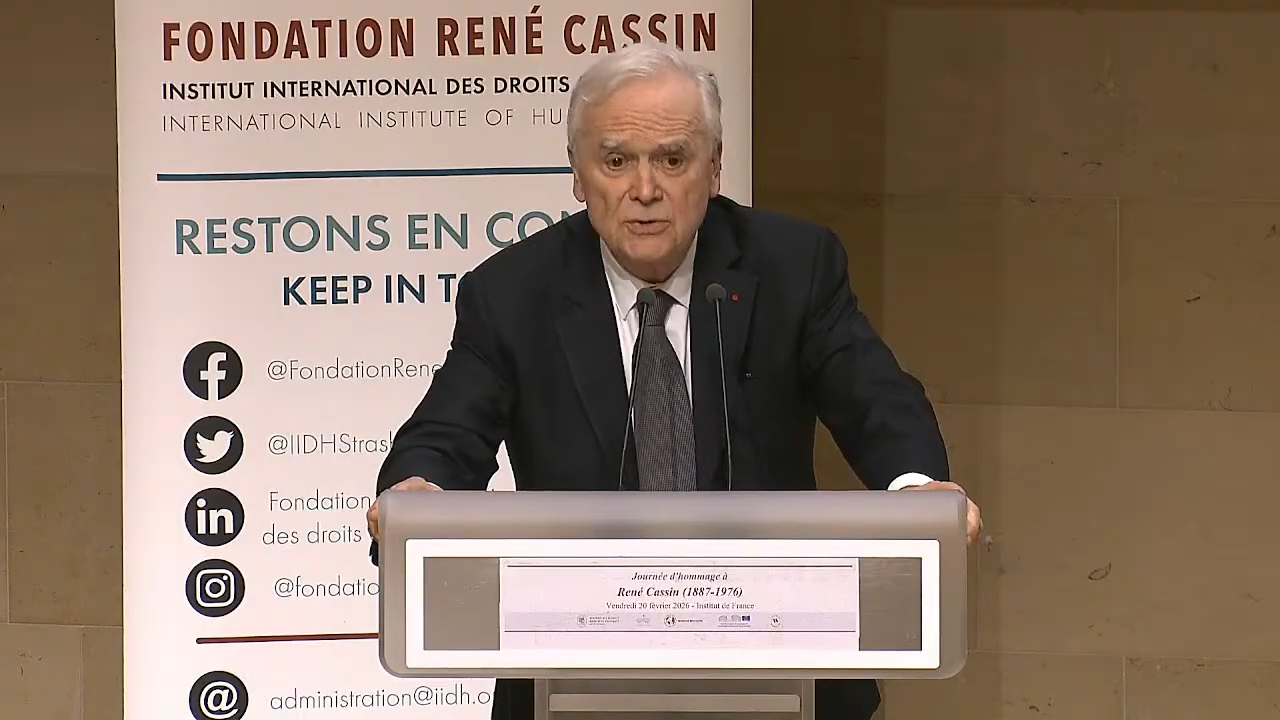

René Cassin, Président de l’Alliance israélite universelle, 1943-1976
Au service de la vocation universelle du judaïsme
Haïm Korsia
Grand Rabbin de France
Vice-président de l’Académie des sciences morales et politiques
Paris, le 20 février 2025,
Parler de René Cassin, c’est évoquer, bien sûr, l’un des pères du droit international contemporain qui a su ne pas rêver et faire naitre une déclaration internationale mais bien universelle. Mais c’est aussi rappeler l’engagement total d’un homme au service de la vocation universelle de la France et à travers l’Alliance israélite universelle, à celle du judaïsme. Au fond, Cassin, c’est la rencontre de trois universalités, celles de la France, de l’humanisme et du judaïsme.
Français, juif, humaniste, René Cassin, n’a jamais opposé ces appartenances, il les a conjuguées. Et c’est précisément cette harmonie qui l’a conduit à présider l’Alliance israélite universelle, institution dont la vocation est, depuis sa création, d’éclairer par l’éducation et d’émanciper par le savoir en diffusant l’espérance de la France.
Dès le début de la seconde guerre mondiale, il s’engage dans les forces françaises libres, en tant que conseiller juridique, commissaire à la Justice et à l’Instruction publique au sein du Comité national français. C’est dans ce cadre que René Cassin effectue une mission au Moyen-Orient.
Il visite alors les écoles de l’Alliance et prend la mesure des actions de cette institution dont les valeurs rejoignent les siennes. (cf. « comment je suis devenu Président de l’Alliance in Les Cahiers de l’Alliance, juin 1963)
Fondée à Paris en 1860, l’Alliance s’était donnée la mission de défendre les droits des Juifs partout où ils étaient menacés, et promouvoir leur émancipation par l’éducation. Son ambition était philanthropique et profondément spirituelle et politique au sens noble du terme. Il s’agissait de faire en sorte que chaque enfant juif, où qu’il naisse — à Tanger, à Salonique, en Iran, en Turquie, en Egypte, en Algérie, au Liban, en Israel, à Bagdad ou à Paris — puisse accéder au savoir, à la dignité, à la citoyenneté, et à la transmission du judaïsme et de ses valeurs. Au fil du temps, l’AIU s’est révélée comme une institution éducative puissante qui a révolutionné tant le monde juif que celui de la francophonie.
En fait, en 1943, De Gaulle, souhaitant maintenir une présence française au Moyen-Orient, lui confie la présidence provisoire de cette institution, menacée de disparition : les subsides sont bloqués, le siège spolié, les donateurs disparus ou exilés, le personnel enseignant livré à lui-même…
René Cassin accepte cette mission, sans mesurer immédiatement la place que l’Alliance occupera dans sa vie. Mais il comprend rapidement que cette action éducative est une œuvre de libération. L’éducation n’est pas un luxe mais la condition même de la liberté. En présidant l’Alliance, il affirme que l’instruction est la première défense contre l’humiliation, l’exclusion et l’arbitraire.
Dans le contexte particulièrement difficile d’après-guerre, il donne une impulsion singulière à l’AIU, une orientation à la fois fidèle à son histoire et résolument tournée vers l’avenir.
À la tête de l’Alliance, il poursuit la mission essentielle de transmettre aux jeunes générations des connaissances et une confiance dans la capacité du judaïsme à dialoguer avec le monde, à enrichir la modernité sans s’y dissoudre, à demeurer fidèle à ses sources tout en s’ouvrant à l’universel. Sa présidence fut active, structurante, déterminante. Il a incarné l’Alliance et l’a transformée et consolidée dans une période de bouleversements historiques majeurs.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Alliance est particulièrement affaiblie. Son réseau avait été désorganisé, ses ressources réduites, et le monde juif profondément meurtri. Lors d’une conférence du 12 au 18 septembre 1946 consacrée à la reconstruction spirituelle et éducative du judaïsme, il trace les lignes du relèvement du judaïsme et donc de l’Alliance après-guerre.
Dans sa préface au livre de René Chouraqui, « L’Alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine » rédigé à l’occasion des 100 ans de l’Alliance, en 1960, il écrit : « nous avons dû, dès la libération de la France et la victoire alliée, adapter nos activités futures aux exigences d’un monde transformé ».
René Cassin s’engage dans une restructuration administrative et financière de l’institution. Il modernise sa gouvernance, renforce la coordination avec les grandes organisations juives françaises (rejoint le CRIF) et internationales et redonne à l’Alliance une visibilité diplomatique. Il veille à ce que l’institution retrouve sa crédibilité auprès des instances françaises et internationales.
Il considère que reconstruire l’Alliance, c’est reconstruire une part de la dignité juive elle-même. Aussi, Cassin veille à ce que l’Alliance ne soit jamais tentée par le repli communautaire. Elle devait demeurer une institution juive par son inspiration, mais universelle par son action. Il n’y a pas de contradiction entre fidélité à son peuple et service de l’humanité ; au contraire, l’une nourrit l’autre.
Les années 1950 et 1960 sont marquées par les indépendances au Maghreb et par les tensions croissantes au Moyen-Orient. Les communautés juives d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, d’Irak ou d’Égypte vivaient des situations souvent précaires.
Sous la présidence de Cassin, l’Alliance intensifia son action diplomatique discrète pour protéger les droits civiques des Juifs dans ces pays.
Elle facilita, lorsque cela devenait nécessaire, les transferts d’élèves et d’enseignants vers la France ou Israël – « Depuis quelques années, il (Chouraqui) s’attache notamment à aider les nombreux immigrants francophones qui affluent en Israël , à ne pas perdre le bénéfice de la première éducation reçue par l’Alliance et à élever leurs enfants, dans le jeune Etat, comme de futurs citoyens égaux en instruction et en dignité, avec l’appui de la vieille et toujours jeune institution » (in La préface écrite par René Cassin dans « L’Alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine » écrit par René Chouraqui à l’occasion des 100 ans de l’Alliance , 1960)
Elle adapta son réseau scolaire aux nouvelles réalités politiques, en négociant avec les autorités locales pour maintenir les établissements ouverts le plus longtemps possible.
Cassin mobilise ses contacts dans les milieux juridiques et diplomatiques internationaux pour plaider la cause des minorités juives. Son autorité morale est un atout décisif comme elle le sera pour défendre les Juifs de Pologne et d’URSS, les Refuzniks.
Mais l’éducation reste le cœur battant de l’Alliance et sous son impulsion les programmes sont actualisés afin d’intégrer davantage les sciences modernes et les disciplines civiques. L’accent est mis sur la formation des enseignants, afin d’élever le niveau pédagogique. Et des efforts sont faits pour assurer une meilleure articulation entre les écoles de l’Alliance et les systèmes universitaires français.
Cassin voit dans ces écoles non seulement des lieux d’instruction, mais des laboratoires de citoyenneté, des lieux d’ouverture et d’excellence, capables d’offrir aux jeunes générations les moyens d’entrer pleinement dans la modernité. Il souhaite former des jeunes capables d’assumer une identité juive éclairée tout en étant pleinement acteurs de leurs sociétés. Il a de nombreuses fois affirmé que « la clé de l’avenir demeure, pour l’Alliance, dans une éducation moderne, à la fois humaine et juive, où l’homme actuel puisse développer sa personnalité sans se déraciner de ses origines ». Préface, Livre de L’Alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine écrit par René Chouraqui à l’occasion des 100 ans de l’Alliance, 1960)
Voici une autre citation qu’il se plaisait à répéter et qui figurait régulièrement en ouverture des Cahiers de l’Alliance, montrant l’attachement de l’institution à la promotion de ces valeurs prônées par René Cassin: « Former les meilleurs hommes, les meilleures femmes, former les meilleurs Juifs, former les meilleurs citoyens, les meilleurs membres de la société !»
Il serait impossible de dissocier l’œuvre de Cassin à l’Alliance de son engagement international. « La conclusion des traités de paix et la création des Nations Unies, n’engendraient-elles pas pour nous le devoir de protéger les droits des juifs survivants en étroite solidarité avec ceux de tous les autres êtres humains aspirant à plus de justice ? » (Préface, Livre de L’Alliance israélite universelle et la renaissance juive contemporaine écrit par René Chouraqui à l’occasion des 100 ans de l’Alliance, 1960)
Artisan majeur de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il fait entrer plus fortement l’Alliance dans les réseaux internationaux de défense des droits.
Concrètement, l’Alliance renforce sa présence auprès des organisations internationales, notamment la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, elle développe des mémoires juridiques et des interventions argumentées lorsqu’il s’agit de défendre et protéger les communautés menacées et elle élargit son discours car, défendre les Juifs, oui, mais en inscrivant cette défense dans une vision globale de la protection des minorités.
Pour Cassin, la cause juive ne doit jamais être isolée de la cause humaniste. C’est ainsi d’ailleurs qu’il expose une des raisons d’être de l’Alliance dans un éditorial paru dans les Cahiers de l’Alliance en 1952 : « Le rôle de l’Alliance n’est pas terminé tant qu’il existe encore des dizaines de milliers d’enfance à sauver de l’ignorance et de la misère, et tant que le respect des libertés fondamentales, de l’égalité et de la dignité humaines ne sont pas assurés ».
René Cassin encourage également les travaux intellectuels et juridiques au sein de l’Alliance. Il soutient les initiatives visant à promouvoir la pensée juive contemporaine, le dialogue entre tradition et modernité, et la réflexion sur le droit hébraïque en écho au droit international. Il veut que l’Alliance soit non seulement un réseau scolaire, mais aussi un centre de rayonnement intellectuel : « Nous devons dans son ensemble reprendre le problème de la culture et redonner aux adultes, qui ont pu le perdre ou ne l’ont pas acquis, le sentiment de la connaissance des choses juives des livres saints, de l’hébreu et de tout ce qui touche à la pensée juive » explique-t-il dans son discours de clôture de la réunion annuelle de l’AIU en 1965. C’est d’ailleurs lui qui recrutera Levinas à l’ENIO, l’école normale israélite orientale qui avait vocation à former les enseignants.
Sa présidence marque un tournant symbolique dans l’appréciation du sionisme politique par l’institution après de longues et houleuses confrontations avec le mouvement. LaDéclaration de l’Alliance du 11 novembre 1945 se révèle ainsi être un véritable manifeste de refondation en la matière, affirmant qu’elle est désormais « résolue à demander pour les juifs qui y aspirent, sous l’égide des Nations Unies et la responsabilité de l’Agence juive pour la Palestine, le droit d’entrée en Palestine. Ils y trouveront plus qu’un refuge : un foyer de chaleur spirituelle, le seul où ils sont impatiemment attendus et d’où rayonneront, quelque jour peut-être, une fois de plus sur le monde, les vérités d’Israël ».
Les actions de soutien au mouvement sioniste se multiplient alors. Lors de l’affaire de l’Exodus, il proteste contre l’action de répression du Royaume-Uni et encourage pas voie de presse l’implication du ministre français de l’Intérieur pour dénouer la situation (16 et 22 septembre 1947). Il influence les Nations Unies et la France pour l’approbation du plan de partage de la Palestine mandataire, puis il salue la création de l’Etat et admire le nom choisi d’Israël : « C’est par ce trait génial qu’il s’enracine profondément dans les profondeurs du passé biblique des Juifs ».
Il encourage l’élargissement du réseau éducatif de l’Alliance à Israël avec la création de nouveaux groupes scolaires, se dresse respectueusement, dans un article paru dans Le Monde de juin 1967, contre De Gaulle, à la veille de la guerre des Six jours, se fend d’une lettre à René Maheu, le 4 novembre 73, alors directeur général de l’UNESCO dans laquelle il proclame : « si l’Unesco faisait siennes les accusations portées contre Israël, je n’hésite pas à le dire, elle perdrait une part de sa raison d’être ».
Jusqu’à son décès, en 1976, René Cassin demeure président de l’institution, contribuant largement au rayonnement et au prestige de l’institution.
Ce qui frappe dans ces actions, c’est leur cohérence. René Cassin ne compartimentait pas. La défense juridique, l’éducation, l’action diplomatique, la transmission intellectuelle : tout relève d’une même exigence. La Bible nous enseigne « Tsedek, tsedek, tirdof – justice, justice tu poursuivras » (Dt. XXVI, 20). C’est ce que dit le grand rabbin Jacob Kaplan lors de l’oraison funèbre de René Cassin et qui le représente si fidèlement. Dans l’ensemble des fonctions qui furent les siennes, il a œuvré à porter une vision de droiture et d’équité et celle d’un judaïsme responsable, conscient de sa vocation éthique, capable d’agir dans l’histoire sans jamais renoncer à ses principes. Lui qui avait été grièvement blessé durant le premier conflit mondial et qui en porta toute sa vie les séquelles, œuvra au droit à la réparation pour tous les blessés, une forme laïque du concept de Tikoun Olam, la réparation du monde.
René Cassin a fait de l’Alliance ce qu’il était lui-même : un pont entre mémoire et avenir, entre fidélité et ouverture, entre le particulier et l’universel. Et c’est là, sans doute, la plus concrète de ses actions qui consistait à donner à une institution les moyens de traverser les tempêtes sans perdre son âme.
Je sais que lui qui s’est battu pour les droits des Juifs dans le monde, lui que Mitterrand appelait son « professeur d’espoir » aurait trouvé comment mobiliser nos concitoyens face à la situation des Juifs en France aujourd’hui, car lui qui se définissait comme « fils des trois frontières », Bayonne par sa naissance, Alsace par sa mère et Nice par son père, a toujours œuvré à retisser du lien, comme l’aurait dit Philippe Jaccottet « Mais chaque jour, peut-être, on peut reprendre le filet déchiré, maille après maille, et ce serait, dans l’espace plus haut, comme recoudre, astre à astre, la nuit ».
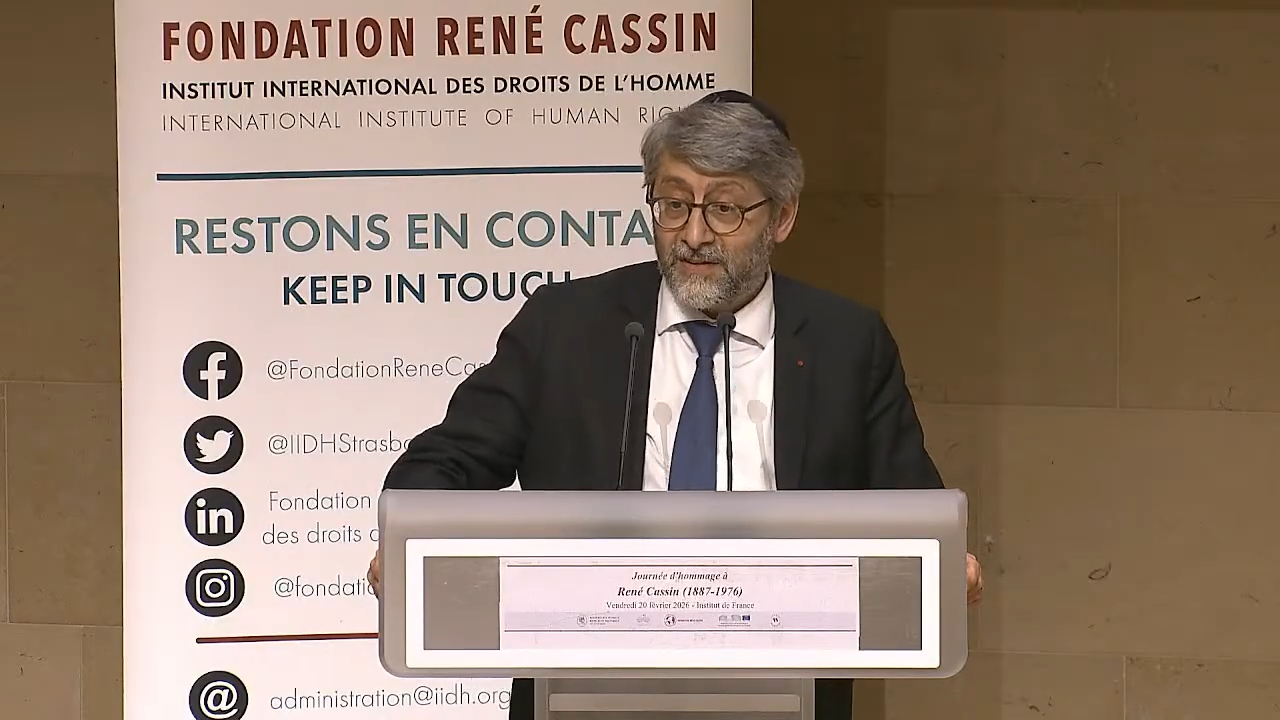

- Le progrès des droits de l’homme : Isabelle Rome, Ambassadrice aux droits de l’homme


16h30 – 17h00 Pause
17h00 – 17h45 René Cassin et l’État de Droit – sous la présidence de Laurence Burgorgue Larsen, Professeure à l’Université Panthéon-Sorbonne.

- René Cassin, Vice-Président du Conseil d’Etat : Didier Tabuteau, Vice-Président du Conseil d’Etat
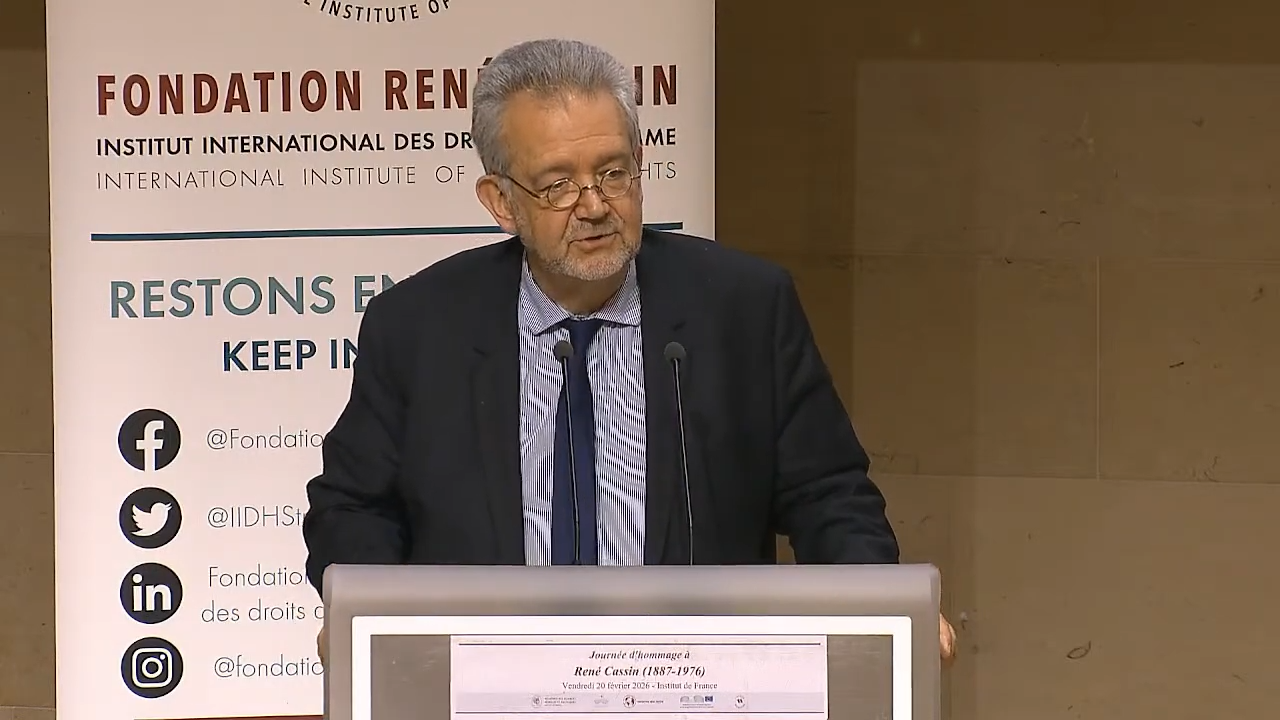
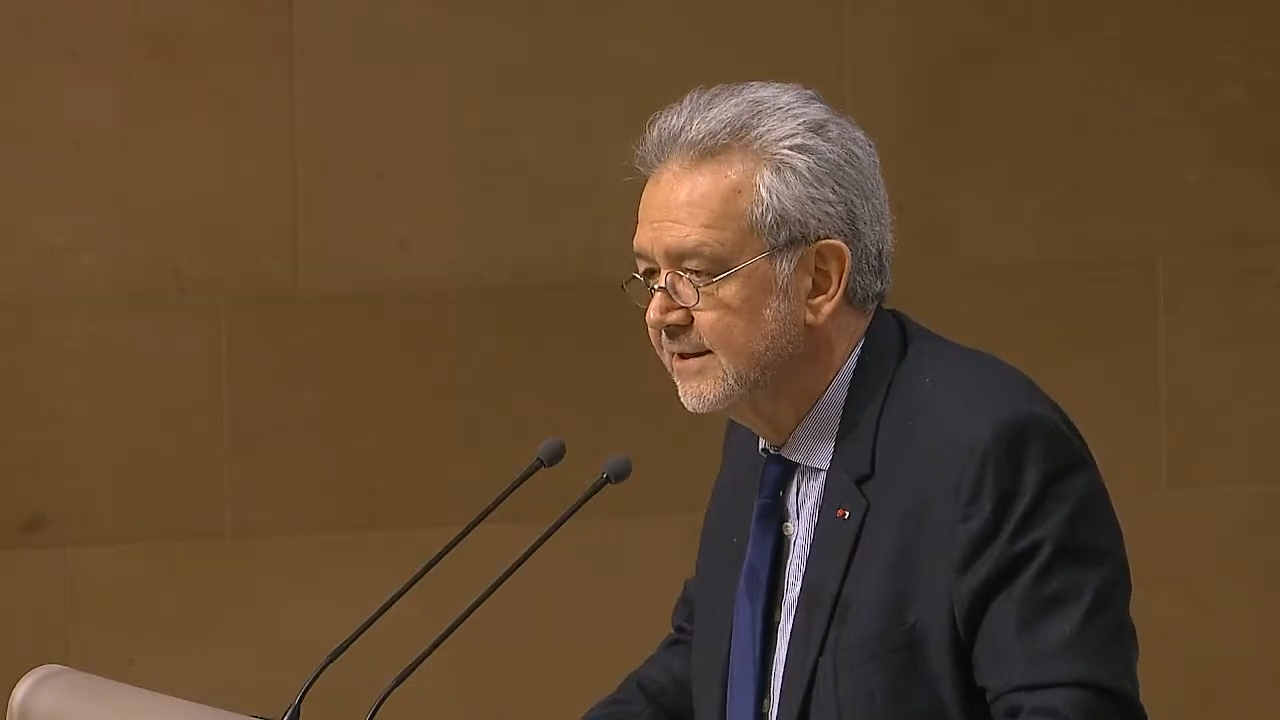
- René Cassin, Président de la Cour européenne des droits de l’homme : Mattias Guyomar, Président de la Cour européenne des droits de l’homme


Journée d’hommage à René CASSIN
20 février 2026.
Institut de France
Il m’appartient à présent de conclure brièvement (je vous le promets) cet après-midi d’hommage : exercice difficile et quelque peu artificiel, a fortiori à une heure aussi tardive. Soyez bienveillants.
Bernard STIRN a laissé entendre que c’est le fait d’occuper au sein de l’académie des Sciences morales et politiques le fauteuil n° 2 de la section « Droit », qui était celui de René CASSIN, qui me vaut l’honneur d’assurer cette conclusion. Entre René CASSIN et moi seuls nous séparent les professeurs Henri BATIFFOL et Roland DRAGO … je le sens très proche !
Cette filiation académique explique donc ma présence à cet instant et, oui, j’en suis honoré et très fier même si , par rapport à René CASSIN, je me sens aussi minuscule que l’un des personnages figurant dans les albums du génial dessinateur qu’est M.SEMPE … !
Bien que l’heure soit tardive et, surtout, bien que tout ait été dit et si bien dit, je souhaite marquer que l’hommage qui vient d’être rendu à René CASSIN, hommage qui embrasse, nombre, sinon toutes, les facettes de cet être d’exception, est magnifique. Il s’imposait : merci et bravo !
Rien n’a été laissé dans l’ombre et l’on reste confondu devant tout ce que cet homme a apporté à son pays, la France, mais aussi à l’Europe et au Monde dans lequel il vivait. Oui, tout cela a été dit et bien dit aujourd’hui et cela s’imposait.
La qualité des intervenants et de leurs propos ne laissait planer aucun doute sur ce que, grâce à eux, nous redécouvririons et sur ce que nous apprendrions … et les évocations qu’ils ont faites sont tellement utiles, voire indispensables, dans le Monde désarticulé dans lequel nous vivons actuellement :
Comme René CASSIN serait malheureux devant l’ignorance et même l’hostilité dont fait l’objet le droit international, le droit européen, le droit, tout court, ces droits auxquels il tenait tant.
A nous alors de rappeler qu’il est des valeurs, les siennes, que l’on n’a pas le droit de piétiner et cette rencontre autour de cet « homme du droit » l’a permis. Une nouvelle fois : Bravo !
Médusé devant l’état du Monde, il ne serait pas resté silencieux. Avec l’opiniâtreté qui le caractérisait, il aurait réagi, parlé, écrit, agi. »Je souffre de n’être que juriste et veux être mêlé à l’action » écrivait-il le 15 juillet 1940 ! Cela nous a été rappelé par Emmanuel DECAUX dans son récent ouvrage sur René CASSIN et tout à l’heure par Mathias GIYOMAR.
Au moment où l’aveuglement, ou la bêtise ou la mégalomanie, conduisent certains chefs d’Etat à se moquer, de manière totalement désinhibée, d’un droit international patiemment construit, d’organisations internationales dont l’utilité notamment pour les plus faibles n’est plus à démontrer, d’une justice internationale apte à réguler et à pacifier,
Au moment où l’on massacre, aveuglément et massivement, en Iran des populations éprises d’un minimum de liberté,
Où, à Gaza, la riposte aux atrocités commises le 7 octobre 2023, sont hors de proportion avec que l’on peut juridiquement admettre,
Où, pour satisfaire des envies, oui, mégalomaniaques, certains se proposent d’acquérir des territoires comme l’on négocie du pétrole ou des champs de pommes de terre,
Où l’Administration américaine sanctionne des procureurs et des juges exerçant en collégialité, des juges qui ne font que leur devoir dans le strict respect des textes fondateurs de la Cour pénale internationale au sein de laquelle ils exercent,
Au moment où une juridiction russe condamne, in abstentia, sans défense, d’autres juges de cette même CPI à de lourdes peines privatives de liberté,
(vous avez compris que c’est l’ancien président d’une chambre de jugement de la Cour pénale internationale qui s’exprime là)
Oui, en cet instant, songeons à René CASSIN, qui fut trois fois juge : administratif, constitutionnel et européen… et, voulez-vous, songeons aussi à des personnalités telles que Stéphane HESSEL, Robert BADINTER et à tant d’autres, à ces hommes infatigables défenseurs des droits de l’homme, épris de liberté, pétris d’humanité : ils doivent plus que jamais être nos « boussoles » !
Gardons confiance, même si, oui, la voix de René CASSIN nous manque aujourd’hui, comme celle de Robert BADINTER qui vient de le rejoindre au Panthéon.
Quelle chance est celle de notre pays d’avoir compté parmi ses membres des hommes comme eux !
Quel symbole de savoir que CASSIN et BADINTER, se donnent aujourd’hui la main en haut de la Montagne Sainte Geneviève ! Oui : ils doivent nous inspirer !
Vous venez, au long de cet après-midi, de refaire parler René CASSIN, vous l’avez fait revivre : c’était essentiel.
Pourquoi, vous direz-vous, un ton si vif de ma part au moment de nous quitter ? Peut-être parce qu’il est bien tard ? Non.
Parce que René CASSIN n’était pas un tiède, il était homme à s’indigner et, il faut le répéter, à agir … ne l’oublions pas au terme de cet après-midi !
Une nouvelle et dernière fois : bravo et merci , merci aux organisateurs, merci aux orateurs , merci à l’assistance, nombreuse, d’une infinie patience et tellement porteuse par sa seule présence .
Notre après-midi s’achève.
Elle est achevée.
Merci !
Bruno Cotte

- Intervention d’Éleonore Caroit, Ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger


- René Cassin et les Archives, les chantiers à venir : Martine de Boisdeffre, Présidente de section honoraire au Conseil d’Etat


- L’héritage intellectuel et moral : l’Institut international des droits de l’homme, Sébastien Touzé, Directeur de la Fondation René Cassin


- L’éducation aux droits de l’homme et la culture de la paix : Audrey Azoulay, Ancienne Directrice générale de l’UNESCO
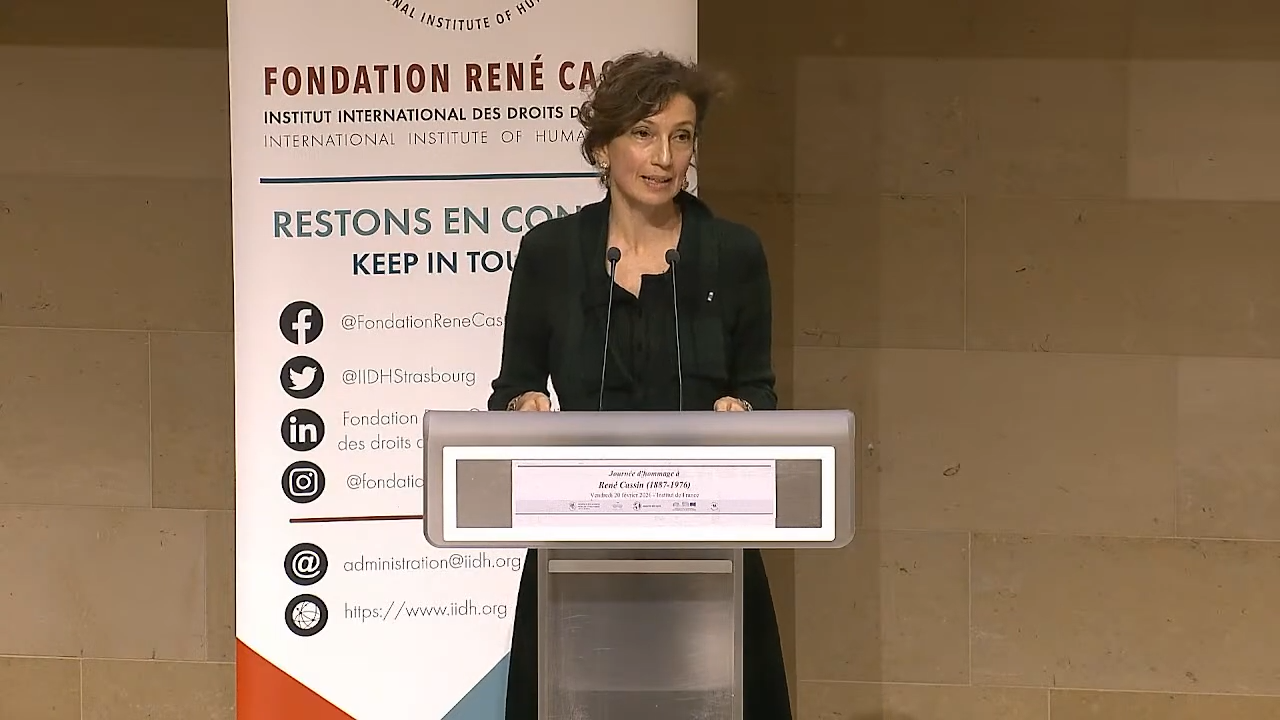

Intervention liée
LA FRANCE ET LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME DU 10 DECEMBRE 1948
Quelle fut l’origine de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ?
La cause profonde est évidente : la deuxième guerre mondiale et la révulsion universelle face aux crimes du national-socialisme hitlérien. Le point de départ fut la Charte de l’Atlantique proclamée par Roosevelt et Churchill le 12 août 1941. Elle définissait le programme de paix des Alliés face aux Puissances de l’Axe, et elle reprenait les « quatre libertés » définies par le président Roosevelt (liberté individuelle, liberté de pensée et de religion, liberté par rapport au besoin économique, liberté par rapport aux menaces contre la sécurité). Dès la conférence interalliée qui se tint à Londres le 24 septembre 1941, René Cassin, tout nouveau commissaire national de la France Libre chargé de la Justice et de l’Instruction politique, déclara au nom du Comité national français que « la consécration pratique des libertés essentielles de l’homme était indispensable à l’établissement d’une paix internationale véritable ».
Dans les années d’après-guerre le sens des droits de l’homme dans le contexte de l’ONU était très clair: il s’agissait d’affirmer et de définir les valeurs au nom desquelles les Nations Unies avaient lutté contre le nazisme et le fascisme. Une première étape avait été la définition du crime de génocide par l’Assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1946. Il s’agissait également, les responsables français furent dès le début très lucides sur ce point, d’empêcher que des violations systématiques des droits de l’homme par un régime donné, sous couvert de sa souveraineté intérieure, n’entraîne un danger de guerre internationale. L’Allemagne hitlérienne, en particulier, avait toujours revendiqué sa souveraineté nationale et le refus de toute ingérence étrangère pour mener sa politique d’exclusion politique ou raciale à l’encontre de catégories entières de personnes, sans tenir compte des protestations qui s’élevaient à l’étranger. Désormais, les Droits de l’homme ne seraient plus une question d’ordre intérieur dans les différents Etats, ce serait une question internationale.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 fut une œuvre collective de l’ONU.
La Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco en avril 1945, se réfère souvent aux droits de l’Homme, mais ses auteurs n’avaient pas voulu les définir, se contentant de stipuler que le Conseil économique et social de l’Organisation instituerait une commission « … pour le progrès des droits de l’homme ». Début 1946, le Conseil économique et social créa une « Commission préparatoire » pour la question des droits de l’homme. Le gouvernement français y nomma le professeur René Cassin, devenu entre temps vice-président du Conseil d’Etat.
A partir des travaux de la Commission préparatoire, le Conseil économique et social décida la création de la Commission des droits de l’homme proprement dite, composée de 18 membres, représentant chacun un Etat membre de l’ONU. Celle-ci tint sa première session du 2 janvier au 10 février 1947 et constitua un comité de rédaction (dont faisait partie René Cassin) afin de mettre au point un projet de déclaration.
Ce comité de rédaction se trouvait en présence de plusieurs projets, émanant en particulier du Panama, du secrétariat général de l’ONU et de René Cassin. Un groupe de travail restreint (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Liban) fut chargé d’élaborer un avant-projet; celui-ci fut rédigé par René Cassin et présenté au comité de rédaction le 16 juin 1947; il comportait un préambule et 45 articles, et il fut adopté comme base de travail par le comité de rédaction.
Il y eut de nombreuses contributions aux réflexions dans le cadre de l’ONU : les pays d’Amérique latine (qui avaient proclamé eux-mêmes leur propre déclaration des droits de l’homme à Bogota en 1947) le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Liban et bien sûr la France se montrant particulièrement actifs. L’URSS et les pays de l’Est insistèrent dès le début sur les droits économiques et sociaux, reprochant aux Droits et libertés traditionnels leur formalisme abstrait. Cette dernière question allait faire par la suite l’objet des plus grands débats et des plus grandes difficultés dans l’élaboration complexe de la Déclaration de 1948 et ensuite des conventions qui devaient en découler. Mais cette extension de la notion de droits de l’homme, au-delà de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, correspondait à l’évolution des conceptions françaises dans ce domaine, telles qu’elles avaient été formulées dans le programme du Conseil national de la résistance puis dans le préambule de la constitution de 1946.
Tout l’objet de la Déclaration était d’élever au rang international les principes proclamés dans le cadre national, certes avec une valeur universelle, par la Déclaration d’Indépendance américaine de 1776 et la Déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
La Commission des droits de l’homme discuta du projet établi en juin 1947 par son comité de rédaction en décembre 1947, et à nouveau en juillet 1948, lors de sa troisième session. Elle tint compte des observations et contre-projets présentés par différents gouvernements (dont le projet du gouvernement français) et abouti en juillet 1948 à un projet de déclaration avec un préambule et 28 articles, qu’elle transmit au Conseil économique et social. Le projet reprenait bien des points du projet français, mais il s’en écartait aussi souvent, et Paris se réservait de le faire amender au Conseil économique et social, ou à l’Assemblée générale, ce qui d’ailleurs fut le cas dans une certaine mesure.
Mais, au-delà de certains détails, ce qui comptait pour la France était que la Déclaration fût votée dès la session de l’Assemblée de l’automne 1948, qui devait se tenir à Paris. C’était évidemment utile pour le prestige de la France. Mais il y avait une autre raison, de fond : certains pays voulaient attendre d’aboutir à un ensemble complet en ajoutant à la Déclaration (qui n’aurait pas de force en droit international au-delà de la simple expression de bonnes intentions) des traités et des conventions d’application, plus contraignants. La France et les Etats-Unis pensaient au contraire qu’il fallait aller très vite, pour établir un socle initial. C’est ce point de vue qui l’emporta, mais il était entendu que les conventions d’application seraient envisagées ensuite.
D’une façon générale, les débats furent complexes, avec des centaines d’amendements proposés. Le représentant français, René Cassin, y joua un rôle considérable, appuyé en particulier par les pays d’Amérique latine.
La Déclaration de 1948 reprenait les bases de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais en y ajoutant la prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, la religion, les opinions, les origines nationales ou sociales, la fortune ou la naissance. Mais à ces droits individuels la Déclaration ajoutait les droits sociaux, économiques, culturels.
Les plus grandes difficultés provinrent des pays communistes. Ceux-ci, en particulier l’URSS, voulaient que l’on aille beaucoup plus loin dans la définition des droits économiques et sociaux et sur ceux des minorités nationales. D’autre part l’URSS s’opposait absolument à la création d’une Cour internationale des Droits de l’homme (proposition australienne) ou de tout organe chargé d’examiner les pétitions adressées aux Nations Unies. La France pour sa part fit adopter le titre de Déclaration « universelle » des droits de l’homme, contre celui de Déclaration « internationale » qui avait la faveur des Anglo-Saxons et qui de toute évidence était de portée plus limitée.
Lorsque le projet remanié par la troisième Commission fut discuté à l’Assemblée générale, celle-ci repoussa toute une série d’amendements d’origine soviétique (sur les droits économiques, les populations coloniales). Les clivages politiques et idéologiques introduits par la Guerre froide étaient déjà fort apparents.
L’Assemblée modifia le projet de sa troisième Commission sur un seul point: celle-ci avait rajouté au projet de la Commission des droits de l’homme, sur proposition yougoslave, un article 3 étendant les droits « à tous les habitants des territoires sous tutelle et des territoires non autonomes ». Très contesté par les puissances coloniales, cet article fut finalement supprimé, et remplacé, selon une proposition anglaise, par un alinéa de portée beaucoup plus générale, et donc plus acceptable du point de vue des puissances coloniales, qui fut rajouté à l’article 2.
Enfin l’Assemblée adopta la Déclaration le 10 décembre 1948, tous les membres de l’Organisation, à l’exception de l’URSS, des Etats d’Europe orientale, de l’Afrique du Sud et de l’Arabie saoudite qui s’abstinrent, s’étant prononcés en sa faveur. En outre l’Assemblée adopta quatre résolutions: l’une relative au droit de pétition, dont l’examen fut renvoyé au Conseil économique et social; une deuxième concernant le problème des minorités, également renvoyée au conseil économique et social; une troisième, d’origine française, relative aux mesures de publicité à prendre pour assurer la diffusion de la Déclaration; une quatrième demandant au Conseil économique et social d’examiner d’urgence le pacte et les conventions internationales envisagés, et en général toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des termes de la Déclaration.
Quel fut le rôle de la France, et en particulier de René Cassin ?
A titre de délégué du gouvernement français ou d’expert des commissions ou conseils compétents de l’ONU, et comme président de la commission consultative des droits de l’homme auprès du Quai d’Orsay, René Cassin joua, on le sait, un rôle déterminant dans l’élaboration de la Déclaration de 1948. Il avait en effet une conception exigeante et interventionniste dans ce domaine, repoussant le paravent de la souveraineté des Etats.
En même temps René Cassin fut un grand stratège et un remarquable tacticien, et sur la plan français et sur le plan international. Il s’en expliqua lui-même: il fallait tenir « compte à la fois du but à poursuivre sans aucune concession, ni capitulation, dans l’intérêt de l’humanité, et de la nécessité de procéder par étapes pour tenir compte des résistances à vaincre dans les réalités présentes ou prochaines ». Sur le plan international, il sut faire passer ce qui était à ses yeux essentiel (l’universalité des Droits de l’Homme, incluant toutes les libertés personnelles, ainsi que leur indivisibilité, pour parer à toute manœuvre de la part des pays totalitaires ou dictatoriaux) tout en limitant les concessions faites aux pays qui réclamaient avant tout la proclamation des droits économiques et sociaux, avec d’évidentes arrière-pensées idéologiques.
Les limites et résistances rencontrées par Cassin.
En mars 1947, le Quai d’Orsay créa une Commission consultative de Droit international, présidée par René Cassin, et comprenant des juristes de renom. La Commission se mit facilement d’accord sur le projet de Déclaration des droits de l’homme, mais elle fut loin de suivre René Cassin dans toutes ses audaces et se divisa: un premier groupe souhaitait, comme lui, que la Déclaration fût très rapidement complétée par des conventions lui donnant une véritable force juridique; un deuxième groupe souhaitait que l’on commençât par une Déclaration générale, des conventions ne suivant que par la suite, et prudemment; un troisième groupe était hostile à des conventions qui risqueraient en fait de limiter les droits généraux proclamés par la Déclaration et de générer des désaccords sur leur interprétation.
Mais, par sa force de persuasion et son travail constant, René Cassin amena progressivement la majorité de la Commission consultative à le suivre très largement sinon totalement. Le problème essentiel à ses yeux était d’assurer la mise en oeuvre effective de la garantie des droits de l’homme malgré le principe de souveraineté des Etats dans leurs affaires intérieures. Il trouvait d’ailleurs la position du Conseil économique et social de l’ONU très timorée: il lui reprochait en particulier de ne pas avoir accepté la suggestion française de créer une Commission des droits de l’homme composée d’experts indépendants mais d’avoir imposé qu’elle fût formée de représentants des gouvernements, et aussi d’avoir mis en place un système très restrictif des communications concernant les droits de l’homme. Cassin voulait un système à degrés, par triages successifs, selon lequel les pétitions seraient examinées à différents niveaux, avec des tentatives de négociation. Ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci qu’interviendrait alors une Cour internationale de justice, qui d’ailleurs ne pourrait être créée que dans le futur (Cassin était parfaitement conscient du fait qu’il n’était pas possible de penser que les Etats accepteraient d’emblée une telle cour, ni qu’elle fût compétente dès le début de la procédure).
René Cassin cependant était conscient du fait que les puissances coloniales, en fait historiquement les premiers défenseurs des droits de l’homme, craignaient que ceux-ci ne soient utilisés contre elle par la majorité anticolonialiste de l’ONU. Et il était conscient aussi du fait que les puissances libérales craignaient d’être victimes de campagnes hostiles, alors que les puissances communistes sauraient se défendre. Il fit adopter par la Commission consultative une série de précautions: l’exigence d’une progression des droits de l’homme partout, au même rythme, de façon à « barrer la manoeuvre de ceux qui veulent surtout favoriser les pétitions des territoires sous tutelle, non autonomes ou des minorités ». D’autre part seuls les pays se soumettant eux-mêmes au contrôle auraient le droit de contrôler les autres.
René Cassin finit donc par convaincre ses collègues. Au départ, une majorité de la Commission consultative (qui était unanime pour le projet de Déclaration lui-même et sur la nécessité en soi d’une convention d’application) était divisée sur les mesures concrètes d’application à prévoir. Une majorité allait plus loin que René Cassin, et campait sur une position, irréaliste à ses yeux, prévoyant une Cour internationale et un Parquet international, chargé également des procédures de conciliation. Une minorité, trouvant cette formule peu susceptible d’être adoptée par les Nations Unies et dangereuse pour un pays libéral et colonial comme la France, proposait la création d’une Commission de 11 membres, nommée par l’Assemblée générale, ayant un simple pouvoir de recommandation, limitant son action à l’étude des textes législatifs et réglementaires et sans la possibilité de procéder à des investigations sur place. Finalement on aboutit le 10 avril 1948 à un compromis proche des suggestions de René Cassin: on distinguerait une première phase « pré-juridictionnelle », au cours de laquelle une commission de 11 membres élus par l’Assemblée parmi les représentants des Etats ayant signé la convention procéderait à l’enquête, à une tentative de conciliation et ferait des recommandations. Si celles-ci n’étaient pas suivies d’effet, une deuxième phase « juridictionnelle » interviendrait, l’affaire étant déférée à un parquet international, qui éventuellement poursuivrait l’Etat concerné devant un tribunal international, une Cour des droits de l’homme.
Seulement finalement ce compromis ne fut pas accepté par le gouvernement, même s’il maintint sa confiance à René Cassin, qui continua à représenter la France à la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU jusqu’en 1973. En effet on craignait, dans le climat d’une Guerre froide déjà bien engagée, et avec les difficultés croissantes de l’Union française, qu’une application trop large de la Déclaration des Droits de l’Homme ne mette la France en difficulté face à des régimes totalitaires disposant de considérables moyens de propagande et d’action extérieure. La France n’était pas isolée dans sa réticence. Il faut bien comprendre que la Déclaration n’était qu’une déclaration d’intention, sans valeur contraignante en droit international. Dès le mois de mai 1948, un second groupe de travail de la Commission des droits de l’homme de l’ONU avait commencé à préparer des projets de pactes, dont un déposé par René Cassin, qui auraient donné une forme contractuelle au plus grand nombre possible des droits que la Déclaration se contentait de proclamer, engageant ainsi les Etats signataires. Mais un accord unanime paraissait impossible, d’une part à cause de la division idéologique du monde dans le cadre du conflit Est-Ouest, et du fait que les Etats communistes, minoritaires, ne voulaient accepter aucun droit de regard extérieur; d’autre part à cause du fait que les puissances ex-colonisées, majoritaires à l’ONU dès l’époque si on compte les Etats-Unis et les pays d’Amérique latine, voulaient faire du Pacte un instrument propre à accélérer la décolonisation, ce que refusait bien sûr les puissances coloniales. L’atmosphère de conflit que générait la Guerre froide incitant en outre chaque Etat à veiller jalousement à sa liberté d’action à l’égard des personnes, ressortissantes ou étrangères, placés sous son autorité. Ce ne fut que le 16 décembre 1966 que furent adoptés par l’Assemblée générale le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; tous les deux n’entrèrent en vigueur qu’en 1976. Avec la Déclaration de 1948 ils constituent désormais la « Charte des droits de l’Homme de l’ONU ».
Conclusion : le sens essentiel de la Déclaration de 1948.
Ceci dit, ces réserves de Paris lorsqu’il s’est agi de passer de la Déclaration aux conventions ou pactes d’application n’enlève malgré tout rien au rôle joué par la France dans la proclamation de l’universalité des droits de l’Homme en 1948. Ce qui reste, la véritable avancée, malgré le côté encore théorique de la Déclaration de 1948, c’est qu’elle pose pour la première fois tout être humain comme un sujet, et non plus seulement un objet, du droit international. D’autre part, par de nombreux articles (droit d’émigrer, droit d’asile, droit de l’auteur sur son oeuvre) elle s’affirme comme dépassant le cadre national et comme transnationale. Cette universalité de la Déclaration de 1948 (et rappelons que ce fut Paris qui fit adopter le terme même de « Déclaration universelle ») est sans doute le meilleur moyen de défendre les Droits de l’Homme face au relativisme que risque d’engendrer la contestation de plus en plus forte de par le monde du « modèle occidental ».
Georges-Henri Soutou
Professeur à l’Université de Paris IV – Sorbonne
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE
On retiendra la bibliographie de base suivante: Eric Pateyron, La contribution française à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, La Documentation française, 1998; Gérard Israël, René Cassin (1887-1976). La guerre hors la loi. Avec de Gaulle, les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2007; Marc Agi, De l’idée d’universalité comme fondatrice du concept des Droits de l’homme dans la vie et l’oeuvre de René Cassin, Antibes, Editions Alp’Azur, 1980; Relations internationales, n° 131 et 132, juillet et octobre 2007 (« Droits de l’Homme et relations internationales »).
Cette étude s’appuie en outre sur les riches collections des Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, série NUOI.







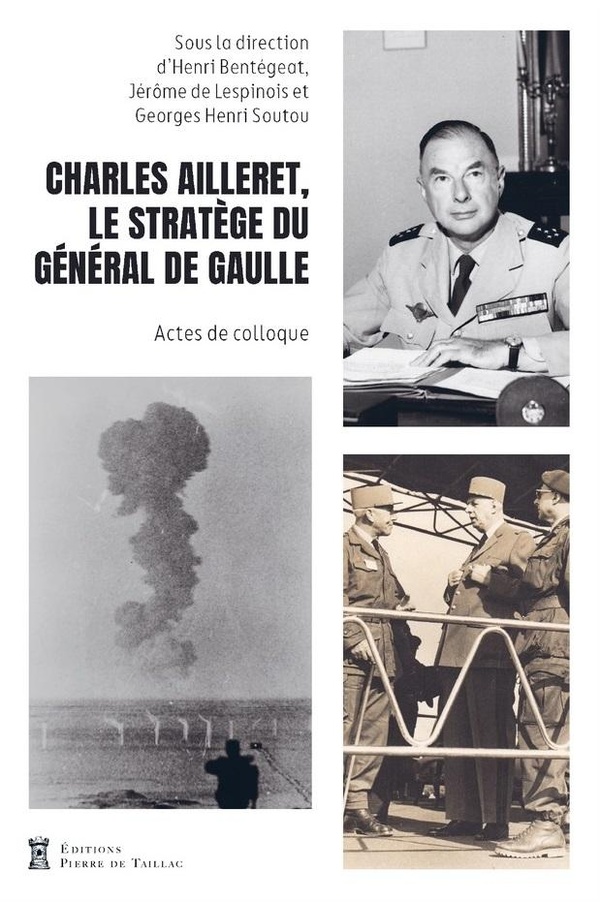


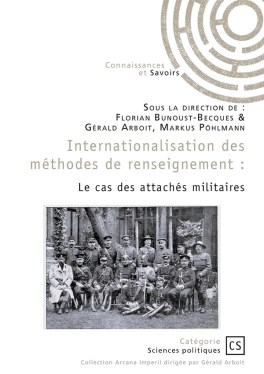
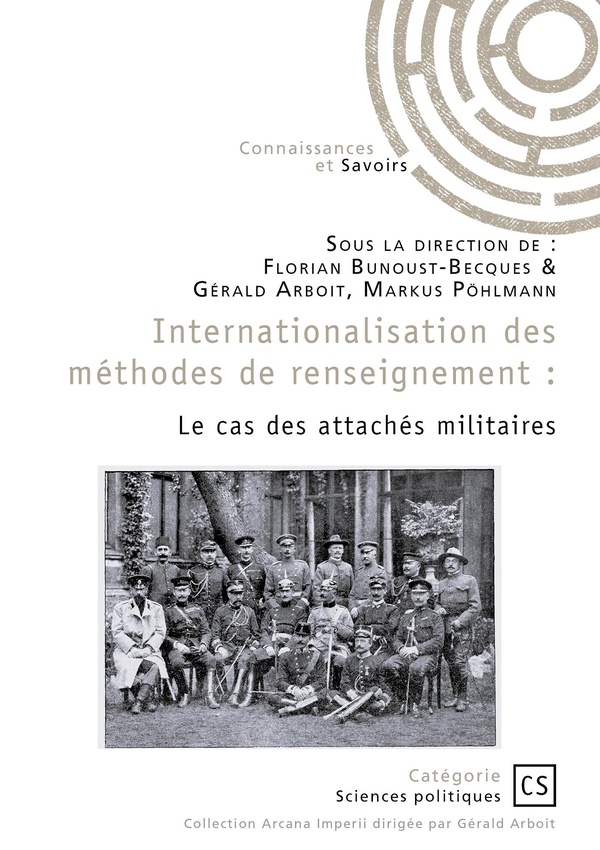
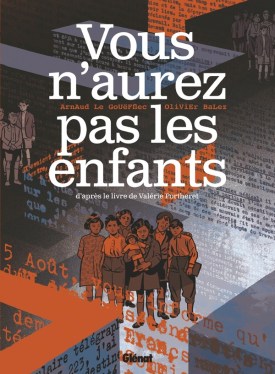
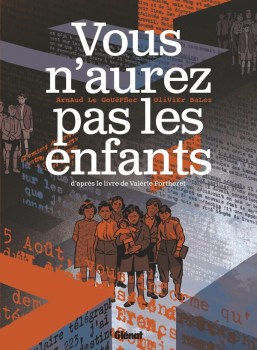














































































































































































































Vous devez être connecté pour poster un commentaire.