Communication du 6 mai 2024 de :
- Anne-Marie GALLEN, Présidente de la chambre à la cour d’appel de Douai et présidente de Cour d’assises et de cour criminelle départementale
- Olivier LEURENT, Président du tribunal judiciaire de Marseille, ancien président de la Cour d’assises de Paris
Thème de la communication : Regards sur la cour d’assises avec ou sans jurés
Synthèse de la séance
Le vice-président, Jean-Robert Pitte ouvre la séance en excusant le président Bruno Cotte, absent pour raison de santé, et en transmettant ses regrets de ne pouvoir être présent.

Olivier Leurent commence son propos en rappelant que la Cour d’Assises est une juridiction emblématique d’une justice rendue au nom du peuple français, qui revendique aujourd’hui, légitimement, un droit de regard sur la justice, qu’il conçoit comme un service public et un pouvoir indépendant, essentiels à l’État de droit.
La Cour d’assises est la fille de la Révolution française. En effet, la déclinaison judiciaire de la notion de souveraineté nationale implique que la justice soit rendue au nom du peuple français par des représentants de la Nation. La Constitution du 3 septembre 1791 met en place des tribunaux criminels départementaux composés d’un jury populaire compétent pour statuer sur la culpabilité ; tandis que des juges ont pour mission de déterminer la peine. Dès cette période les grands principes qui régissent la Cour d’assises sont énoncés : le principe de l’oralité des débats (l’intégralité des éléments du dossiers d’instruction est débattue oralement et le dossier n’est pas emporté dans la salle des délibérés), le principe de leur publicité (c’est la fin de la lettre de cachet) et le respect du contradictoire (qui signifie qu’aucune pièce ne peut être utilisée au cours des débats si elle n’a pas été communiquée préalablement à l’ensemble des parties avec un temps suffisant pour en prendre connaissance). Elle se caractérise également par une procédure inquisitoire et non accusatoire, ce qui distingue fondamentalement le rôle du président de celui des juridictions des pays de Common Law ou des juridictions pénales internationales d’inspiration anglo-saxonne : il dirige les débats de manière totalement impartiale en veillant que ceux-ci soient autant à charge qu’à décharge et que le temps de parole soit équilibré entre accusation, parties civiles et défense.
C’est avec le Code de l’instruction criminelle de 1808 qu’est véritablement créée la Cour d’assises. Née de l’idéal révolutionnaire, elle a connu nombre de réformes, souvent liées au pouvoir d’influence – réel ou supposé – de la magistrature sur les jurés. Le régime de Vichy crée en 1941 un échevinage total – qui sera maintenu par le code de procédure pénale de 1958 – qui instaure que jurés et magistrats statuent ensemble sur la culpabilité et sur la peine. Ce n’est qu’en 1978 que les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales, et non plus parmi les notables. À partir de 1987, puis 2005, les jurés ne participent plus aux Cours d’assises jugeant des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Un droit d’appel est instauré avec la loi du 15 juin 2000 ; l’obligation de motiver les verdicts sur la culpabilité apparaît en 2011 et l’enregistrement sonore des débats devient obligatoire. Les audiences peuvent être désormais entièrement filmées à des fins pédagogiques – et non plus seulement historiques comme le prévoit la loi Badinter de 1985.
Au-delà de ces réformes successives, les jurés demeurent-ils sous influence ? De quelles influences s’agit-il réellement ? De celles des magistrats professionnels, des médias, ou de l’influence sur les jurés de leur propre parcours de vie et de leurs a priori sur la justice ? Afin d’accompagner au mieux les jurés, avant de se retirer pour délibérer, le président doit donner lecture de l’article 353 du code de procédure pénale qui leur prescrit de « s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense ».
La lecture de la feuille de motivation, lors du verdict, est un moment essentiel pour faire comprendre à l’accusé, mais aussi à la société tout entière, les raisons qui ont emporté la conviction de la Cour d’assises.
Les Cours d’assises sont aujourd’hui confrontées à de nouvelles évolutions, miroirs de la société : celle de la place des victimes qui s’est accrue et qui confère à la justice la capacité de participer à une forme de réparation psychologique, même si elle n’a pas vocation à être thérapeutique ; celle de l’allongement des délais de prescription notamment en matière de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs – l’écoulement du temps ne pouvant plus être considéré comme une cause d’irresponsabilité pénale ; de même que la maladie psychiatrique.
Les attentes à l’égard de la justice sont énormes. Celle-ci n’est pourtant faite que d’hommes et de femmes faillibles, dont on espère qu’ils jugent comme ils aimeraient eux-mêmes être jugés, en recherchant la part d’humanité qui nous relie à tout accusé, même celui coupable des faits les plus graves.

Anne-Marie Gallen présente ensuite la nouvelle juridiction que constitue la cour criminelle départementale.
La création des cours criminelles départementales repose sur le constat que, confrontée à l’inflation des procédures criminelle, la Cour d’assises peinait depuis de nombreuses années à remplir son rôle premier, à savoir celui de juger les affaires criminelles dans un délai raisonnable et celui de juger toutes les affaires susceptibles de revêtir une qualification criminelle. En effet, un grand nombre de dossiers criminels impliquant des accusés libres n’étaient plus jugés qu’au compte-goutte. Par ailleurs, la pratique massive de la correctionnalisation, pour faire face à l’afflux des procédures de viols à la suite des évolutions de la société, aboutissait à dégrader ces crimes en agressions sexuelles, pour les juger devant les tribunaux correctionnels, au risque de méconnaître l’intérêt de la victime et de fausser la réponse judiciaire. Ces constats ont conduit à l’expérimentation puis à la création de la cour criminelle départementale (CCD) dans le but de juger plus vite et de juger mieux. La Cour d’assises reste compétente en appel et pour les crimes les plus graves ; la CCD permet de juger les crimes punis jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle par des majeurs non-récidivistes, essentiellement les viols, les coups mortels et les vols à main armée. La cour criminelle est composée d’un président et de 4 assesseurs.
Suite aux résultats favorables de l’expérimentation menée, la loi du 23 décembre 2021, dite « loi pour la confiance dans l’institution judiciaire », a créé la cour criminelle départementale.
Une mobilisation négative des avocats pénalistes et de certains syndicats de magistrats s’est manifestée dès le début de l’expérimentation des CCD, les principales critiques émises tenant à la perte supposée de l’oralité et à celui d’une justice de l’entre-soi, ainsi qu’aux difficultés à mobiliser des magistrats. Toutefois l’expérimentation des CCD a permis de montrer que le contradictoire et l’oralité des débats étaient respectés, les délais étaient raccourcis et les coûts financiers restreints. Par ailleurs, le modèle de la Cour d’assises avec jurés n’est pas sans défaut et doit faire face à la difficulté à composer des jurys, tellement les demandes de dispense sont nombreuses aujourd’hui.
Si l’on s’accorde sur le droit de chacun, accusé ou victime, d’être jugé dans un délai raisonnable – ce que proclame la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme – et sur la nécessité de réduire la détention provisoire, on ne peut que s’accorder sur la nécessité de juger plus rapidement. La justice doit donc se réinventer, magistrats et avocats doivent y contribuer.



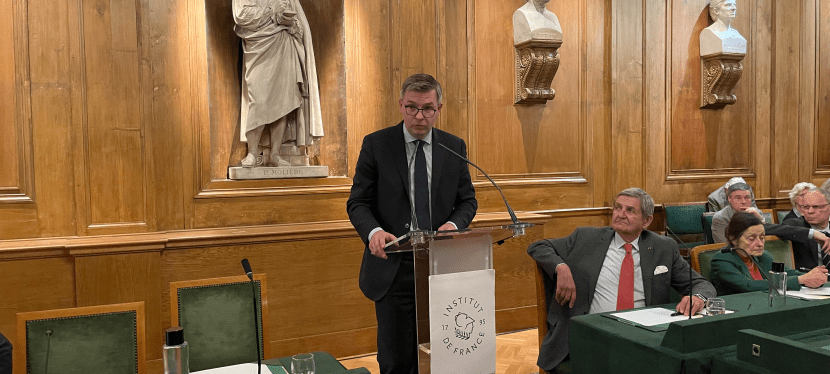




















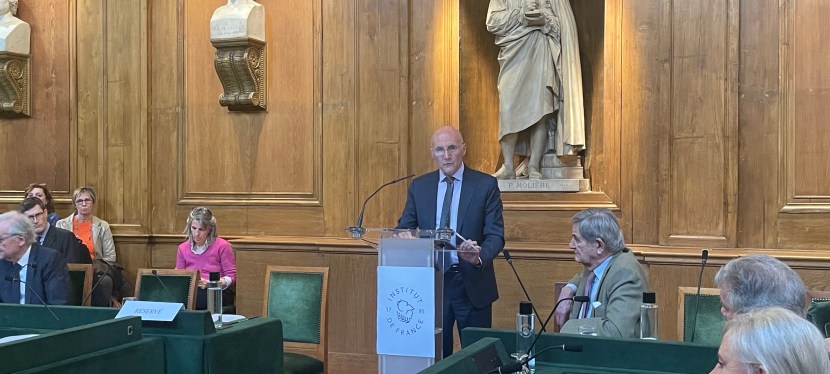

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.